|
|
|
|
Pour
rechercher dans cette page,
sinon voir
"recherche" dans le menu déroulant .
|

|
Pioneer 10 voyage à l'opposé de Pioneer 11. Pioneer 11 passa, le 2 décembre 1974, à 43 000 km de Jupiter et la réaction de gravitation fut plus forte donnant à l'engin la vitesse fantastique de 48 km/s (173 000 km/h), qui l'envoya sur une orbite croissant Saturne le 1 septembre 1979, à 24 000 km. La fin des communications eut lieu en nov 95. |
|
http://science.nasa.gov/headlines/images/pioneer10/bubble_med.gif |
L'imagerie des sondes Pioneer a apporté son quota de découvertes, mais vite surpassée par celle des sondes Voyager. Déjà en route depuis 2 ans, lorsque Pioneer 11 atteignit Saturne, elles sont plus sophistiquées et plus automatisées que les sondes Pioneer. D'une masse de 815 kg, elles se présentent sous la forme d'un corps central, où sont fixés une antenne radio de 3,7 m de diamètre et trois bras porteurs d'un générateur nucléaire radio-isotopique de 400 watts. Les sondes transportent, tout comme les sondes Pioneer, 11 instruments de mesure et de télédétection pour étudier planètes et satellites. Les communications s'effectuent toujours antenne pointée vers la Terre, obligeant les sondes à pivoter pour prendre des images, puis pour se diriger vers la Terre. Les émetteurs ont une puissance de 23 watts et peuvent transmettre des informations au-delà du milliard de kilomètres grâce aux puissantes stations de réception sur Terre du réseau DSN.
|
|
Longueur hors-tout: 2,9 m Largeur max: 2,7 m Masse: 270 kg. Les 2 sondes transportaient 11 instruments.
|
Une description de chaque mission se trouve sur le site de Pioneer Odyssey.
Pilotage du Pioneer
http://history.nasa.gov/SP-349/ch3.htm
Un système automatique, connu sous le nom de
CONSCAN, est employé pour maintenir l'axe de rotation de la sonde vers la Terre. Il
se base sur un léger décentrage de cet axe pour produire une
oscillation quand l'antenne ne se dirige pas exactement vers la Terre. Le
calculateur dirige alors le vaisseau spatial de sorte que les dérives d'antenne
passent par un point optimum en agissant sur les 6 tuyères à
hydrazine.
http://history.nasa.gov/SP-349/p45.jpg
Les sondes Pioneer sont stabilisées par spin en tournant, autour de l'axe de rotation
qui passe par le centre de l'antenne
parabolique, à raison de 4,28
tours/min .
Si une personne était assise à l'intérieur de la sonde, regardant à travers
un trou au centre de la parabole avec un télescope, elle verrait le Soleil
dériver très lentement vers la gauche.
Puisque l'angle sonde-Terre peut se déplacer de presque 2 degrés, le vaisseau spatial doit pouvoir être redirigé vers la Terre environ deux fois par an. La sonde compense cette précession grâce au "CONSCAN (CONical SCAN ou balayage conique). Le signal transmis par radio depuis une antenne terrestre est focalisé et renvoyé par l'antenne parabolique vers un petit récepteur du vaisseau spatial. Pendant une manoeuvre du CONSCAN, le récepteur est physiquement déplacé de 20 cm. Une commande au sol allume un réchauffeur situé à l'intérieur d'un soufflet rempli de fréon liquide. Lorsque le fréon entre en ébullition, le soufflet augmente de volume et déplace un piston et une came, fixés au support, contre une butée mécanique. Un commutateur allume ou éteint le réchauffeur pour garder une position excentrée. Avec ce décalage, le signal radio de la station terrestre est vu par le récepteur du vaisseau spatial comme changeant sinusoïdalement d'amplitude (modulation d'amplitude). Ce signal d'erreur contient l'information d'amplitude et de phase de l'angle entre l'axe de rotation de la sonde et la Terre et la direction à la Terre pendant le cycle de rotation. L'amplitude minimale se produit pendant le cycle de rotation quand l'antenne se dirige vers la Terre, tandis que le maximum se produit quand le plan de l'antenne se situe à 90° de la Terre. La fréquence de la modulation est égale au taux de rotation de la sonde (4,28 t/mn). Le signal d'erreur est traité à bord pour calculer les conditions de synchronisation permettant d'allumer les moteurs de correction à l'instant approprié dans le cycle pour diriger l'axe de rotation vers la Terre.
Le calculateur du Conscan moyenne la modulation sur deux révolutions de la sonde Pioneer. A la 3e révolution, il ordonne à 2 moteurs d'hydrazine (montés à 180° sur un bord de l'antenne parabolique) la mise à feu par des courtes impulsions de 31,2 ms. Ceci déplace l'axe de rotation du vaisseau spatial par petits sauts vers la valeur d'amplitude minimale de l'axe sonde-Terre. Ce processus est répété toutes les trois révolutions, réduisant à chaque fois l'erreur angulaire de pointage et de l'amplitude de modulation. Quand l'angle de pointage est à moins de 0,3 degré de l'axe, le calculateur termine la manoeuvre automatiquement, typiquement au bout de 20 à 30 impulsions. Une commande est alors envoyée pour arrêter le réchauffeur, le fréon se recondense et repositionne à nouveau le mécanisme en position normale. La manoeuvre est terminée.
Rôle du spin
Les données scientifiques rassemblées par Pioneer 10/11 ont rapporté des informations uniques sur la région externe du
Système solaire. Au lancement les sondes Pioneer avaient un spin qui
allait approximativement de 4,28 à 7,8 t/mn, avec l'axe passant par le
centre des antennes. A grande distance, la stabilisation implique un
certain nombre de réajustements. Ceci permet des évaluations précises
d'une accélération voisine 10-8 cm.s-2 (mesure
précise moyennée sur 5 jours).
A l'inverse, un vaisseau spatial stabilisé 3 axes, comme les
sondes Voyager, n'est pas bien adapté à une expérience précise de mécanique
céleste car les nombreuses manoeuvres de contrôle d'attitude peuvent
dégrader le signal perturbant d'une petite accélération externe à la
sonde.
Le signal radio utilisé par le DSN pour communiquer avec la sonde spatiale, est en polarisation circulaire. Lorsque ces signaux sont réfléchis par l'antenne tournante de l'engin spatial, un décalage Doppler est introduit en fonction du taux de rotation. Chaque révolution de la sonde introduit un décalage de phase aux liaisons montantes et descendantes. La liaison montante est multipliée à chaque tour par un rapport voisin de 240/221 donnant un décalage égale à 1+240/221 à chaque cycle.
Ce sont les rotations des sondes pendant des intervalles de données qui ont déterminé la valeur d'aP (anomalie Pioneer). Puisque tous les changements de rotation du vaisseau spatial doivent être associés à son couple ( par manque d'un mécanisme externe plausible, les chercheurs pensent qu'il est produit intérieurement), il y a également la possibilité d'une force de translation, produite elle aussi intérieurement, reliée le long de l'axe de rotation. Il est donc important de comprendre les effets des rotations par rapport à l'anomalie d'accélération (voir anomalie Pioneer §12 et suivants).
 |
 |
|
Evolution du spin de Pioneer 10 de 1987 à 1995. |
Evolution du spin de Pioneer 11de 1987 à 1991 |
Il est important de comprendre les effets des anomalies de rotation par rapport à l'anomalie Pioneer. Les figures, ci-dessus, représentent l'évolution du spin des 2 sondes durant les périodes d'analyses. En considérant la sonde Pioneer 10 en détail, dans la première période, il y a un ralentissement avec une pente décroissante moyenne d'environ - 0,0181 ±0,000 1 tours/an. En fait, une valeur précise, après la mi-1993, n'est pas bien déterminée sur le long terme. Mais à partir de ce qui a était mesuré, il y a une première transition à court terme sur une année où le taux de rotation change ~ - 0,016 t/an. Puis les choses s'établissent à la baisse à un taux de ~ - 0,0073 ± 0,0015 t/an, ce qui est faible et inférieur à l'intervalle. Les effets des manoeuvres sur les valeurs aP peut permettre une estimation sur les fuites de gaz systématiques (voir arXiv:gr-qc/0104064 v5 10 Mar 2005 p36 §F).
Cependant, dans les périodes étudiées, seules les
manoeuvres d'orientation furent effectuées, il n'y a pas eu de
corrections de trajectoire. Au lancement de Pioneer 11, le 5 avril 1973,
le spin était de 4,845 s. Une correction de précession le 18 mai 1973
réduisit la période de rotation a 4,78 s. Puis, à la suite de
manoeuvres de précession, la période fut allongée pour atteindre 5,045
s au voisinage de Jupiter en décembre 1974. Le spin resta constant
jusqu'au 18 décembre 1976, date à laquelle une correction de trajectoire
plaça la sonde sur la route de Saturne. Avant cette manoeuvre, la
période était de 5,455 s pour s'élever après, à 7,658 s. Lors de la
rencontre avec Saturne en décembre 1979, la période passa à 7,644 s, un
petit changement, 3 années après le passage en mode croisière. Il faut
noter que lorsque la période diminue, cela signifie que la rotation
s'accroît. D'autre part, pour la vitesse de rotation c'est l'inverse de
la période. Ainsi 7s = 0,142 857 142 857 t/s soit 4 505 142,857 12 t/an.
Au début des mesures, le 5 janvier 1987, la période
était de 7,321 s pour être à la fin, en octobre 1990, de 7,238 s. Bien que l'ajustement linéaire
du taux de rotation de Pioneer 11 représenté sur la figure de droite soit
semblable à celui de Pioneer 10 dans la première partie, ~ - 0,023 4 ±
0,000 3 t/an, la cause semble être différente. Souvenons nous que bien
que les sondes sont identiques, il peut subsister de légères
différences, par exemple de poids et de performances, à cause des
tolérances. Un engin ne peut pas être rigoureusement semblable à son
jumeau. Contrairement à Pioneer 10, la rotation de Pioneer 11 fut
affecté au moment des manoeuvres de précession.
On voit que lors
des manoeuvres la période de rotation diminue très rapidement, tandis qu'entre des manoeuvres
la vitesse de rotation tend à s'accroître de ~ 0,007 3 ± 0,000 3 t/an
(peut-être à cause des fuites de gaz dans la direction opposée). Nous
nous rendons compte, à la vue de ces quelques chiffres, de la difficulté
des mesures à cause de la précision à obtenir. Celle-ci nécessite de
mesurer des milliardièmes de tour.
Pour en savoir plus: arXiv:gr-qc/0104064 v5 10 Mar 2005
John D. Anderson,∗a Philip A. Laing,†b Eunice L. Lau,‡a, Anthony S. Liu,§c Michael Martin Nieto,¶d and Slava G. Turyshev∗∗a
a) Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109
b) The Aerospace Corporation, 2350 E. El Segundo Blvd., El Segundo, CA 90245-4691
c) Astrodynamic Sciences, 2393 Silver Ridge Ave., Los Angeles, CA 90039
d) Theoretical Division (MS-B285), Los Alamos National Laboratory, University of California, Los Alamos, NM 87545
PACS numbers: 04.80.-y, 95.10.Eg, 95.55.Pe
Génération électrique
http://history.nasa.gov/SP-349/ch3.htm
La génération de puissance des Pioneer est faite à partir de 4 SNAP-19, générateurs thermoélectriques à radio-isotope (RTG) délivrant chacun 40 W, soit 160 W au total, au lancement. La puissance totale disponible n'était plus que de 100 W dans les parages de Saturne.
La chaleur produite à partir de la dégénérescence des isotopes du plutonium 238 est convertie en électricité à partir de thermocouples. Le rendement électrique dépend de la température de la jonction chaude, du circuit thermique des ailettes du radiateur et de la température de la jonction froide. C'est la dégradation des jonctions thermiques qui est le facteur dégradant de la puissance de sortie du générateur. Les 30 années de durée de vie des sondes Pioneer 10 et 11 comptent peu pour une durée de 92 ans représentant la mi-vie des isotopes et agit très peu sur la durée de vie du RTG. La chaleur dégagée ne pourra pas être convertie en électricité à cause de la dégradation des jonctions. L'absence d'électricité provoquera l'arrêt de l'émetteur et la baisse de température interne qui était contrôlée entre - 23°C et + 38°C.
http://history.nasa.gov/SP-349/ch3.htm
Les communications furent maintenues via l'antenne omnidirectionnelle et l'antenne de gain intermédiaire lesquelles ont fonctionné ensemble, l'une sur un récepteur et l'autre sur un autre. Ces récepteurs ont pu être échangés par télécommande fournissant une certaine redondance. Deux émetteurs récepteurs radio couplés à deux guides d'ondes et des tubes amplificateurs émettaient 8W à 2 292 MHz chacun. La voie "aller" était calée sur 2 110 MHz et la voie "retour" sur 2 292 MHz. Les transmissions se sont effectuées, par l'intermédiaire de l'antenne à grand gain de 2,74 m de diamètre et un taux de transmissions, au voisinage de Jupiter, de 2 048 bits/seconde. Ce taux est tombé à 16 bits à la fin de la mission. Ecouter le commentaire en anglais .
Le 13 juillet 2000, Pioneer 10 se trouvait à 11,44 milliards de km de la Terre. Le signal émis avec une puissance de 6,8 W arriva sur Terre au réseau DSN, avec un niveau de -178 dbm, soit 630 millionièmes de milliardième de milliwatt. La limite du récepteur du DSN est de -180 dbm, soit 1 milliardième de milliardième de milliwatt. Le signal s'affaiblit de 0,3 dbm/an. L'émetteur de Pioneer 11 était en panne depuis 1995.
NB: 0 dbm = puissance de 1 mW sur une impédance de 50 ohms.
Il y a 3 senseurs de référence pour guider les 2 sondes à travers l'espace interplanétaire:
1 senseur pour l'étoile Canopus. C'est une géante de classe F0 I-II appelée alpha Carinea, elle est la seconde étoile la plus brillante après Sirius. Visible dans l'hémisphère Sud par R.A. 6h24mn, Dec. − 52°42 (2000), sa magnitude est de - 0,72. Elle se situe à 326 al selon les données d'Hipparcos.
Le contrôle d'attitude peut calculer à partir de la direction de référence Terre - Soleil, avec la direction de Canopus en sauvegarde. Les réglages du gain et du seuil du senseur de Pioneer 11 furent adaptés en tenant compte des résultats obtenus par la sonde Pioneer 10, partie un an auparavant.
Lorsque les
vaisseaux spatiaux quitteront le Système solaire, ils emporteront un message
graphique, destiné à d'hypothétiques
extraterrestres, sous la forme d'un dessin gravé sur une plaque d'aluminium
recouverte d'une pellicule d'or dont les dimensions sont de 229 mm sur 152
mm. Celle-ci fut fixée sur le support d'antenne à un endroit où elle
est mieux protégée de l'érosion interstellaire.

http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNimgs/Plaque.gif
Cette plaque fut apposée sur les sondes Pioneer 10 et 11 dans l'éventualité d'une interception par des extraterrestres, dans des millions d'années. Elle a pour but de leur indiquer l'endroit et le moment du lancement. Un homme et une femme y sont représentés pour montrer l'aspect des êtres de la planète Terre. Les tailles sont données par rapport à la sonde. L'homme lève la main en signe de paix et de bienvenue.
En bas, à gauche, les lignes représentent la position de 14 pulsars par rapport à celle du Soleil. Les symboles le long de ces lignes représentent les fréquences de ces pulsars à la date du lancement de Pioneer 10. La fréquence de l'atome d'hydrogène, le plus simple et le plus abondant dans l'univers, figurant en haut et à gauche, sert de référence. Nous trouvons 2 cercles symbolisant 2 atomes d'hydrogène au niveau de basse énergie. Il y a un lien qui les unit et le chiffre 1 pour indiquer que l'intervalle de temps lié à la transition d'un état à l'autre doit être employé comme échelle de temps fondamentale. Les petits traits verticaux en périphérie des 2 petits cercles indiquent le spin du proton et de l'électron. Le moment de transition d'un état à l'autre est utilisé comme horloge universelle et la diminution régulière des fréquences des pulsars pourrait permettre à une civilisation avancée de déterminer le temps écoulé depuis le lancement. En bas, le Soleil et son cortège de planètes sont représentés ainsi que la trajectoire suivie par Pioneer 10.
Corrosion interstellaire
Toutes les dégradations, causées par corrosion et érosion, que Pioneer 10 a endurées, sont probablement en excès maintenant. La ceinture des astéroïdes et les conditions sévères de Jupiter avaient déjà éprouvé les sondes. Aujourd'hui, les Pioneer sont dans le vide spatiale où la densité moyenne de molécules représente le millième de milliardième du meilleur vide obtenu sur Terre.
Les scientifiques s'attendent à ce que Pioneer dure une période indéterminée, survivant probablement à la Terre. Dans 5 milliards d'années, le Soleil sera une géante rouge qui s'étendra au-delà de l'orbite terrestre et la Terre se consumera à l'intérieur. Pendant ce temps, Pioneer voyagera silencieusement dans l'espace interstellaire. Le processus d'érosion dans l'espace interstellaire nous est entièrement inconnu, mais il est moins efficace qu'à l'intérieur du Système solaire où le taux d'érosion, causé principalement par des micrométéorites, est de l'ordre de 1 angström (0,1 nm) par an. Ainsi une plaque gravée à une profondeur d'environ 100 µm (micromètre) devrait être le plus probablement identifiable à au moins une distance de 10 parsecs et probablement à plus de 100 parsecs (1 parsec = 3,26 al). En conséquence tout le matériel des sondes Pioneer est capable de survivre pendant une période plus longue que n'importe quel ouvrage sur Terre.
http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNStat.html
Voyage
galactique
Pioneer 10 est à ~ 90 UA du Soleil dans la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est une région en forme de disque où co-existent des astéroïdes et des comètes à courte période, qui s'étend jusqu'à 100 UA. Pioneer 10 aura traversé cette zone dans 5 à 10 ans (2010 à 2015). Dans 20 000 ans, la sonde atteindra le Nuage de Oort. C'est un réservoir de 2 000 milliards de corps glacés qui entoure totalement le Système solaire en marquant sa limite à 100 000 UA. Le passage d'étoiles à proximité perturbent ces corps glacés en les attirant vers un autre Système ou les repoussant dans le Système solaire interne où ils deviendront des comètes à longue période. Il arrive très certainement que des échanges se produisent entre ces étoiles et leurs systèmes et le Système solaire.
Dans 1 000 siècles, Pioneer 10 et Pioneer 11 quitteront
définitivement le nuage d'Oort ainsi que le Système solaire. Le temps moyen pour qu'une sonde parvienne à moins
de 30 UA d'une étoile est supérieur
à l'âge moyen de notre Galaxie (8 à 10 milliards d'années).
Pioneer 10 et 11 resteront en orbite galactique, c'est-à-dire dans la Voie
Lactée, pendant des milliards d'années. Les sondes se déplacent en "ligne
droite" (compte tenu de l'influence gravitationnelle, la vraie ligne
droite n'existe pas dans l'univers), depuis le Système solaire, à la vitesse de 12 km/s. Jusqu'à la
distance de 309 000 AU (1,5 parsecs) soit 126 000 ans, elles resteront dans le
champ gravitationnel du Soleil. Au-delà, Pioneer 10 et 11 dépendront, dans la
Voie Lactée, de l'influence du champ gravitationnel des étoiles qu'elles
croiseront. Elles seront probablement toujours présentes lorsque le Soleil sera en fin de vie,
dans 5 milliards d'années.
Etat des lieux
http://renshaw.teleinc.com/papers/prl-pi/prl-pi.stm
 Les données anormales dans le
signal Doppler des sondes spatiales Pionnier 10 et 11, décelées dans les
années 1980 au voisinage de Saturne, ont été interprétées comme une accélération constante vers le
Soleil
de ~
8,5.10-8 cm.s-2 [1], retardant la sortie du Système solaire.
Détail infime comparé à
la vitesse d'évasion des sondes de 12 kms-1, par rapport au
Soleil. Ce
ralentissement a
présenté, pour Pioneer 10, après plus de 10 ans de données, une valeur quasi constante.
Les données anormales dans le
signal Doppler des sondes spatiales Pionnier 10 et 11, décelées dans les
années 1980 au voisinage de Saturne, ont été interprétées comme une accélération constante vers le
Soleil
de ~
8,5.10-8 cm.s-2 [1], retardant la sortie du Système solaire.
Détail infime comparé à
la vitesse d'évasion des sondes de 12 kms-1, par rapport au
Soleil. Ce
ralentissement a
présenté, pour Pioneer 10, après plus de 10 ans de données, une valeur quasi constante.
Les causes varieraient dans le temps, agissant dans la mauvaise direction ou seraient d'une taille trop négligeable pour produire un décalage exigeant un regard critique sur les algorithmes qui convertissent des signaux observés sur Terre, avec une inertie telle que celle du barycentre solaire. Complexes en pratique, les modifications sont conceptuellement simples.
La Terre est un système non inertiel comparé à un état stationnaire ou se déplaçant linéairement vis à vis du Soleil, avec des effets mobiles et gravitationnels de grande précision. La mesure du temps à l'aide d'un réseau d'horloge, sur Terre, est convertie en celui d'une horloge hypothétique gravitationnellement uniforme, en orbite solaire parfaitement circulaire, désignée sous le nom de TDB, (Temps Dynamique Barycentrique). Le TDB représente le décalage fixe d'une horloge hypothétique dans une référence inertielle avec un barycentre solaire, par lequel toutes les observations sont finalement transformées [2,3].
Les données reçues des sondes Pionnier 10 et 11 ou Ulysse sont transformées en TDB, puis ramenées au temps du barycentre solaire ou à un certain état défini à inertie semblable. Alors les données apparaissent comme si les récepteurs étaient dans la référence du barycentre solaire. Les données sont comparées au signal reçu en bande S (13 centimètres) transmis à l'engin spatial.
Après conversion avec le barycentre solaire de référence, le faible décalage des 2 voies, aller et retour, donne le résultat. Le décalage Doppler des signaux reçus est utilisé comme entrée dans une expression relativiste servant à déterminer la vitesse de la sonde. Les modèles gravitationnels, qui prévoient le degré de ralentissement en fonction du temps, sont très précis et fournissent la vitesse prévue pour n'importe quelle période ou distance, donnant l'historique de la trajectoire du vaisseau spatial. Lorsque l'effet Doppler observé est comparé à la valeur attendue par la modélisation gravitationnelle, il y a un décalage résiduel constant corrélé à la différence numérique entre les équations relativistes newtoniennes et les équations spéciales Doppler.
Les décalages causés par l'effet doppler radial relativiste ou newtonien dans un sens, notés respectivement "S" et "N" [4], sont:
![]() (1)
(1)
![]() (2)
(2)
Dans cette étude, le terme "dilatation du temps" en (1), composé de 2 parties, causé par la vitesse de la sonde et le TDB avec le respect du barycentre solaire, est une différence primordiale entre les équations relativistes newtoniennes et les équations spéciales de l'effet Doppler radial.
L'expérience confirme le ralentissement de l'horloge dû à une vitesse induite mesurée par rapport à un état d'inertie idéal, démontrée notamment avec le GPS et la durée de vie du muon, au CERN. Si le ralentissement de l'horloge est dû à un certain mécanisme autre que la dilatation relativiste présumée du temps, alors l'équation spéciale de l'effet Doppler est incorrecte et l'équation relativiste newtonienne est préférable [5].
Supposant la validité de (2), alors l'application de (1), en convertissant le TDB en état de barycentre solaire avec une vitesse de la Terre de 30 km/sec, présente un décalage apparent constant de fréquence de 5,00 x 10-9 Hz/Hz. Un décalage apparent de fréquence, causé par l'utilisation de (1) au lieu de (2) en convertissant à partir du barycentre solaire la vitesse de la sonde Pioneer de 12,24 km.s-1 , est 8,32.10-10 Hz/Hz. Appliqué aux équations de l'effet Doppler, ces décalages traduisent une variation résiduelle dans la fréquence de 5,83.10-9 Hz/Hz, seulement dans un sens. Si l'équation (2) est correcte, ces décalages apparaîtront comme une dérive régulière de fréquence dans le réseau DSN de 5,83.10-9 Hz/s. La division par la fréquence porteuse de la bande S a comme conséquence une accélération constante perçue d'horloge de at = 2,53 x 10-18 s.s-2.
Etant donné qu'une accélération si cohérente et systématique de toutes les horloges est peu probable, le décalage peut être regardé comme une accélération anormale du vaisseau spatial de ap = atc où ap = 7,59.10-8 cm.s-2, indépendant de la distance et de la constante pour une vitesse donnée du vaisseau spatial.
L'accélération apparente dans le sens du Soleil s'accroît proportionnellement avec la vitesse de la sonde et non selon 1/r2 comme une force gravitationnelle l'indiquerait. Si l'anomalie est due à une préférence pour l'expression radiale newtonienne de l'effet Doppler, les scientifiques s'attendent à une corrélation entre le programme CHASMP ( satellite pour l'étude du déplacement à grande précision) d'Aerospace Corporation et le programme ODP (programme de détermination d'orbite) du JPL, car ils appliquent la même méthodologie de l'effet Doppler.
Selon les auteurs [ 1 ] " il est intéressant de spéculer sur la possibilité que l'origine du signal anormal est une nouvelle physique."
Plus probablement le résultat serait peut-être un artefact des équations choisies pour modéliser l'effet de Doppler, exigeant un regard plus précis sur les équations comparant la lumière et le temps, les fréquences de base et les fréquences Doppler.
[1] J. D. Anderson, P. A. Laing, E. U. Lau, A. S. Liu, M. M. Nieto, and S. G. Turyshev, Phys. Rev. Lett., 81, 2858 (1998).
[2] D. C. Backer, in: Timing Neutron Stars, (Kluwer Academic Publishers, Boston, MA 1989), p. 3.
[3] J. H. Taylor, in: Timing Neutron Stars, (Kluwer Academic Publishers, Boston, MA 1989), p. 17
[4] R. P. Feynman, Lectures on Physics, Vol I, (Addison-Wesley, Menlo Park, CA, 1965), p. 34-7.
[5] C. E. Renshaw, IEEE: Aerospace and Electronic Systems Magazine, 11, 1 (1996)
Traduit du texte de Curtis E. Renshaw, William L. Kallfelz
Tele-Consultants, Inc., 680 America’s Cup Cove, Alpharetta, GA 30005
(September 29, 1998)
Questions et commentaires: crenshaw at teleinc point com
L'anomalie Pioneer
Leur mission principale terminée, les sondes continuèrent leur chemin au-delà de l'orbite de Pluton pour chercher une éventuelle 10e planète. Cette dernière, baptisée provisoirement 2003UB313, plus grande que Pluton, aurait été observée sur Terre, le 8 janvier 2005 par Chad Trujillo, un membre de l'équipe de l'observatoire Gemini North sur le Mauna Kea à Hawaï. Cet objet avait été découvert en décembre 2004 par Samuel Oschin à l'aide du télescope de 1, 2 m du Mont Palomar.
Tant que les sondes avaient du carburant, les contrôleurs de la mission pouvaient ajuster la vitesse et la trajectoire. Mais après la panne sèche, les sondes continuèrent leur chemin grâce à l'inertie et à l'effet de fronde acquis lors du survol de Jupiter pour Pioneer 10 et pour Pioneer 11 Jupiter et Saturne.
Cependant, puisque la pression du rayonnement diminue rapidement (l'inverse du carré de la distance) lorsque la distance au Soleil s'accroît, à plus de 20 UA le niveau est suffisamment bas (
< 5.10−8 cm.s-2) pour permettre la détection de forces anormales, très faibles, dans le Système solaire.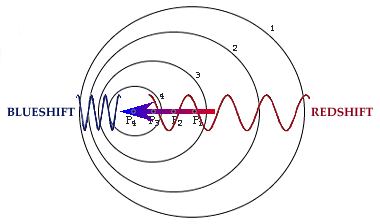 |
|
http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Bima/Images/doppler.gif Exemple sonore: http://www.walter-fendt.de/ph11e/dopplereff.htm |
C'est après l'extinction définitive des moteurs de correction que les anomalies ont commencé à apparaître dans le mouvement des 2 sondes. Les mesures de l'effet Doppler ont montré une décélération inattendue juste au-delà de l'orbite d'Uranus. Les contrôleurs envoyaient des ordres aux sondes, qui les renvoyaient vers la Terre. En comparant les signaux "aller" et "retour", ils ont commencé à noter un décalage vers le bleu des signaux de retour, à environ 20 UA. Les sondes tombent vers le Soleil. A l'inverse, si elles s'étaient éloignées, il y aurait eu un décalage vers le rouge. C'est l'effet Doppler, bien connu de tous, à l'arrivée d'une ambulance. Lorsqu'elle s'approche de nous, la fréquence de la sirène est élevée (son plus aigu = bleu) et lorsqu'elle s'éloigne, la fréquence de la sirène diminue (son plus grave = rouge).
Le duo continua dans le " bleu " lorsqu'elles dépassèrent l'orbite de Neptune, 10 UA plus tard. Aujourd'hui, après 30 ans, ce décalage apporte une erreur supérieure à la distance Terre - Lune. Ce " bleuissement " se confirme. Les sondes elles-mêmes ont été mises hors de cause.
La plupart des hypothèses supposent qu'une augmentation de la pesanteur serait la source du décalage de fréquence. Lors de la transmission du signal retour vers la Terre, les ondes des Pioneer " tombent " dans la pesanteur du Système solaire. Et cela pourrait être bien plus " important " que prévu (basé sur de précédentes évaluations de la distribution de masse dans le Système solaire). Et puisque c'est plus important, les sondes ralentiraient plus que prévu.
Maintenant, le monde scientifique se pose une question importante: " Quelle est la cause de cet accroissement de gravité ? ". La matière noire se manifesterait-elle et avec elle l'énergie noire, la force qui s'oppose à la gravité ? Une troisième voie viendrait-elle de la théorie des cordes (deux branes locales - l'équivalent des plaques tectoniques de n dimensions - pourraient s'entrecroiser dans notre Système) ?
Les astronomes se rendent déjà compte qu'il y a beaucoup de matière flottant au-delà de l'orbite d'Uranus. Cette matière, sous forme de gros objets et de planétésimaux de glace, a été prévue pour la première fois par Gerald Kuiper en 1951 pour expliquer l'origine des comètes à courte période. Selon la théorie de Kuiper, la planète à faible densité Pluton (et son satellite Charon) étaient les membres les plus importants de la ceinture de Kuiper avant 2003UB313.
Contiguë à la ceinture de Kuiper (de 70 à 4 000 UA), il y a une importante région dont les comètes à longue période seraient originaires. De telles comètes peuvent s'approcher du Soleil en provenance de n'importe quelle direction et rarement y (sinon jamais) revenir. L'astronome Jan Oort a prédit l'existence de cette région en 1950. Le "Nuage de Oort" envelopperait, telle une sphère, le Système solaire et formerait un halo sombre de matière, stoppant le rayonnement solaire. Au niveau de l'orbite de Pluton, le rayonnement solaire est 900 fois plus faible qu'au niveau de l'orbite terrestre.
Les 2 sondes sont au-delà de 70 UA, dans la ceinture de Kuiper. Le "bleuissement" est uniforme et constant. En mars 2005, un article paraissait avec le titre: " Anomalie Pioneer: Gravitation à cause de la ceinture de Kuiper". Jose A. Diego et d'autres chercheurs de l'Institut pour l'Astronomie de l'université de Mexico écrivait: " ... il n'y a pas besoin d'évoquer toutes les forces noires de l'Univers. Il faut tout d'abord essayer d'expliquer le phénomène avec la physique actuelle. Si c'est insuffisant, alors il faudra utiliser l'artillerie lourde".
Mais il ne faut
peut-être pas utiliser exactement la bonne vieille ceinture de Kuiper (en
termes de masse, distribution de masse et locale). Pour Jose A. Diego, la
ceinture de Kuiper commence à environ 20 UA du Soleil, juste au-delà de
l'orbite d'Uranus et aurait une épaisseur de 1 UA. Ainsi,
leur ceinture de Kuiper aurait presque deux fois la masse de la Terre - un peu moins de dix
fois ce qui avait été proposé à l'origine. Cette masse est en grande partie décentrée vers l'orbite d'Uranus.
L'augmentation vient du fait qu'au début, des évaluations de la masse totale
furent basées sur des tailles particulièrement faibles. En incluant
des corps de glace de plus grande taille, composés de gaz, le groupe pense qu'il
y a suffisamment de masse pour expliquer le décalage des signaux.
Diego continue en ajoutant: "...
il est important de préciser que la ceinture agirait également sur l'orbite de
Neptune... ". Effectivement n'importe quelle augmentation de masse dans la ceinture de Kuiper
rapprocherait tout doucement Neptune du Soleil, en spiralant. L'équipe
estime que le centre de masse de la planète se décalerait de 1,62 km à
chaque révolution de 164,8 ans. De plus ils ajoutent que la distribution
radiale de la densité requise pour expliquer l'accélération constante vers le
Soleil peut être trouvée par des modèles de
formation du Système solaire. Pour expliquer la concentration
de masse plus grande autour de l'orbite d'Uranus ils continuent en décrivant " un transport
centripète de matière " vers l'orbite d'Uranus, dans le temps. Cette masse additionnelle ralentit
la force relative à la Terre en remodelant le champ gravimétrique lié à cette région du
Système solaire.
Naturellement un autre facteur pourrait affecter la fréquence porteuse: un ralentissement inattendu provoqué par un étirement de la force. Un tel étirement pourrait résulter de la rencontre d'un flot régulier de particules dans la ceinture.
De même, plus de matière
que prévue à l'origine devrait être attribuée à la ceinture de Kuiper mais, dans ce
cas-là, la matière additionnelle devrait être distribuée plus
régulièrement pour expliquer la perte constante du moment de chaque sonde.
http://www.universetoday.com/am/publish/kuiper_belt_slowing_pioneer.html
Etude de l'anomalie
Au début des années 80 et à une distance de 20 UA du Soleil, la pression du rayonnement solaire sur Pionnier 10 avait diminué de < 5.10−8 cm.s-2, les chercheurs ont constaté que la plus grande erreur systématique de l'accélération résiduelle avait un décalage constant, aP, indiquant une accélération apparente des sondes Pioneer 10 et 11 orientée vers le Soleil, appelée anomalie Pioneer. Depuis, ils reçurent des données anormales sans interruption. Le JPL (Jet Propulsion Laboratory) et Aerospace Corporation ont produit, indépendamment, des analyses pour la détermination de l'orbite des Pioneer jusqu'en juillet 1998. Ils conclurent finalement qu'il y a une accélération non modélisée, aP, vers le soleil de ~ 8 10-8 cm.s-2 pour Pionnier 10 et Pionnier 11.
Beaucoup d'efforts furent déployés, en vain, pour déceler une erreur résiduelle sur les mesures. Une recherche approfondie fut entreprise, mais rien ne fut découvert. Une recherche détaillée des effets internes ou externes de la sonde aussi bien que ceux modélisées par ordinateur n'apportèrent aucune information. Des discussions sur les modèles théoriques, les méthodes utilisées pour détecter et étudier l'influence de faibles forces sur une sonde interplanétaire furent vaines. Cela inclut la méthode de réception des signaux Doppler, la publication des données et leur traitement. Les données de Pioneer 10 furent collectées sur la période du 3 janvier 1987 jusqu'au 22 juillet 1998 (pour Pioneer 11 la période s'étend du 5 janvier 1987 jusqu'à la perte d'informations cohérentes le 1 octobre 1990). Grâce aux dépouillements approfondis entrepris le chiffre de la dérive devient 8,74 ± 1,33.10-8cm.s-2 .
Les coordonnées planétaires des masses du Système solaire furent issues de l' Export Planetary Ephemeris DE405 du JPL référencé ICRF. Les analyses furent établies à partir des coordonnées à J2000. Les variations temporelles de l'orientation terrestre à J2000 sont définies par la version de 1998 du fichier EOP du JPL, lequel tient compte de la précession et de la nutation.
La dérive est sans ambiguïté, définie, et ne peut pas être enlevée sans une accélération supplémentaire, aP, ou l' incorporation dans les données elles-mêmes d'une dérive de fréquence, c'est-à-dire, une " accélération d'horloge " at (at ≡ aP /c). S'il y avait une dérive systématique dans les horloges atomiques des paramètre du DSN (réseau de l'espace lointain) ou dans les signaux du temps de référence, ceci apparaîtrait comme une irrégularité temporelle, c'est-à-dire toutes les horloges changeraient avec une accélération constante. Cette possibilité a pu être éliminée.
En continuant la recherche d'une explication, 2 possibilités sont à considérer:
les sondes Pioneer 10 et 11 possèdent des propriétés systématiques, non découvertes car elles sont identiques aux 2 sondes.
l'accélération est causée à quelque chose non compris, se traduisant par une " viscosité " spatiale proportionnelle à une constante approximative en fonction de la vitesse des Pioneer.
Ces 2 possibilités
purent être recherchées en étudiant la stabilité du spin (rotation) des
sondes, dont l'axe n'est pas dirigé vers le Soleil et dont les vecteurs de vitesse
orbitale sont loin d'être dirigé radialement. Deux candidats pour cette
recherche furent les sondes Galiléo, lors de sa mission vers Jupiter et ses
satellites et Ulysse dans son voyage, hors de l'écliptique, autour du Système
Jupiter- Soleil. Ces sondes ont apportées une quantité considérable
d'informations sur l'effet Doppler (variation de fréquence liée au
déplacement). Avec ces données les
chercheurs peuvent dire si une sonde spatiale accumule une erreur en raison
d'une accélération constante ou si le procédé de détermination d'orbite est
faussé par une décalage de fréquence Doppler.
De
récents changements de stratégie et du programme de détermination de l'orbite
conduisant à de nouveaux résultats, sont au nombre de trois:
des données furent ajoutées à Pioneer 10, en étendant l'étude jusqu'en juillet 1998. Les données ainsi collectées (3 janvier 1987 au 22 juillet 1998) couvrent une distance héliocentrique de 40 à 70,5 UA. Pioneer 11 était beaucoup plus proche (22,42 à 31,7 UA) que Pioneer 10 durant sa période du 5 janvier 1987 au 1 octobre 1990). Les masses des sondes sont de 251,883 kg pour Pioneer 10 et de 239,73 kg pour Pioneer 11. Puisque la majorité des calculs furent pour étudier le comportement de Pioneer 10, c'est sa masse qui fut retenue comme masse nominale.
Etude du spin, en particulier celui de Pioneer 10 a montré une importante anomalie sur la période allant d'avril/mai 1990 à avril/mai 1992. Cela amena les chercheurs à mieux considérer chaque variation possible de aP parmi 3 intervalles de temps défini par le JPL:
du 3 janvier 1987 au 17 juillet 1990.
du 17 juillet 1990 au 12 juillet 1992 de 49,5 à 54,8 UA.
du 12 juillet 1992 au 22 juillet 1998.
Le nombre total de données s'étala sur 20 055 points de données pour Pioneer 10 et 10 616 pour Pioneer 11. Ceci permis une meilleure compréhension des fuites de gaz systématiques des sondes.
En regardant les mesures détaillées d'aP en fonction de temps, les chercheurs ont trouvé un terme annuel oscillant anormal, inférieur à l'anomalie Pioneer. Des confirmations seront recherchées afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'artefacts causés par les méthodes de calcul. Pour les derniers résultats, le JPL utilise la méthode des paquets séquentiels et la méthode des moindres carrés. Les résultats ont permis une meilleure compréhension des sources d'erreurs systématiques. En même temps, elles ont augmenté la confiance dans la détermination de l'anomalie.
arXiv:gr-qc/0104064
v5 10 Mar 2005
Conférence de Brême
 Les 18 et 19 mai
2004 a eu lieu la première conférence internationale sur
"l'anomalie Pioneer" (A&C n°1946 p 56). Elle
Les 18 et 19 mai
2004 a eu lieu la première conférence internationale sur
"l'anomalie Pioneer" (A&C n°1946 p 56). Elle fut organisée par le
Zentrum für
Angewandte Raumfahrt Microgravitation (ZARM
Centre de Microgravité appliquée à
l'espace) de l'université de Brême.
Dans ce centre la recherche est concentrée sur les phénomènes en mécanique des
fluides, en particulier, microgravité et technologie spatiale.
L'outil le plus exceptionnel, est la tour de chute libre (à droite), qui fournit 4,74 secondes
d'apesanteur (hauteur: 146 m).
fut organisée par le
Zentrum für
Angewandte Raumfahrt Microgravitation (ZARM
Centre de Microgravité appliquée à
l'espace) de l'université de Brême.
Dans ce centre la recherche est concentrée sur les phénomènes en mécanique des
fluides, en particulier, microgravité et technologie spatiale.
L'outil le plus exceptionnel, est la tour de chute libre (à droite), qui fournit 4,74 secondes
d'apesanteur (hauteur: 146 m).
http://www.zarm.uni-bremen.de/5conferences/images/pioneer.jpg
http://www.zarm.uni-bremen.de/Pioneer/images/S7.jpg
Cette conférence fit suite à l'observation d'un comportement anormal des corps massifs dans un champ de faible gravité et représenta donc un intérêt certain pour la communauté scientifique. L'exemple le plus frappant est celui de l'anomalie Pioneer. Un autre exemple concerne la courbure des galaxies. Du côté phénoménologique ce comportement a été relié, par exemple, à la théorie newtonienne dynamique modifiée (la théorie MOND pour MOdified Newtonian Dynamics) ou d'un niveau plus fondamental, à une théorie bi-métrique. En outre sa relation possible à la matière sombre et à l'énergie sombre a été discutée.
A cette conférence, la France était représentée par l'Onera, dont la maîtrise dans le domaine de l'interférométrie ultrasensible est mondialement reconnue, ainsi que le Groupe d'optique atomique du laboratoire de Charles Fabry (Institut d'optique théorique et appliquée d'Orsay) spécialisé dans l'interférométrie à ondes de matière et par un expert en métrologie fondamentale (Institut Galilée, laboratoire de physique des lasers à l'université de Villetaneuse). Après avoir débattu et dressé un bilan, les 40 participants ont confronté leurs points de vue sur les suites à donner. L'ESA a lancé un appel à idées pour son programme "Cosmic Vision 2015-2025, ce qui a généré 5 projets de mission. (Alexandre D. Szames Air&Cosmos n° 1946 page 56)
Intérêt fondamental
Le JPL s'intéresse particulièrement à la trajectoire, car le fait qu'un mobile évolue sur une orbite liée ou une trajectoire de fuite jouerait un rôle déterminant pour mettre en évidence l'anomalie (Alexandre D. Szames A&C n°1946 p 56). Plusieurs explications ont été proposées, mais jusqu'à maintenant toutes manquent de preuves . Par exemple, poussières et gaz ne peuvent pas expliquer à eux seuls, la densité manquante de la matière ordinaire dans notre Système solaire.
Si l'accélération anormale de la sonde est causée par les restes d'une matière mystérieuse de poussières et gaz dans notre Système solaire, alors les calculs suggèrent que la densité surprise est d'environ 4.10-19 g.cm-3. Cela correspond à environ 200 000 atomes d'hydrogène (ou équivalent) par cm3. Si ces poussières et gaz mystérieux sont distribués de manière sphérique dans un rayon de 100 UA autour du Soleil, alors la masse totale de la matière mystérieuse serait équivalente à une petite planète (1.10-6 masse solaire) ou avec seulement environ 1.10-8 masse solaire, à l'intérieur de l'orbite d'Uranus, laquelle est un peu près deux ordres de grandeur dans les limites actuelles. Si elle est contenue dans un disque au lieu d'une sphère, alors la masse totale de cette matière mystérieuse serait évidemment moindre. La condition requise pour que la matière mystérieuse soit plus dense que la matière ordinaire à ces distances, serait que l'accroissement de densité provienne de la pression du rayonnement solaire.
L'anomalie Pioneer: http://www.ph.unimelb.edu.au/~foot/pioneer.html
Expériences futures
Après avoir éliminé les explications les plus plausibles, les chercheurs ont examiné une éventuelle modification de la force de gravité. Ceux-ci ont conclu que de toute évidence, des analyses, des observations et du travail théorique plus poussés sont nécessaires. Les scientifiques s'attendent toutefois à ce que la solution implique la physique conventionnelle.
Faute de pouvoir comparer les résultats d'observations terrestres d'objets lointains avec ceux de sondes in situ, l'homme n'a jamais pu s'affranchir des effets locaux. Aujourd'hui, au cours de cette conférence, des projets vont peut-être voir le jour.
A la lecture de l'article d' Alexandre D. Szames dans l'édition du 22 juillet 2005 de Air et Cosmos n° 1993 p 59, nous apprenons que depuis la réunion de l'année dernière, une équipe d'une cinquantaine d'experts, s'est constituée de part et d'autre de l'Atlantique.
La sonde proposée entend par sa conception même, neutraliser les erreurs "systématiques" liées par exemple, à l'asymétrie du rayonnement thermique. Elle se compose d'un vaisseau mère gyrostabilisé relâchant une petite sphère réfléchissante. La distance de la Terre à la sonde mère s'obtient par effet Doppler, complétée de données issues d'accéléromètres. Un télémètre laser mesure finement la distance de la mère à la sphère. Au final, la précision, mille fois supérieure à celle des sondes Pioneer, atteint 1.10-12 ms-1.
La théorie MOND
Les estimations de la masse cachée reposent sur un principe très simple. La composition de l'Univers est connue, tout au moins dans sa partie visible. Nous trouvons des galaxies et des molécules composées d'atomes et de particules. Tous sont en mouvement. Leur cinématique et dynamique sont connus grâce à la gravitation, qui est régie par les lois de Newton.
Pour déterminer la masse du Soleil, nous partons d'une planète qui est soumise à sa force centrifuge et à l'attraction du Soleil. La force centrifuge est proportionnelle au carré de la vitesse. L'attraction solaire est proportionnelle à la masse du Soleil et à l'inverse du carré de la distance Soleil - planète. Les orbites étant pratiquement circulaires, il est facile de déterminer la masse du Soleil. Voilà qui explique pourquoi, plus une planète est proche du Soleil, plus sa vitesse orbitale est rapide. Le champ gravitationnel est de plus en plus important à l'approche du Soleil. Il faut donc un accroissement de la force centrifuge pour contrebalancer cette force.
Dans une galaxie, le même principe est appliqué. En prenant une étoile se déplaçant comme toutes ses sœurs dans le sens de la rotation de la galaxie, on détermine sa composante de vitesse. Ainsi connaissant sa distance au centre de la galaxie, sa masse peut être calculée. Il en est de même pour les nuages moléculaires répartis entre les étoiles. C'est ainsi que les scientifiques peuvent déterminer la vitesse de rotation d'une galaxie, par la connaissance de la répartition des masses. Or les calculs montrent que 90% est cachée, pour rendre compte de la vitesse de rotation de toutes les galaxies. Les études systématiques portent désormais sur plusieurs milliers de galaxies et montrent que le phénomène est universel: quasiment toutes les galaxies spirales montrent un excédent de matière.
Il semble que la masse manquante se trouve répartie beaucoup plus à l'extérieur des galaxies. Les galaxies baigneraient alors dans un halo plus ou moins sphérique. Puisqu'elle est pour l'instant invisible, la masse cachée est appelée: matière noire.
Les galaxies se regroupent en amas. Elles peuvent être des centaines. On peut aussi analyser la dynamique du groupe. Elles y ont un mouvement désordonné, mais en appliquant un coefficient de dispersion, il a été possible de déterminer que le carré de cette dispersion est proportionnel à la masse de l'amas. C'est en appliquant ce principe en 1933, que Fred Zwicky compris que la masse des amas Virgo et Coma n'était pas suffisante pour les retenir par leur attraction. Il y aurait 90% de matière noire dans les amas.
La mesure, en rayonnement X, des atomes des gaz chauds (ce qui traduit leur vitesse) contenus dans les amas confirma qu'ils possèdent 10 fois plus de masse cachée.
Les lentilles gravitationnelles, que sont les amas, dévient la lumière d'une source lointaine. Or, l'analyse de cette déviation a permis de confirmer que la masse des amas est 10 fois supérieure.
Mais une autre hypothèse préfère modifier les lois de Newton. La matière noire froide, qui constituerait 90% de la masse totale de l'univers, n'existe pas ! C'est du moins ce que pensent les partisans de la théorie Mond, pour MOdified Newtonian Dynamics. Selon eux, les incohérences des observations astronomiques effectuées ces dernières années ne seraient pas dues à de la matière non lumineuse mais à une modification des célèbres lois de la gravitation. En 1983, Mordehai Milgrom, physicien de l'Institut des sciences Weizmann (Israël) a présenté une alternative à la matière noire en modifiant la loi de la gravitation de Newton, utilisée pour relier les vitesses et les accélérations des étoiles à la masse qui les engendre. Effectivement, la loi de Newton (l'accélération due à une masse M à distance R est a = GM/R2) n'a été réellement testée que sur des distances inférieures ou de l'ordre du parsec (système solaire, amas globulaires). Rien ne dit qu'elle ne dévie pas à grande distance ou pour des accélérations faibles. C'est précisément ce qu'a proposé Milgrom en supposant que l'accélération serait en fait a' = (a.a0)1/2 pour des accélérations newtoniennes très faibles (a << a0) et ne rejoindrait la valeur newtonienne que pour a ~ a0. Cette accélération "critique" a0 serait une nouvelle constante de la nature et Milgrom donne une valeur de 1.10-10 m/s2 (le cent
milliardième de l'attraction terrestre qui est de 9,81 m/s2). Ce modèle, s'il s'avère peu orthodoxe (il remet tout de même en cause les lois de la gravitation), parvient néanmoins à expliquer la vitesse de rotation constante des étoiles dans les galaxies. Une thèse qui n'emporte pas vraiment tous les suffrages. En somme, il existe un tel nombre de variables cosmologiques encore incertaines que beaucoup d'hypothèses restent permises. Néanmoins, peu d'astronomes embrassent la cause de Mond.
Pour en savoir plus:
The Planetary Society: http://planetary.org/programs/projects/pioneer_anomaly/
Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11: http://www.arxiv.org/pdf/gr-qc/0104064
J. D. Anderson et al. "Indication, from Pioneer 10/11, Galileo, and Ulysses Data, of an Apparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration." At
- 28 Aug. 1998 http://www.arxiv.org/abs/gr-qc/9808081L'anomalie Pioneer: http://www.ph.unimelb.edu.au/~foot/pioneer.html
Examen de l'anomalie Pioneer: http://www.geocities. com/solarstormmonitor/Pioneer.html
http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNStat.html
Pioneer 10 Anomalie: http://csep10.phys.utk.edu/newsgroups/mond/messages/22.html
Matière noire et Mond: http://www.infoscience.fr/articles/articles_aff.php3?Ref=502
Moti Milgrom et Mond: http://nedwww.ipac.caltech.edu.level5/Sept01/Milgrom/Milgrom_contents.html
La gravitation temporaliste: http://www.ifrance.com/decalagespectral/mtneuflagravitationtemporaliste.htm
La page de Mond http://www.astro.umd.edu/~ssm/mond/faq.html
Mond
http://members.rogers.com/mercy/
Technical papers:
Study
of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11, by J. D. Anderson et al.
A
mirror world explanation for the Pioneer spacecraft anomalies, by R. Foot
and R. R. Volkas.
Other references:
Shadowlands, quest for mirror matter in the
Universe (Chapter 6).
L'anomalie Pioneer - article d'Alexandre David Szames - Air&Cosmos n° 1946 page 56 et 1993 p 59.
JavaScript DHTML Drop Down Menu By Milonic
|
|
|
|