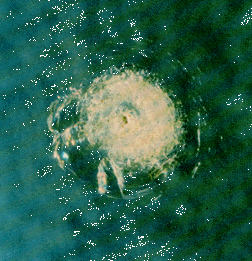|
Voir aussi les images
d'autres études: http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/photogallery/beehives.html#leo
Depuis le lancement par l'URSS de Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, la banlieue de la Terre
s'est remplie en 40 ans, de déchets spatiaux, constitués des débris des fusées ou
autres satellites qui ont pris la route de l'espace depuis cette date. On y trouve aussi
bien des satellites entiers que des fragments issus d'explosions volontaires ou
accidentelles. Les explosions accidentelles sont causées par une défaillance, mais aussi
par le restant des ergols résiduels, se trouvant dans les réservoirs des étages
supérieurs. Soumis à des contraintes thermiques importantes (la mise en rotation sur
eux-mêmes provoquant l' alternance jour/nuit), ils explosent. Les 7 désintégrations des
seconds étages des lanceurs US, Delta, sont responsables d'un tiers des débris des
satellites désintégrés. Elles sont dues à des erreurs de conception des réservoirs de
combustibles, dans lesquels le restant de carburant formait un mélange explosif.
Ainsi ces débris vont des écailles de peintures jusqu'aux vieux satellites ou derniers
étages de lanceurs, en passant par des morceaux de toutes tailles, qui sont des cordons
détonants, des boulons explosifs, des batteries, des mécanismes de séparations,
etc... Il y a même un tourne-vis égaré par un astronaute, lors d'une sortie dans
l'espace. Et il y a sûrement des débris divers (plus de 750 répertoriés), occasionnés
par des essais d'armes anti-satellites (Asat). Puis chaque débris en occasionne d'autres,
lors de percussions entre eux. Il y a un accroissement de 100. Pour 1 g de débris, un
impact en produit 100 g. La population des débris s'auto-alimente. Il se créerait ainsi
plus de débris qu'il ne s'en éliminerait naturellement, par perte d'altitude. Un autre
exemple est celui du ballon Pageos, lâché en 1966, qui continue à perdre le mylar de sa
protection.
La première désintégration détectée fut celle du dernier étage du lanceur de
Transit-4A, moins de 2 heures après un lancement parfaitement réussi. Aucune cause ne
fut trouvée. Une autre désintégration mystérieuse fut celle de Cosmos 1275, 7 semaines
après son lancement. 242 fragments furent détectés, mais leur nombre est certainement
très supérieur.
Récemment furent détectés, sur une orbite de 1000 km, des milliers de débris de 1 à 2
cm, laissés par des satellites Russes chargés d'observations océaniques, Rorsat, qui
furent lancés entre 1972 et 1988. Leurs radars étaient alimentés par des réacteurs
nucléaires. En fin de vie, ils furent envoyés sur cette orbite et les débris seraient
des billes de sodium et de potassium, issues des circuits de refroidissements.
Aux Etats-Unis, le NORAD est chargé de la
surveillance de l'orbite de ces débris. Plus de 8500 objets, dépassant 10 cm, sont
actuellement surveillés, dont 1200 sont situés à plus de 5000 km de la Terre. Sur ces
8500, 94% représentent des débris. De plus entre 50000 et 150000 sont de taille comprise
entre 1 et 10 cm et ils sont des millions pour une taille inférieure. On compte 35
millions pour > 1 mm. Le NORAD dispose de radars et d'un réseau de 7 télescopes
répartis sur l'ensemble des Etats-Unis. Ils permettent de suivre un objet d'un trentaine
de centimètres sur l'orbite géostationnaire. En général, un objet de 2 cm est
détecté à 1600 km. Ainsi début juin 2003, le NORAD a permis de manœuvrer l'ISS
pour éviter une collision avec le micro satellite italien Megsat-0.
 En France, le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) est chargé de cette
surveillance. Une petite équipe, dirigée par Fernand Alby, suit tous les débris
catalogués par le NORAD, qui sont susceptibles de croiser des satellites gérés
par le CNES. Elle surveille leurs orbites et vérifie si elles croisent celles d'un objet
non contrôlé. En cas de risque, les radars de la DGA (Délégation Générale de
l'Armement) sont sollicités pour les confirmer, afin de modifier la trajectoire du
satellite concerné.
En France, le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) est chargé de cette
surveillance. Une petite équipe, dirigée par Fernand Alby, suit tous les débris
catalogués par le NORAD, qui sont susceptibles de croiser des satellites gérés
par le CNES. Elle surveille leurs orbites et vérifie si elles croisent celles d'un objet
non contrôlé. En cas de risque, les radars de la DGA (Délégation Générale de
l'Armement) sont sollicités pour les confirmer, afin de modifier la trajectoire du
satellite concerné.
Le
CNES effectue aussi des études dans le domaine optique, qui est la seule méthode
d'étude des satellites en orbite géostationnaire. Cette étude se fait au travers d'une
collaboration avec l'observatoire de la Côte d'Azur, doit voici un exemple de résultat.
 Les astronomes sont aussi concernés, car, chaque nuit, pendant les
pauses très longues, ils voient apparaître sur leurs photographies un ou plusieurs
traits, dégradant sérieusement la photo.
Les astronomes sont aussi concernés, car, chaque nuit, pendant les
pauses très longues, ils voient apparaître sur leurs photographies un ou plusieurs
traits, dégradant sérieusement la photo.
Quant aux satellites automatiques, un certain nombre ont déjà été détruits par un
débris. Jusqu'à présent, la seule collision
enregistrée remonte au 24 juillet 1996, lorsqu'un fragment du 3ième étage d'Ariane 4,
qui avait lancé Spot 1 en 1986, heurta le satellite militaire français, Cerise, à
la vitesse de 14 km/s. Cerise avait était largué en même temps que le satellite Hélios
1A, le 7 juillet 1995. Sous le choc, son mât de stabilisation fut arraché. C'est un
radar anglais qui a repéré la déstabilisation de Cerise. Plus tard le réseau de
surveillance américain découvrira un nouvel objet. Depuis sur les cartes, il figure sous
la dénomination: "mât Cerise". Il faut savoir, par exemple, qu'une bille d'
aluminium de 1 mm à la vitesse de 10 km/s, à la même énergie cinétique qu'une balle
de fusil. Au delà de 1 cm, rien ne résiste. Pour mieux faire comprendre, un objet de 3
mm à une énergie correspondante à un coffre-fort tombant d'une hauteur de 30 m.
Les déchets deviennent un problème préoccupant. Ils sont la principale source
d'accidents pour les engins spatiaux. Les astronautes risquent, eux aussi,
leur vie, car un débris peut percer leur scaphandre lorsqu'ils iront travailler
dans l'espace ou bien les vitres de leur station. En juillet 1982, la station
orbitale soviétique, Saliout 7, fut percutée par un débris dont la taille
était très inférieure à 1 mm. Il laissa une trace de 4 mm sur une des
fenêtres de la station. D'autre part, en 1991, la Navette Discovery fut
obligée d'entreprendre une manœuvre d'évitement afin de s'éloigner d'un
3ième étage d'une fusée Russe. Il en fut de même en 1992, pour un débris de
plus de 10 cm. Le 12 janvier 1996, la Navette Endeavour a dû dévier sa route
précipitamment pour éviter un vieux satellite 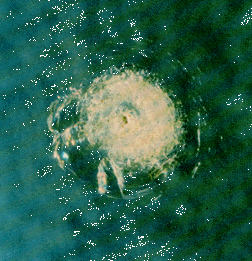 militaire américain.
Heureusement, les consignes sont strictes et les navettes ne doivent pas passer
à moins de 1 mille (1852 m) d'un objet. Une navette est revenue sur Terre avec
un impact sur un hublot. Depuis, les navettes n'ont plus de verrière. Un
blindage remplage les hublots. Ces manœuvres n'auraient pas été possibles sans le réseau de
surveillance des USA, avec notamment, un super télescope à miroir de mercure liquide,
installé à Cloudcroft (Nouveau-Mexique). Il est capable de distinguer des objets de 1 cm
passant à sa verticale. L'ESA (Agence Spatiale Européenne) va mettre en place aux
Canaries, un nouveau télescope muni d'une caméra CCD de 4096 X 4096 pxl, dans le but de
poursuivre les débris. Il aura une précision de 2 à 6 cm sur l'orbite basse et 10 à 30
cm pour l'orbite géostationnaire. militaire américain.
Heureusement, les consignes sont strictes et les navettes ne doivent pas passer
à moins de 1 mille (1852 m) d'un objet. Une navette est revenue sur Terre avec
un impact sur un hublot. Depuis, les navettes n'ont plus de verrière. Un
blindage remplage les hublots. Ces manœuvres n'auraient pas été possibles sans le réseau de
surveillance des USA, avec notamment, un super télescope à miroir de mercure liquide,
installé à Cloudcroft (Nouveau-Mexique). Il est capable de distinguer des objets de 1 cm
passant à sa verticale. L'ESA (Agence Spatiale Européenne) va mettre en place aux
Canaries, un nouveau télescope muni d'une caméra CCD de 4096 X 4096 pxl, dans le but de
poursuivre les débris. Il aura une précision de 2 à 6 cm sur l'orbite basse et 10 à 30
cm pour l'orbite géostationnaire.
Ce
trou de 4 mm dans le pare-brise de la Navette Spatiale (image ci-contre)
a été créé par un petit débris estimé à 0,2 mm qui se déplaçait
entre 3 et 6 km/s.
Les débris
spatiaux se meuvent à des vitesses très élevées. A moins de 2 000 km
d'altitude l'impact se fait à 10 km/s. A cette vitesse la moindre
particule devient une balle de fusil qui contient des quantités significatives d'énergie et
de moments cinétiques. Par exemple, la NASA remplace fréquemment des
hublots de la navette spatiale parce qu'ils sont sensiblement endommagés par des objets aussi petits
qu'une écaille de peinture. Une bille en aluminium de 1,3 millimètres de diamètre
possède un potentiel de destruction semblable à celui d'une balle de fusil de
22 long rifle. Une bille en aluminium de 1 centimètre de diamètre est comparable à
un déplacement d'une masse de 500 g à 100 km/h et un morceau de 10 cm
de long est comparable à 25 bâtons de dynamite.
S'en
débarasser
Mais comment se débarrasser des milliers de déchets (environ 100.000 soit environ 2.500 tonnes d'objets métalliques
) ? 7000 engins spatiaux tournent depuis 1957, au-dessus de nos têtes
et risquent d'endommager les engins spatiaux qui nous sont devenus indispensables.
Cela va de fragments de peinture de fusées de la taille de têtes d'épingle à des
satellites entiers, vieux ou hors d'usage. Lors du vol n°7 de la Navette, une écaille de
peinture créa un cratère de 4 mm un hublot. L'on a apprit, lors de la
première réunion européenne sur ce problème, à Darmstadt début avril 92, qu'au cours
des 40 premiers vol de la Navette, les hublots avaient subi 40 impacts de
micro-météorites d'origines artificielles. La question se pose avec d'autant plus de
raison, que chaque jour de nouveaux engins décollent. Les risques de collision sont
grandissants, si rien n'est fait. Déjà des mesures sont prises en ce qui concerne
les ergols restants. Les réservoirs seront vidangés et les vannes de pressurisation,
ouvertes. Quant à accroître le blindage, il augmente la masse au décollage, oblige à
modifier le lanceur ou bien à diminuer la charge utile en orbite, tout en augmentant les
coûts.
Les aspects scientifiques, techniques et juridiques sont à prendre en compte.
Juridiquement des idées commencent à germer et il ressort que les débris spatiaux
doivent être traités comme l'un des aspects de la protection de l'environnement spatial.
Toutes les mesures concevables de prévention, réduction et enlèvement des débris
doivent être prises en compte, avec toutefois une préférence pour les mesures
préventives. Aujourd'hui, la forme à donner à de telles mesures est à l'étude et
naturellement, les opinions divergent. Dans quelle législation les faire entrer ? Et
comment définir la notion de débris et bien sûr, de responsabilités ? Que faire des
débris de satellites possédant un générateur isotopique ? L'exemple de Cosmos
954, qui s'est écrasé au Nord du Canada en janvier 1978, a provoqué beaucoup
d'inquiétude. Selon le CNES, un satellite retombe sur Terre chaque semaine (en moyenne).
Dix jours avant sa chute, on arrive à connaître le jour fatal. La veille de celui-ci, on
connaît l'orbite sur laquelle se trouvera l'engin lors de son entrée dans l'atmosphère.
Il restera au final une incertitude de 2 000 à 3 000 km sur le point de chute. Cette
incertitude n'est pas due à une mauvaise modélisation des mécanismes de rentrée dans
l'atmosphère, mais à une mauvaise connaissance de la position de l'engin (ou du débris)
sur son orbite . A ce problème s'ajoute la faible connaissance de l'atmosphère entre 80
et 100 km d'altitude. Lorsqu'un satellite rentre dans l'atmosphère, il se consume en
grande partie. Les morceaux qui atteignent le sol sont des parties très denses de l'engin
ou des parties protégées par la structure de l'objet.
Or, ce problème revient régulièrement tous les ans, au cours de discutions
internationales au sein du Comité de coordination inter-agences pour les débris spatiaux
(IADC). La principale difficulté vient du fait que la mise en application de règles
communes peut être déterminante sur les coûts dans ce secteur qui se fragmente et où
la concurrence est très exacerbée. Déjà, les USA ont dit qu'ils ne voulaient pas de
régulations qui restreindraient leurs intérêts. L'accord global sera difficile à
obtenir. En ne le respectant pas, un état pourra bénéficier d'un avantage certain,
puisqu'il sera pénalisant pour les autres.
Néanmoins des solutions sont envisagées. Par exemple, en ce qui concerne les satellites
qui sont à 36000 km (450 sont actuellement dénombrés), sur l'orbite géostationnaire et
en fin de carrière, une orbite cimetière pourrait être instaurée à 400 km au-dessus.
En effet, la vitesse y est très faible et la durée de vie pratiquement infinie. Les
risques de collisions y sont presque nuls, même ils sont presque sans risque. Cette
mesure est déjà en application, pour certains. Mais le problème est de prévoir avec
exactitude la fin de vie, afin qu'il reste juste assez de carburant pour la propulsion sur
l'orbite de parking. Les difficultés sont plus importantes pour les orbites
inférieures à 2000 km. Si on laisse la gravitation agir, il faut attendre quelques
mois à 200 km, plusieurs siècles entre 400 et 900 km et des millions d'années sur
l'orbite géostationnaire. La rentrée dans l'atmosphère, bien que possible, est
coûteuse et complexe. Un satellite emporte en général 1,5 tonnes de carburant servant
en grande partie pour la mise en orbite et le reste sert aux corrections d'attitude. Un
freinage pour désorbiter, nécessite quelques 10% de la quantité emportée. On se trouve
à la limite de la faisabilité économique.
Et si on cherche une orbite cimetière, laquelle prendre ? L'augmentation des
constellations de satellites de télécommunications, placés à 700 km, ne fait que
commencer. Un projet de Bill Gates prévoit 840 satellites. Le problème va devenir
crucial.
Pour ne pas sombrer dans le pessimisme, il faut aussi savoir que les estimations actuelles
montrent que la station Alpha, en orbite basse, pourrait recevoir un impact de 1 cm tous
les 200 ans. Ce n'est qu'une statistique....
Informations du NORAD
Current Catalog Status Summary
Satellites
|
Sondes
|
Debris
|
Total
|
2629
|
90
|
6012
|
8731
|
Définitions:
-
Satellite -
toute charge (opérationnelle ou non
opérationnelle) mise en orbite autour
de la Terre.
-
ESV=Earth Space Vehicle -
objets en orbite autour de la Terre.
-
Sondes
- Toute
charge lancée en dehors de l'orbite terrestre.
-
Débris
- tout
autre objet fait par
l'homme, en orbite autour de la Terre.
-
IC=International Consortium -
Une association d'entreprises,
de corporations, de gouvernements, etc... sans spécifications de pays
d'origine.
Pays
|
Satellites
|
Sondes
|
Débris
|
Total
|
USA
|
722
|
46
|
2930
|
3798
|
CIS
|
1335
|
35
|
2565
|
3935
|
ESA
|
23
|
2
|
232
|
257
|
PRC
|
26
|
0
|
102
|
128
|
JAPAN
|
65
|
4
|
52
|
121
|
IRIDIUM
|
88
|
0
|
0
|
88
|
INTL
TELECOM
SAT ORG
|
56
|
0
|
0
|
56
|
FRANCE
|
29
|
0
|
17
|
46
|
GLOBALSTAR
|
44
|
0
|
0
|
44
|
ORBCOM
|
28
|
0
|
0
|
28
|
INDIA
|
19
|
0
|
4
|
23
|
UNITED KINGDOM
|
17
|
0
|
1
|
18
|
CANADA
|
16
|
0
|
1
|
17
|
EUR TELECOM
SAT ORG
|
15
|
0
|
0
|
15
|
GERMANY
|
13
|
2
|
1
|
16
|
ITALY
|
8
|
0
|
3
|
11
|
INTL MARITIME
|
9
|
0
|
0
|
9
|
AUSTRALIA
|
7
|
0
|
2
|
9
|
INDONESIA
|
9
|
0
|
0
|
9
|
LUXEMBOURG
|
9
|
0
|
0
|
9
|
BRAZIL
|
9
|
0
|
0
|
9
|
NATO
|
8
|
0
|
0
|
8
|
SWEDEN
|
8
|
0
|
0
|
8
|
ARAB SATELLITE
COMM ORG
|
7
|
0
|
0
|
7
|
MEXICO
|
6
|
0
|
0
|
6
|
SOUTH KOREA
|
6
|
0
|
0
|
6
|
SPAIN
|
5
|
0
|
0
|
5
|
ARGENTINA
|
4
|
0
|
0
|
4
|
CZECH REPUBLIC
|
4
|
0
|
0
|
4
|
THAILAND
|
4
|
0
|
0
|
4
|
FGER
|
3
|
0
|
0
|
3
|
ASIASAT CORP
|
3
|
0
|
0
|
3
|
NORWAY
|
3
|
0
|
0
|
3
|
ISRAEL
|
3
|
0
|
0
|
3
|
SEAL
|
1
|
0
|
2
|
3
|
MALAYSIA
|
2
|
0
|
0
|
2
|
REPUBLIC OF
PHILIPPINES
|
2
|
0
|
0
|
2
|
TURKEY
|
2
|
0
|
0
|
2
|
FRG
|
2
|
0
|
0
|
2
|
PORTUGAL
|
1
|
0
|
0
|
1
|
EGYPT
|
1
|
0
|
0
|
1
|
CHILE
|
1
|
0
|
0
|
1
|
STCT
|
1
|
0
|
0
|
1
|
ISS
|
1
|
0
|
0
|
1
|
ROC
|
1
|
0
|
0
|
1
|
DEN
|
1
|
0
|
0
|
1
|
SAFR
|
1
|
0
|
0
|
1
|
CHBZ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Historical Catalog Status
Payload
Decayed
|
Debris
Decayed
|
TOTAL
|
2506
|
14,712
|
17,218
|
Satellites Cataloged
|
SSC NO
|
INTL DES
|
COUNTRY
|
COMMON NAME & TYPE
|
LAUNCH DATE
|
|
25953
|
1999-054E
|
CIS
|
RESURS DEBRIS
|
28 SEP 99
|
|
25954
|
1999-060A
|
USA
|
GE 4
|
14 NOV 99
|
|
25955
|
1999-060B
|
ESA
|
ARIANE 44LP R/B
|
14 NOV 99
|
Decayed Objects
SSC NO
|
INTL DES
|
COUNTRY
|
COMMON NAME & TYPE
|
DECAY DATE
|
12134
|
1981-002B
|
CIS
|
SL-6 R/B (2)
|
23 OCT 99
|
24744
|
1997-010A
|
CIS
|
ZEYA
|
25 OCT 99
|
25500
|
1998-025F
|
CIS
|
SL-12 R/B (AUX MOTOR)
|
23 OCT 99
|
25550
|
1998-069B
|
ARGN
|
SAC A
|
25 OCT 99
|
25917
|
1999-048E
|
CIS
|
FOTON 12 DEBRIS
|
23 OCT 99
|
25921
|
1999-051C
|
USA
|
ATHENA R/B (2) DÉBRIS
|
25 OCT 99
|
25929
|
1999-054A
|
CIS
|
RESURS F-1M
|
22 OCT 99
|
25951
|
1999-054C
|
CIS
|
RESURS DEBRIS
|
23 OCT 99
|
25952
|
1999-054D
|
CIS
|
RESURS DEBRIS
|
22 OCT 99
|
5533
|
1971-015BX
|
CIS
|
COCMOC 397 DEBRIS
|
30 OCT 99
|
24862
|
1997-028E
|
CIS
|
SL-12 R/B (AUX MOTOR)
|
1 NOV 99
|
25507
|
1998-060C
|
USA
|
PEGASUS DEBRIS
|
29 OCT 99
|
25953
|
1999-054E
|
CIS
|
RESURS DEBRIS
|
31 OCT 99
|
7944
|
1972-058CK
|
USA
|
DELTA 1 DEBRIS
|
6 NOV 99
|
18128
|
1987-053C
|
USA
|
DMSP F8 DEBRIS
|
4 NOV 99
|
24196
|
1994-029JX
|
USA
|
PEGASUS DEBRIS
|
7 NOV 99
|
24972
|
1997-057B
|
IND
|
PSLV 1C R/B
|
4 NOV 99
|
24993
|
1994-029ADA
|
USA
|
PEGASUS DEBRIS
|
7 NOV 99
|
4222
|
1969-097B
|
USA
|
SCOUT B R/B
|
15 NOV 99
|
24266
|
1994-029MR
|
USA
|
PEGASUS DEBRIS
|
13 NOV 99
|
24291
|
1996-050A
|
ARGN
|
MICROSAT
|
12 NOV 99
|
25208
|
1987-068AK
|
CIS
|
SL-14 DEBRIS
|
11 NOV 99
|
Information provided as a service by
Public Affairs, United States Space Command. Contents of this report reflect current
information available at the time of request but are not necessarily the official tally
endorsed by the United States Space Command. The United States Government, the Department
of Defense, United States Space Command and its component commands and their employees
will not be liable in any manner for any claim or loss attributed to reliance upon the
accuracy of the data provided.
This Page Last Edited: 18 NOV 1999
à lire notamment: C&E no 326 - 299 - les docs de l'ESA et du
CNES.
Débris spatiaux à la NASA: http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/
L'ESA et les débris: http://www.esoc.esa.de/external/mso/debris.html
Le CNES s'est spécialisé dans les débris: http://www.cnes.fr/html/_115_248_257_.php
Le NORAD poursuit tous les objets autour de la Terre: http://celestrak.com/NORAD/elements/
Agence internationale des débris spatiaux: http://www.iadc-online.org/
Liste de liens sur les débris: http://www.spaceref.com/directory/astronautics/space_debris/
Débris spatiaux, les bases: http://www.aero.org/cords/orbdebris.html
|


 En France, le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) est chargé de cette
surveillance. Une petite équipe, dirigée par Fernand Alby, suit tous les débris
catalogués par le NORAD, qui sont susceptibles de croiser des satellites gérés
par le CNES. Elle surveille leurs orbites et vérifie si elles croisent celles d'un objet
non contrôlé. En cas de risque, les radars de la DGA (Délégation Générale de
l'Armement) sont sollicités pour les confirmer, afin de modifier la trajectoire du
satellite concerné.
En France, le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) est chargé de cette
surveillance. Une petite équipe, dirigée par Fernand Alby, suit tous les débris
catalogués par le NORAD, qui sont susceptibles de croiser des satellites gérés
par le CNES. Elle surveille leurs orbites et vérifie si elles croisent celles d'un objet
non contrôlé. En cas de risque, les radars de la DGA (Délégation Générale de
l'Armement) sont sollicités pour les confirmer, afin de modifier la trajectoire du
satellite concerné.
 Les astronomes sont aussi concernés, car, chaque nuit, pendant les
pauses très longues, ils voient apparaître sur leurs photographies un ou plusieurs
traits, dégradant sérieusement la photo.
Les astronomes sont aussi concernés, car, chaque nuit, pendant les
pauses très longues, ils voient apparaître sur leurs photographies un ou plusieurs
traits, dégradant sérieusement la photo.