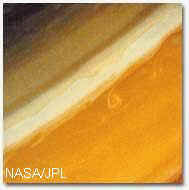|
|
|
http://perso.wanadoo.fr/daniel.villafruela/dictionnaire/A/ammoniaque.htm
|
Ammoniac: c'est un gaz NH3 |
|
Ammoniaque: |
-
Mythologie et histoire
Les plus vieux écrits relatifs à Saturne seraient attribués aux Assyriens environ 700 ans BC (before Christi, avant J.C.) décrivant la planète aux anneaux comme un éclat dans la nuit et l'appelèrent "étoile de Ninib".
Les Assyriens, qui occupaient l'Irak, prospérèrent de 1 200 à 620 ans BC. Issus de la culture babylonienne, une civilisation avec des yeux faits pour l'astronomie. Les historiens pensent que 3 000 ans BC, les babyloniens avaient inventés la majorité des constellations (signe du zodiaque) et peut-être développés un calendrier marquant les principaux événements astronomiques.
 Quelques siècles plus tard, 400 ans BC, les grecs anciens, baptisèrent ce
qu'ils pensaient être une étoile vagabonde, Kronos ou Cronos. Cronos était le roi des Titans,
qui étaient les fils d'Ouranos (Uranus) et de Gaïa
(Terre). Il épousa sa soeur
Rhéa et ils eurent un enfant Zeus (ne pas
confondre avec Chronos la personnification du temps). Zeus le renversera pour
régner sur les dieux. Cronos est souvent représenté par
un vieillard courbé sous le poids des ans, tenant une
faux et chez
les grecs il était le dieu de l'agriculture.
Les Romains, qui adaptèrent leur
culture sur celle des Grecs, changèrent le nom du Seigneur des anneaux en
Saturnus qui est la racine de Saturne.
C'est ainsi que Saturne devint le
dieu de l'agriculture chez les romains. C'est en son honneur que les saturnales
de la mythologie romaine étaient célébrées en décembre, des festivités les
plus populaires qui duraient 7 jours. Dans l'iconographie mythologique Cronos
est représenté
Quelques siècles plus tard, 400 ans BC, les grecs anciens, baptisèrent ce
qu'ils pensaient être une étoile vagabonde, Kronos ou Cronos. Cronos était le roi des Titans,
qui étaient les fils d'Ouranos (Uranus) et de Gaïa
(Terre). Il épousa sa soeur
Rhéa et ils eurent un enfant Zeus (ne pas
confondre avec Chronos la personnification du temps). Zeus le renversera pour
régner sur les dieux. Cronos est souvent représenté par
un vieillard courbé sous le poids des ans, tenant une
faux et chez
les grecs il était le dieu de l'agriculture.
Les Romains, qui adaptèrent leur
culture sur celle des Grecs, changèrent le nom du Seigneur des anneaux en
Saturnus qui est la racine de Saturne.
C'est ainsi que Saturne devint le
dieu de l'agriculture chez les romains. C'est en son honneur que les saturnales
de la mythologie romaine étaient célébrées en décembre, des festivités les
plus populaires qui duraient 7 jours. Dans l'iconographie mythologique Cronos
est représenté
http://www.pegue.com/grecia/cronos.jpg
-
Observations terrestres
Autrefois, seuls quelques détails et les anneaux pouvaient être observés. En raison de la présence de l'atmosphère terrestre, il était impossible d'observer l'atmosphère de Saturne, ainsi que les satellites qui échappèrent à l'observation. Seule l'exploration spatiale a permis d'accroître leur nombre. Aujourd'hui, les grands télescopes sont équipés de compensation de la turbulence atmosphérique qui augmente la qualité des images. C'est ainsi qu'avec le VLT (Very Large Telescope) européen, les scientifiques obtiennent des images identiques sinon meilleures à celles du HST (Hubble Space Telescope). A partir du 1 juillet 2004, la sonde Cassini va nous révéler ce monde lointain et mystérieux.
Mais les observations terrestres resteront toujours indispensables pour nous permettre de voir l'évolution à long terme et pour étudier les variations très lentes comme la structure nuageuse ou l'activité radioélectrique.
Pour une observation en amateur, il faut au moins une lunette de 60 mm avec un grossissement de 100. Avec un instrument de 80 mm, il sera possible de voir la différence d'éclat entre les anneaux A et B. Avec un instrument de 100 mm, la division Cassini, l'anneau C, l'ombre des anneaux sur la planète et l'ombre de Saturne sur certaines portions d'anneaux seront visibles. Avec un 150 mm les bandes nuageuses sont accessibles.
Quant aux satellites, Titan sera visible dans une petite lunette de 50 mm, Japet et Rhéa avec 80 mm. Pour Téthys et Dioné, un petit télescope devient utile. Les autres satellites sont inaccessible dans un instrument d'amateur.
-
Pères de lunette
Au cours du millénaire qui suivit la domination romaine, la connaissance de Saturne ne changea guère et la planète fut considérée comme une étoile vagabonde jusqu'à l'invention de la lunette. Elle aurait été découverte en Hollande. Ce nouvel instrument révolutionna rapidement l'astronomie. La légende attribue l'invention de la lunette à Galilée, mais en réalité elle semble avoir eu avoir plusieurs pères comme le raconte Albert Ducrocq dans son livre "A la recherche d'une vie sur Mars" chez Flammarion (1976) Page 10 dont voici l'extrait d'une paternité:
"Selon P. Borel, auteur de "De vero telescope inventore" paru en 1660, c'est vers 1590 que la lunette aurait été découverte par hasard par les 2 enfants de Zacharie Jansen qui jouaient avec des bésicles à Middlebourg. A un certain moment, en jouant avec les 2 lentilles, l'un des 2 aurait vu le coq du clocher plus gros. Ils en auraient fait part à leur père qui construisit la première lunette. Il garda le secret jusqu'à ce que un concurrent, un certain Hans Lippershey (1570 - 1619), s'en empara. Ce dernier prit un brevet en octobre 1608 et mit la lunette dans le domaine publique."
Voici une autre version:
En octobre 1608, les états généraux (le gouvernement national) de la Haye ont discuté des demandes de brevet, d'abord de Hans Lipperhey de Middelburg, puis de Jacob Metius d'Alkmaar, sur un dispositif pour " voir des choses lointaines comme si nous étions tout proches." Il était composé d'un objectif convexe et concave dans un tube et la combinaison a permis de grossir de trois ou quatre fois. Les juges ont trouvé le dispositif trop facile à copier pour attribuer le brevet, mais ils ont voté une petite récompense à Metius et ont utilisé Lipperhey pour faire plusieurs versions binoculaires, lesquelles lui furent bien payé. Il s'avèra qu'un autre citoyen de Middelburg, Zacharie Janssen a eu un télescope à peu près identique au même moment, mais il était à Francfort à ce moment-là pour essayer de le vendre.
Ci-contre, le plus ancien dessin d'un télescope. Ce schéma de Giovanpattista
della Porta a été inclus dans une ![]() lettre qu'il a écrite en
août de 1609.
lettre qu'il a écrite en
août de 1609.
http://galileo.rice.edu/images/things/porta_sketch.gif
-
Histoire des lunettes
Dans la littérature
traitant de magie blanche, si populaire au seizième siècle, il y a plusieurs références
aux dispositifs permettant de voir l'ennemi ou de compter des pièces de monnaie
à distance. Mais ces allusions ont été écrites dans un langage obscur et ont été
accompagnées de revendications incroyables; le télescope, quand il fut
inventé, était un instrument très simpliste. Il est possible qu'en
1570, Leonard et Thomas Digges
aient fait réellement un instrument se composant d'un objectif convexe et d'un miroir,
mais si ceci s'avère être le cas, c'était une installation expérimentale qui n'a
jamais été traduite en instrument produit en série.
-
La lunette et Galilée
Voici les 2 lunettes de Galilée qui se trouvent aujourd'hui au Musée de l'histoire des sciences à Florence en Italie, répertoriées sous les numéros 2427 et 2428. Ce sont les lunettes originales fabriquées par Galilée, fin 1609/début 1610. L'attribution à Galilée est due au fait qu'elles ont des éléments typiques aux télescopes galiléens, caractérisés par un oculaire concave, que le scientifique de Pise a fabriqués en grands nombres, particulièrement entre 1610 et 1640.
 L' instrument du haut, numéroté 2428 est
composé d'un tube où aux extrémités desquelles ont été insérées 2
parties séparées qui portent l'une l'objectif et l'autre l'oculaire. Le
tube de bois qui unit les 2 parties est recouvert de cuir rouge (devenu
marron avec le temps) décoré de motifs en or. L'objectif, plano-
convexe, dont la partie convexe se trouve à l'extérieur, mesure 37 mm de
diamètre, possède une ouverture de 15 mm et une distance focale de 980
mm pour une épaisseur au centre
de 2 mm. L'oculaire original a été perdu et remplacé en 1800 par un
oculaire biconcave de 22 mm de diamètre, épaisseur 1,8 mm au centre, une
distance focale de - 47,5 mm (le signe négatif indique une lentille
divergente). La lunette a un grossissement de 21 pour un champ de vision
de 15 mn d'arc. Cette lunette a été enregistrée dans l'inventaire de
1704 à la galerie d'Uffizi comme "télescope de Galilée d'une
longueur de 1,66 bras (973 mm) en deux morceaux afin de le rallonger,
couvert de cuir décoré de motifs en or, avec 2 lentilles dans un tube
dont l'oculaire est courbe": par conséquent l'oculaire est immobile,
mais libre dans le tube. Les traces de l' oculaire original ont
été perdues à la fin 18e siècle.
L' instrument du haut, numéroté 2428 est
composé d'un tube où aux extrémités desquelles ont été insérées 2
parties séparées qui portent l'une l'objectif et l'autre l'oculaire. Le
tube de bois qui unit les 2 parties est recouvert de cuir rouge (devenu
marron avec le temps) décoré de motifs en or. L'objectif, plano-
convexe, dont la partie convexe se trouve à l'extérieur, mesure 37 mm de
diamètre, possède une ouverture de 15 mm et une distance focale de 980
mm pour une épaisseur au centre
de 2 mm. L'oculaire original a été perdu et remplacé en 1800 par un
oculaire biconcave de 22 mm de diamètre, épaisseur 1,8 mm au centre, une
distance focale de - 47,5 mm (le signe négatif indique une lentille
divergente). La lunette a un grossissement de 21 pour un champ de vision
de 15 mn d'arc. Cette lunette a été enregistrée dans l'inventaire de
1704 à la galerie d'Uffizi comme "télescope de Galilée d'une
longueur de 1,66 bras (973 mm) en deux morceaux afin de le rallonger,
couvert de cuir décoré de motifs en or, avec 2 lentilles dans un tube
dont l'oculaire est courbe": par conséquent l'oculaire est immobile,
mais libre dans le tube. Les traces de l' oculaire original ont
été perdues à la fin 18e siècle.
L'instrument du bas, numéroté 2427, consiste en un tube principal avec 2 lentilles à chaque extrémité: l'une, l'objectif et l'autre l'oculaire. Le tube principal, fait de 2 demis tubes tenus ensemble par un filetage en cuivre, est recouvert de papier. L'objectif biconvexe, mesure 51 mm de diamètre et le rayon de courbure des 2 faces n'est pas égal. La distance focale est 1330 mm, l'épaisseur au centre est de 2,5 mm. L'oculaire est plano-concave et mesure 26 mm de diamètre. Le côté concave se trouve vers l'oeil et possède un rayon de courbure de 48,5 mm. L'épaisseur au centre est de 3 mm. La distance focale est de - 94 mm (le signe négatif signifie que la lentille est divergente). Le grossissement est de 14 et l'angle de champ de 15 mn d'arc.
Le prince Federico Cesi,
fondateur de l'académie de Leici, propose en 1611 d'appeler
"télescope" (du grec tele: loin et scopeo: vue) ces
instruments. Mais aujourd'hui, par rapport aux instruments que nous
appelons de ce nom, il est préférable de parler de lunettes.
http://vitruvio.imss.fi.it/foto/luoghi/percorsi/astronom/cap8_02rs.jpg
-
Galiléo Galilei, dit Galilée (1564 - 1642)
http://www.windandweather.com/graphics/insights/galilei.jpg
 Galiléo Galiléi
(ci-contre), plus connu sous le surnom de Galilée, est né
à Pise le 15 février 1564. Galilée
Galiléo Galiléi
(ci-contre), plus connu sous le surnom de Galilée, est né
à Pise le 15 février 1564. Galilée était le fils de Vincenzo Galilei (1520 - 1591), un musicien érudit et
de Giulia
Ammannati (1538-1620). Il étudia à l'université de Pise où il tint
la chaire de mathématiques de 1589 à 1592. Il fut ensuite appointé à
la chaire de mathématiques de Padoue où il resta jusqu'en 1610. Durant
ces années il fit des recherches en mécanique, construisit un thermoscope
(avant d'être gradué, un thermomètre n'est qu'un vulgaire thermoscope)
et un microscope. Il inventa le compas militaire. En 1610, il est nommé
premier mathématicien du Grand Duché et de l'université de Pise. En
1612, des objections sur ses théories commencèrent à se faire entendre
et en 1616, Galilée est admonesté par le cardinal Bellarmino (image
ci-contre). Il est incompris pat l'Eglise. En 1632,
après la publication de Dialogo sopra i
Massimi sistemi, Galilée fut condamné par le Saint Office et obligé
d'abjurer ses positions. Il s'est retiré à Arcetri, où il est mort en 1642.
était le fils de Vincenzo Galilei (1520 - 1591), un musicien érudit et
de Giulia
Ammannati (1538-1620). Il étudia à l'université de Pise où il tint
la chaire de mathématiques de 1589 à 1592. Il fut ensuite appointé à
la chaire de mathématiques de Padoue où il resta jusqu'en 1610. Durant
ces années il fit des recherches en mécanique, construisit un thermoscope
(avant d'être gradué, un thermomètre n'est qu'un vulgaire thermoscope)
et un microscope. Il inventa le compas militaire. En 1610, il est nommé
premier mathématicien du Grand Duché et de l'université de Pise. En
1612, des objections sur ses théories commencèrent à se faire entendre
et en 1616, Galilée est admonesté par le cardinal Bellarmino (image
ci-contre). Il est incompris pat l'Eglise. En 1632,
après la publication de Dialogo sopra i
Massimi sistemi, Galilée fut condamné par le Saint Office et obligé
d'abjurer ses positions. Il s'est retiré à Arcetri, où il est mort en 1642.
Après
avoir
entendu parler de la lunette hollandaise par des commerçants vénitiens, il s'en
procura une
et la rapporta en Italie. Il l'adapta et on raconte qu'il fut le premier à
la
diriger vers le ciel, en 1610.
Elle devint alors la première lunette astronomique avec laquelle il
découvrit la Lune et ses montagnes, les phases de Vénus, Jupiter et ses
satellites et l'anneau de Saturne. Bien que rudimentaire, avec un grossissement de
14,
il repéra quelque chose d'inattendu autour de Saturne, des excroissances
(croquis de droite). Galilée ne pouvait pas
dire ce qui n'allait pas, il ne pouvait que donner une réponse erronée. Il pensa tout d'abord être en
présence d'un groupe de 3 planètes étroitement liées dont les 2 plus
petites
se trouvaient de part et d'autre de Saturne, beaucoup plus grosse. Deux ans plus
tard, l'aspect changeant l'a dérouté. Les 2 petites planètes avaient
disparues et Saturne était seule. Galilée a écrit qu'il fut étonné par ce
trouvaient de part et d'autre de Saturne, beaucoup plus grosse. Deux ans plus
tard, l'aspect changeant l'a dérouté. Les 2 petites planètes avaient
disparues et Saturne était seule. Galilée a écrit qu'il fut étonné par ce  phénomène. Nous savons aujourd'hui que les anneaux (image de gauche) semblent disparaître par
suite de l'obliquité de Saturne et du plan de rotation des orbites terrestre et de Saturne. Lorsque
l'anneau est vu dans le plan, il est invisible tellement il est fin. Quelques
années plus tard, Galilée retrouva la vision de ses premières observations ce
qui le perturba davantage. Il l'appela:"la planète aux triples
corps".
phénomène. Nous savons aujourd'hui que les anneaux (image de gauche) semblent disparaître par
suite de l'obliquité de Saturne et du plan de rotation des orbites terrestre et de Saturne. Lorsque
l'anneau est vu dans le plan, il est invisible tellement il est fin. Quelques
années plus tard, Galilée retrouva la vision de ses premières observations ce
qui le perturba davantage. Il l'appela:"la planète aux triples
corps".
Variation
du plan des anneaux: http://saturn.jpl.nasa.gov/news/features/saturn-story/images/saturn-seasons.jpg
Saturne vue par Galilée: http://vitruvio.imss.fi.it/foto/luoghi/percorsi/astronom/cap8_08rs.jpg
http://vitruvio.imss.fi.it/foto/luoghi/percorsi/astronom/cap8_01rs.jpg
Le 25 août 1609, Galilée présentait au sénat vénitien, la lunette comme sa propre invention. Le succès fut énorme et immédiat . Il obtint un contrat de longue durée à l'université de Padoue, mais il s'attira des ennemis quand on apprit qu'il n'était pas l'inventeur original.
-
Galilée et les anagrammes
Galilée a publié, en latin, des résultats de ses observations dans Sidereus Nuncius (le messager des étoiles) dans le langage scientifique de l'époque. Il y révélait les montagnes de la Lune, les phases de Vénus, le catalogue des étoiles nouvelles qu'il est le premier à voir, les satellites de Jupiter. Mais il voulut que ses découvertes soient distillées très lentement et surtout, être certain que la paternité ne puisse pas lui être retirée. Pour cela, il coda ses révélations avec des anagrammes. C'était très courant à l'époque. Une anagramme est un mot ou une phrase réordonnée à partir des lettres d'un autre mot ou d'une autre phrase: langage et glanage, virtuelles et téléviseur, attention et tentation. Cela piquait la curiosité des lecteurs et augmentait l'impact de la découverte. Le temps que mettaient ses lecteurs à décoder ses phrases, lui permettait d'en affiner l'observation, tout en étant certain d'en conserver la paternité. D'autre part, la découverte était réservée à une élite capable de déchiffrer son message. Mais parfois, cette méthode avait ses limites en emmenant le lecteur sur de fausses pistes car, par définition, la chose découverte est inconnue de tous, ce qui limite la réflexion.
Sa méthode était compliquée. Il cachait sa découverte derrière 2 écrans. Il changeait le sens en interposant des périphrases mythologiques et ensuite il superposait 3 isotopies (construction du sens): le sens immédiat, le sens mythologique résultant de permutation des lettres, le sens astronomique en substituant les noms planètes par ceux de déesses. De plus, il rajoutait une complication en cachant le sens mythologique dans des périphrases. Par exemple pour Vénus, il parlait de "la mère des amours". Pour la Lune, il était question de l'île de Délos où elle était honorée sous le nom de Cynthie. Pourquoi diminuait-il les chances de trouver ses anagrammes car les métaphores, périphrases, etc..., pouvant désigner des corps célestes, sont nombreux ?
Lors de la découverte des anneaux de Saturne, il écrira désespéré: "Je ne sais quoi dire devant un cas aussi surprenant". Il suggéra que Saturne devait avoir des bras ou des anses qui poussent mystérieusement et disparaissent périodiquement. Il coda sa découverte par l'anagramme suivante qu'il envoya à plusieurs personnes:
-
smaismrmilmepoetalevmibunenugttaviras.
Il y avait ajouté une complication supplémentaire en accolant toutes les lettres mélangées dans une séquence illisible, où émergeaient par-ci, par-là, des groupes qui suggéraient un mot (is, poeta, vir).
Il la fit parvenir à Johannes Kepler, qui habitait Prague. Ce dernier décoda la phrase suivante:
-
salve umbistineum geminatum Martia proles.
Ce qui signifiait: Salut, double protection du bouclier, engeance de Mars.
Kepler supposa que Galilée avait découvert 2 satellites ("double protection" et "engeance") de Mars (l'emblème du bouclier). Le plus étonnant c'est que cette erreur cachait une réalité qui ne sera découverte qu' en août 1877 par Asaph Hall: la présence des 2 satellites de martiens Phobos et Deimos.
Kepler fit parvenir l'anagramme à l'Anglais Thomas Harriot, qui avec ses amis, tenta de résoudre l'énigme. Voici quelques unes des solutions trouvées:
-
Mi tantum Jupiter laus gloria summe brans me
-
Montibus et silva variis martem mage plenum
-
Ignem lunarem in sat. parvum et mobilem visitas
Kepler et Harriot sont partis du principe que Galilée ne pouvait que parler d'observations astronomiques. Ils recherchèrent donc les noms de corps célestes connus (Jupiter, Mars, Lune). Ils essayèrent de mélanger les lettres à la recherche d'un sens caché en ordonnant les mots pour obtenir une phrase grammaticalement correcte. La recherche porta sur quelques permutations possibles parmi les 36! (factoriel) soit:
-
36! = 371 993 326 678 990 121 746 799 944 815 083 520 000 000 possibilités
Or, voici la clé du mystère que révéla Galilée plus tard:
-
Altissimum planetam tergeminum observavi
J'ai observé que la planète la plus haute est trijumelle.
Galilée évita de parler de Saturne qu'il appela " la plus haute". Il mourut sans savoir qu'il avait découvert les anneaux de Saturne dans sa petite lunette.
Extrait de:
"De l'anagramme au cryptogramme" de Fernand Hallyn Université
de Gand
paru sur le site de l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des
Mathématiques de Lille:
http://www.univ-lille1.fr/irem/publications/actesgalilee.pdf
Pour approfondir le sujet, n'oubliez pas de lire
Les
structures rhétoriques de la science, de Kepler à Maxwell
de Fernand Hallyn
Langue : Français Éditeur :
Seuil (27 avril 2004)
Collection : Des travaux
Format : Broché - 304 pages
ISBN : 2020632497
________________________________
Voici quelques liens supplémentaires:
Galilée: http://es.rice.edu/newgalileo/bio/index.html
Musée de l'histoire des sciences à Florence http://www.imss.fi.it/
galilea turn: http://brunelleschi.imss.fi.it/genscheda.asp?appl=LST&xsl=percorso&lingua=ENG&chiave=730718
Saisons http://science.nasa.gov/headlines/y2002/12feb_rings.htm
Nine planets: http://www.seds.org/billa/tnp/saturn.html
Bienvenue sur les planètes http://pds.jpl.nasa.gov/planets/welcome/saturn.htm
Solarview Saturne http://www.solarviews.com/eng/vgrsat.htm
USGS Saturne http://astrogeology.usgs.gov/SolarSystem/Saturn/
Saturne http://www.space.com/reference/brit/saturn/climate.html
Saturne NASA: Welcome to the Planets - Saturn
Images de Saturne: http://www.lasam.ca/billavf/nineplanets/pxsat.html