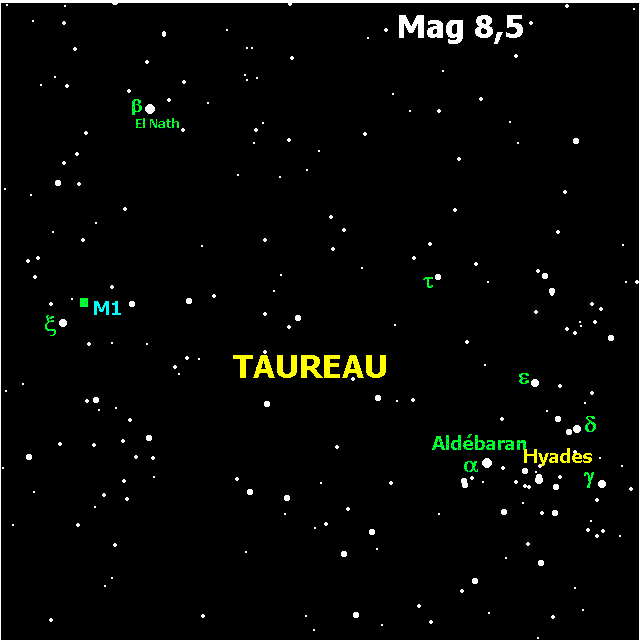|
Constituée de gaz
et de poussières, matière éjectée lors de l'explosion, la nébuleuse du
Crabe émet un rayonnement dans le rouge et un fond diffus bleuté. Le
rayonnement forme un enchevêtrement de filaments brillants, mettant en
évidence le champ magnétique, avec un spectre
d'émission comme les nébuleuses planétaires.
Le rouge indique que les électrons se sont combinés avec des protons
pour former, entre autres, de l'hydrogène neutre.
Quant au fond de couleur bleu, il est issu du rayonnement synchrotron hautement
polarisé émis par des électrons de hautes énergies en mouvement rapide
(proche de la vitesse de la lumière) dans un champ magnétique puissant. En
raison de leur haute énergie (1011eV), ces électrons ne peuvent
provenir que de l'explosion initiale. Leur origine n'a été expliqué qu'en
1969, lorsque le pulsar fut découvert.
Située à 6 000 al, la nébuleuse du Crabe s'étend
à plus de 1 000 km/s, soit, à cette distance, 0,2" par an. Son diamètre
actuel avoisine les 6 al.
Ci-dessous, nous voyons
les filaments, observés en haute résolution, par le télescope spatial Hubble
et l'on devine le rayonnement synchrotron du pulsar (couleur légèrement
bleutée).

Hubble Heritage Team (AURA/
STScI/ NASA)
Hubble heritage
Le
pulsar

Constituée de
gaz et de poussières, matière éjectée lors de l'explosion, la nébuleuse du
Crabe (M1) émet un rayonnement dans le rouge et un fond diffus bleuté. Le
rayonnement forme un enchevêtrement de filaments brillants avec un spectre d'émission
comme les nébuleuses planétaires. Le rouge indique que les électrons se
sont combinés avec des protons pour former, entre autres, de l'hydrogène
neutre.
Quant au fond de couleur bleu, au centre, il est issu du rayonnement synchrotron
hautement polarisé émis par des électrons de hautes énergies en mouvement
rapide (proche de la vitesse de la lumière) dans un champ magnétique puissant.
Ce fond est visible dans l'image ESO du centre de M1, ci-dessous, mais d'autant
mieux sur les images, ci-après, du pulsar vu par Hubble et en X par Chandra. A
noter aussi le pulsar qui est le résidu de l'étoile explosée en 1054. Voir
les images ci-après.
Le noyau de l'étoile
s'effondra pour former un pulsar,
qui est l'un des objets exotiques du 20e
siècle. C'est en
1968 que le pulsar du Crabe
fut découvert et répertorié sous le n° NPO532. Comme un phare cosmique, ce
pulsar balaie l'espace de son puissant champ magnétique à la vitesse d'un tour
toutes les 33 millisecondes. Il génère un faisceau de rayonnements radio, X,
visibles et gammas produisant 30 impulsions par seconde qui sont reçues sur
Terre comme une puissante horloge.

SEDS

Credit: J. Hester and P. Scowen (ASU),
NASA
En utilisant toute
une série de photos époustouflantes du télescope Hubble, les astronomes ont
découvert le mouvement du pulsar. Nous voyons ci-dessus, les minces filaments de
matière se mouvant autour du pulsar à la moitié de la vitesse de la lumière,
créant un halo scintillant et une grande concentration d'émissions virevoltant au-dessus du pôle du pulsar.
Le mouvement spectaculaire de la lumière autour du pulsar est créé par les
électrons et les positrons (anti-électrons) spiralant dans les lignes de force
du champ magnétique. Avec seulement 10 km mais
plus massif que le Soleil, l'énergie du pulsar conduit la dynamique et les
émissions de la nébuleuse du Crabe à plus de 10 al. Sur cette image le pulsar
est l'étoile de gauche, au centre. Il tourne sur lui-même en 30 ms. Cette
période est bien connue car le pulsar rayonne dans toute la gamme du spectre
électromagnétique, depuis un point "chaud" de sa surface. Sa vitesse
décroît lentement du fait de l'interaction magnétique avec la nébuleuse.
C'est la source principale d'énergie provoquant le rayonnement lumineux. La
nébuleuse du Crabe brille comme 75000 fois le Soleil.
L'équipe
du télescope spatial a trouvé que la matière n'était pas éjectée dans
toutes les directions, mais elle est concentrée dans 2 jets polaires avec un
vent solaire se déplaçant hors de l'équateur de l'étoile.
La
caractéristique la plus dynamique de l'intérieur du pulsar est le point où un
jet polaire rencontre la matière environnante en formant une onde de choc. La
forme et la position changent si rapidement que les astronomes parlent de
"lutin dansant" ou de "chat sur une plaque chauffante". Le
vent équatorial apparaît comme une série de filaments se raidissant,
s'éclaircissant et s'affaiblissant comme s'ils s'éloignaient du pulsar en
jaillissant du corps principal de la nébuleuse.
En
observant les ondulations se mouvant vers l'extérieur, on dirait une série de vaguelettes
sur le bord de la plage, sauf que ces vaguelettes mesurent une année-lumière
et se déplacent à travers l'espace à la moitié de la vitesse de la lumière.
Mais on étudie pas un océan en regardant un instantané des vagues. Par leur
nature les vagues de l'océan changent en permanence. On étudie l'océan en
s'asseyant au bord de la plage et en observant comment les vagues roulent sur le
bord. L'étude du déplacement au sein de la nébuleuse du Crabe, par le HST,
est très significative car c'est la première fois que sont étudiés les
effets d'un pulsar. Nous avons ainsi l'opportunité de découvrir un phénomène
astrophysique de haute énergie. Les processus physiques oeuvrant au centre des
galaxies actives et des quasars ressemblent à ceux du centre de la nébuleuse
du Crabe. Mais dans ceux-ci nous ne pourront jamais les observer. Par exemple
les 2 jets permettent de comprendre les 2 lobes d'émissions X découverts par
les satellites Einstein et Rosat.
Pour clore ce
chapitre, il faut se souvenir que la densité d'un pulsar est gigantesque et
peut atteindre: 1.109
tonnes/cm³.
La photo a été prise le 5
nov 1995 par la caméra planétaire à grand champ du HST à 550 nm, au milieu
du spectre visible.
Le
pulsar par Chandra en X
Le pulsar tapi au cœur
de la nébuleuse du Crabe, fournit à l'enveloppe gazeuse une énergie qui accélère
son expansion. Il tourne sur
lui-même à raison de 30 T/s. Le télescope X Chandra nous révèle les détails de ce moteur
caché: le pulsar entouré d'un disque chaud (spirale) incliné, produisant des particules
à très hautes énergies qui apparaissent avoir été projetées en avant, à
une distance du pulsar supérieure à 1 al. Perpendiculaire à l'anneau, des
jets éjectent des particules de hautes énergies. Le diamètre intérieur de
l'anneau représente 1 000 fois le diamètre de notre Système solaire. Le
rayonnement X de la nébuleuse est provoqué par les particules de très grandes
énergies spiralant autour des lignes de forces du champ magnétique. La forme
de cloche est due à l'interaction de l'immense bulle magnétique avec les
nuages de gaz et de poussières environnants.
Cette image
mesure 2,5 mn d'arc de côté.

crédit:
NASA/CXC/SAO
Image
composite du pulsar
Plusieurs observations sur
plusieurs mois, faites par les télescopes Chandra en X (en bleu) et
Hubble dans le visible (en rouge), ont permis de réaliser cette photo
composite montrant la  matière
et l'antimatière propulsées à des vitesses proches de la lumière
dans le pulsar du crabe, une étoile à neutron en rotation rapide de la
taille de Paris. Les filaments brillants qui se déplacent vers
l'extérieur à la moitié de la vitesse de la lumière, forment un
anneau en expansion rapide visible en rayonnement X et visible. Ils
paraissent avoir pour origine une onde de choc qui apparaît à
l'intérieur de l'anneau de rayons X. Cet anneau se compose d'environ deux douzaines
d' "amas" qui se forment, brillent
et s'évanouissent, vibrent autour, subissent de temps en temps des
explosions qui provoquent des nuages de particules en expansion, mais demeurent
fermement au même endroit. Une autre caractéristique spectaculaire est
le jet qui traverse de part en part le pulsar et qui est perpendiculaire
à l'axe de rotation. De violents mouvements internes se manifestent,
de même qu'un lent mouvement externe entoure la nébuleuse de
particules et d'un champ magnétique. Pour David Burrows du Penn State,
autre co-auteur de l'article, le jet est comme un courant issu d'une
chaudière à haute pression, sauf que c'est un courant d'électrons de
matière et de positrons d'antimatière qui se déplacent à la moitié de la vitesse de la lumière. matière
et l'antimatière propulsées à des vitesses proches de la lumière
dans le pulsar du crabe, une étoile à neutron en rotation rapide de la
taille de Paris. Les filaments brillants qui se déplacent vers
l'extérieur à la moitié de la vitesse de la lumière, forment un
anneau en expansion rapide visible en rayonnement X et visible. Ils
paraissent avoir pour origine une onde de choc qui apparaît à
l'intérieur de l'anneau de rayons X. Cet anneau se compose d'environ deux douzaines
d' "amas" qui se forment, brillent
et s'évanouissent, vibrent autour, subissent de temps en temps des
explosions qui provoquent des nuages de particules en expansion, mais demeurent
fermement au même endroit. Une autre caractéristique spectaculaire est
le jet qui traverse de part en part le pulsar et qui est perpendiculaire
à l'axe de rotation. De violents mouvements internes se manifestent,
de même qu'un lent mouvement externe entoure la nébuleuse de
particules et d'un champ magnétique. Pour David Burrows du Penn State,
autre co-auteur de l'article, le jet est comme un courant issu d'une
chaudière à haute pression, sauf que c'est un courant d'électrons de
matière et de positrons d'antimatière qui se déplacent à la moitié de la vitesse de la lumière.
Les
régions internes de la nébuleuse du crabe (M1) qui entourent le pulsar
furent observées par la caméra à grand champ du HST (Hubble Space
Telescope) à 24 reprises entre août 2000 et avril 2001 à 11 jours
d'intervalles et 8 fois par la caméra CCD du spectromètre de Chandra
entre novembre 2000 et avril 2001.
http://hubblesite.org/db/2002/24/images/a/formats/web.jpg
Credits:
X-ray: NASA/CXC/ASU/J.
Hester et al.;
Optical: NASA/HST/ASU/J.
Hester et al.
retour à supernova
, étoile
|