|

Ci-dessus,
une
partie de la zone de Kulik dans la région de la Toungouska russe, survolée en
1938. Les arbres couchés en parallèle, indique la direction du souffle.
Rien ne fut
trouvé au sol, ce qui fait dire à certains qu'il est possible qu'une comète
se soit sublimée au moment de l'impact. Cliquez sur la photo ci-contre, la
photo de l'endroit où se serait produite l'explosion.
Les
chercheurs du département de physique de Bologne avec ceux du CNR (Institut de
géologie marine de Bologne) et de l'observatoire astronomique de Turin avaient
organisés une expédition scientifique de 2 semaines dans la Toungouska
(Sibérie centrale) . Les chercheurs locaux de l'université de Tomsk (Russie)
ont contribué à cette expédition. Parmi eux il y avait l'académicien N.V.
Vasilyev et le professeur G.V. Andreev. Au total 25 personnes ont participé à
cette étude scientifique qui s'est déroulée lors de la 2e quinzaine de juillet
1999.
Un autre phénomène analogue
à la Toungouska, s'est produit entre le Brésil et le Pérou, le
8 août 1930. Des recherches sont en cours pour vérifier les
récits de cette époque.
On estime qu'un objet de moins de 100 m, tombe tous les 1000 ans. Et le prochain impact de
10 km aura lieu
avant 500 000 ans.
retour
aux dinosaures
le
lieu de l'explosion:
http://olkhov.narod.ru/tungus1.jpg
-
Situé entre
Limousin et Charentes-Poitou, les
environs
de cette petite bourgade
Rochechouart - Chassenon
de 4 000 habitants, entre Limoges et
Angoulême, au sud de Confolens, a connu le même cataclysme, il y a environ
214 (+/- 8) millions d'années. Une pierre de 6
milliards de tonnes, soit 2 km, a percuté la
région, 4 km à l'ouest de Rochechouart, créant un cratère de
23 km de
diamètre et dévastant tout sur 200 km. La vitesse d'arrivée de 20 km/s
(72 000 km/h) délivra une énergie équivalente à 14 millions de fois la
bombe d'Hiroshima. Point d'impact
: La Judie, 4 km à l'ouest de Rochechouart. Coordonnées: 45°50' N et 0°56'
E.

http://membres.lycos.fr/astrojan/Robert.htm
Carrière
de Champonger, où furent découverts les cônes de percussion

http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/rochechouart.htm
Le château de Rochechouart est
construit sur une colline laquelle consiste en une brèche
polymicte (formée de fragments de taille et de nature différentes). Le plancher du cratère a été identifié ici, au milieu de
la photo et au-dessous du château
Photo Sept. 2002. Submitted by Harald Stehlik.
Le
scénario fut à peu près celui que nous avons vécu sur Jupiter, en
juillet 1994. L'astéroïde, qui était un bloc immense, s'est fragmenté en
3 morceaux, à l'approche de
la Terre. Les 2 autres sont tombés au Canada,
à Saint-Martin et à Manicouagan. Grâce à la reconstitution de la
disposition des plaques à cette époque, il est acquis que les 3   sites
étaient alignés à ce moment là. sites
étaient alignés à ce moment là.
Les résidus météoritiques, qui s'étendent sur 250 km2, ont servi, depuis
les romains (thermes de Chassenon), de pierre à construction pour les
maisons alentours. Ici, à gauche le pont-levis de château qui
rappelle encore les systèmes de défenses militaires du 13e siècle et à
droite la galerie à arcades et colonnes torses de la cour intérieure, date de
la Renaissance.
 Espace
météorite Espace
météorite
Situé dans le
centre ville (rue Jean Parvy), ce lieu, consacré aux météorites et aux roches
issues des impacts est le premier du genre en France .
Une large présentation de la météorite de Rochechouart et du phénoménal
cataclysme produit lors de son impact ( historique, échantillon de roches,
projection vidéo exclusive…)
est proposée.
Horaires
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Dimanches de 14h à 18h.
Fermé le samedi
Tél : 05.55.03.02.70
http://www.rochechouart.com/index.html
retour
aux extinctions
de masse
-
Bodaibo
Plus près de nous, la nuit du 25 septembre 2002, une grosse météorite a dévasté
la forêt dans une région reculée de Sibérie (voir carte ci-dessus). Les habitants de la ville de
Bodaibo, dans la région nord d'Irkoutsk (115°E et 58°N), ont déclaré avoir
vu la grande lueur d'un corps tombant du ciel. L'impact a produit un tremblement
de Terre accompagné d'un bruit de tonnerre avec un flash au-dessus du lieu de
l'explosion. Cela s'est passé loin de toute habitation, en pleine taïga. La
station sismique locale a confirmé le fait. Avec l'aide d'un satellite
américain qui a vu le flash de l'explosion, les sismologues d'Irkoutsk
ont localisé le point de chute. Des arbres ont été fauchés par des fragments
de la météorite à 37 km de Mama, dans le bassin de la Léna.
Aucun résidu du corps céleste, qui explosa dans
l'atmosphère, ne furent retrouvés tant que l'épaisse couche de neige n'aura
pas fondue. Les
conditions hivernales empêchèrent toutes recherches et au printemps une
importante expédition scientifique partira à la recherche des fragments vieux
de plus de 4 milliards d'années. Il semblerait que ce soit un astéroïde
important, selon ce qu'ont déclaré certains experts à la Pravda dont le Dr
Benny Peiser de l'université John Moore à Liverpool. Il ajouta que l'incident
se produisit le même jour où, à la Maison Blanche à Washington, était débattu
le besoin de rechercher les petits corps qui se promènent au voisinage de la
Terre et le danger qu'il y aurait à les confondre avec une attaque nucléaire.
On estime qu'au moins 30 fois par an des astéroïdes percutent l'atmosphère
terrestre et explosent avec la puissance d'une bombe nucléaire.
http://english.pravda.ru/main/2002/10/03/37698.html
-
Il y a 139 impacts connus sur Terre, de quelques centaines de mètres à quelques
centaines de km. On estime qu' un objet de 150 m tombe sur Terre tous les 5 000 ans et de
1 km, tous les 300 000 ans.
Si un astéroïde de 1 km de diamètre et d'une densité
ordinaire de 2, soit 2 tonnes par m³, percutait la Terre à la vitesse ordinaire de 30
km/s, son volume de 520 millions de m³ et sa densité font que sa masse est égale à un
milliard de tonnes. L'énergie cinétique dégagée est de 4,5.1020
joules. Sachant que 1 mégatonne de TNT vaut 4,2.1015 joules, à
l'impact, cet astéroïde dégagera 100 000 mégatonnes de
TNT.
Nous avons une possibilité sur 100 000 d'être les témoins privilégiés d'un tel
cataclysme. En outre, la vitesse peut varier de 10 à 60 km/s et la densité de 0,5 à 8.
Ainsi l'explosion variera de 4 000 à 1 800 000 mégatonnes.
C'est l'équivalent de
40 000 à 18
millions de fois la bombe d'Hiroshima.
Des calculs indiquent qu'en 2027 l'astéroïde 1999 AN10, mesurant 1 km de
diamètre, passerait à 320 000 km de la Terre (3 h avant ou après le passage
de la Terre) à la vitesse de 80 km/s. Pour mémoire la Terre se promène à 30
km/s (100 000 km/h). Le chaos peut modifier le moment du passage.
retour
aux extinctions
de masse, la Vie
Tableau des astéroïdes
No
|
NOM
|
DISTANCE
millions de km
|
Rayon
(km)
|
Découvreur
|
DATE
|
2062
|
Aten
|
144,514
|
0,5
|
Helin
|
1976
|
3554
|
Amun
|
145,710
|
?
|
Shoemaker
|
1986
|
1566
|
Icare
|
161,269
|
0,7
|
Baade
|
1949
|
951
|
Gaspra
|
205,000
|
8
|
Neujmin
|
1916
|
1862
|
Apollo
|
220,061
|
0,7
|
Reinmuth
|
1932
|
243
|
Ida
|
270,000
|
35
|
?
|
1880 ?
|
2212
|
Hephaistos
|
323,884
|
4,4
|
Chernykh
|
1978
|
4
|
Vesta
|
353,400
|
263
|
Olbers
|
1807
|
3
|
Junon
|
399,400
|
123
|
Harding
|
1804
|
15
|
Eunomia
|
395,500
|
136
|
De Gasparis
|
1851
|
1
|
Cérès
|
413,900
|
466
|
Piazzi
|
1801
|
2
|
Pallas
|
414,500
|
261
|
Olbers
|
1802
|
52
|
Europa
|
463,300
|
156
|
Goldschmidt
|
1858
|
10
|
Hygiea
|
470,300
|
215
|
De Gasparis
|
1849
|
511
|
Davida
|
475,400
|
168
|
Dugan
|
1903
|
911
|
Agamemnon
|
778,100
|
88
|
Reinmuth
|
1919
|
2060
|
Chiron
|
2051,900
|
85
|
Kowal
|
1977
|
Liste des astéroïdes qui se
sont le plus approché de la Terre: http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Closest.html
Par exemple celui qui s'est
approché le plus de nous est 1994 XM1, le 9,8 décembre 1994 à seulement 0,0007
UA H=28
-
Le 1er astéroïde a avoir été
radarphotographié fut Castalia en 1989.
Il apparaît comme un corps de cacahuète écrasée. Il est composé de 2
lobes accolés de 1 km de diamètre. A l'endroit du "collage" un
ravin de 100 m de profondeur est bien visible. Il aurait été formé par
la collision de 2 corps parents.
Toutatis fut le 2ième en dec 1992, par Goldstone et Arécibo
alors qu'il se trouv ait à 3,6 millions de km de la Terre (10 fois la
distance Terre-Lune). Puissance
émise: 400 kw.

Depuis la Terre les radars permettent d'obtenir des informations de ces petits astres.
Début
août 1999, un nouvel astéroïde, 1999
JM8, découvert
le 13 mai
99, a été ausculté par des radars US. Il est à proximité
de la Terre (8,5 millions de km). Sa taille 3,5 km. Il ressemble à Toutatis. Des
cratères de 100 m y furent découverts
http://neo.jpl.nasa.gov/images/jm8_aug5.gif
-
La
plus grosse
La plus grosse météorite se trouve en Namibie à la ferme de Hoba,
d'où son nom, au nord de la ville de Grootfontein. Ce bloc (2,95 m x 2,84 m) de
60 tonnes ou 9 m3 (photo ci-dessous) serait tombé il y a 80 000
ans. 82,4% de la météorite seraient composés de fer, 16,4% de nickel et
0,76%
de cobalt. Elle fut découverte en 1920. On ne peut pas en trouver de plus grosse
car, au-delà, elles se volatilisent dans l'atmosphère. Son âge est estimé
entre 200 et 400 millions d'années. La photo ci-dessous, la montre au
Grootfontein museum.

http://www.suedafrika.net/namibgif/hoba1.jpg
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Forum/Planetologie/Meteorites/big-meteor.html
-
Fantasmes
Depuis leur découverte, les météorites ont permis aux hommes d'espérer en découvrir une
entièrement en or. Ce fantasme pris corps dans la
célèbre revue "Ciel & Espace" n°268, où un article détailla
avec moultes précisions la découverte de l'astéroïde 1991 VG, à l'aide du
radiotélescope d'Arecibo. Cet astéroïde aurait été constitué des 2/3 d'or
(on parlait de 80%). De plus il contiendrait du platine et du zirconium qui sont
aussi très rares et très chers. L'affaire aurait fait grand bruit. Sa masse
aurait été estimée à 3 milliards de tonnes. Comme la trajectoire
l'approchait à 0,0031 UA de la Terre, la NASA aurait envisagée une
expédition.
Mais c'était trop beau, car ce numéro fut édité en avril 1992....... Seule la
découverte en décembre 1991 de l'astéroïde de 10 m, était réelle. Un
écrivain célèbre c'était lui aussi prit à rêver, mais par mépris, dans
son roman "la chasse au météore" en 1908. Toute une ville vit dans
la crainte d'un bolide géant. Seuls deux astronomes amateurs, désireux de posséder
cette sphère d'or massif venue de l'espace, y voient l'occasion de se couvrir
de gloire. Le livre parut après sa mort, remanié par son fils Michel, car dans
la version originale Jules Verne exprime son mépris pour l'or.
|




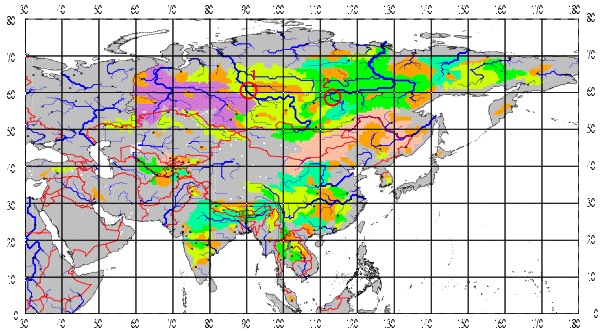









 En recherche aussi, le hasard fait bien
les choses, même s’il faut
En recherche aussi, le hasard fait bien
les choses, même s’il faut parfois le provoquer un peu. Un jeune chercheur vient de confirmer l’adage.
C’est en participant à la mise au point des radars pour l’exploration
planétaire qu’il vient de révéler, dans le désert égyptien, le
plus grand champ de
parfois le provoquer un peu. Un jeune chercheur vient de confirmer l’adage.
C’est en participant à la mise au point des radars pour l’exploration
planétaire qu’il vient de révéler, dans le désert égyptien, le
plus grand champ de