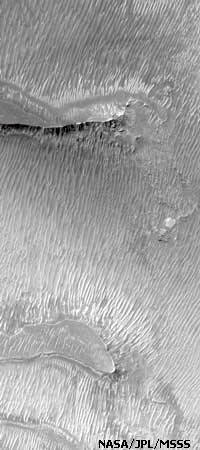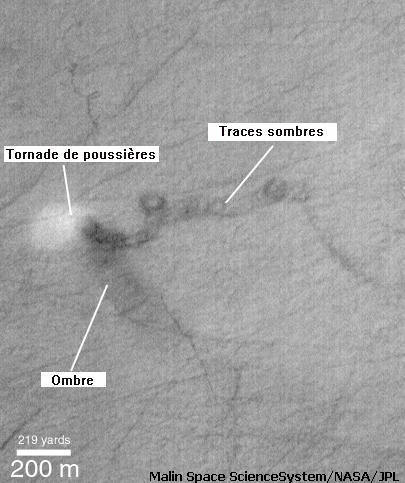|
http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMYRSW4QWD_1.html#subhead3
-
Dunes
piège
Cette mosaïque, ci-dessous, faite à partir des images de la caméra du
rover Opportunity est présentée en projection verticale. Elle
montre la position du rover dans un champ de dunes où il s'enlisa jusqu'au
moyeu au 446e sol (26 avril 2005). La hauteur maximale de ces dunes est de
70 cm, suffisamment hautes pour que les contrôleurs de vol réalisent sur
Terre un modèle de terrain afin de trouver une solution pour le sortir de
ce pétrin

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA07922_modest.jpg
Opportunity enlisé dans les dunes.
Ces dunes ressemblent à des vagues. La dune
allongée, sur laquelle est arrêté Opportunity, fait 33 cm de haut pour
2,5 m de large. Le rover avait accompli presque 40 mètres d'un trajet
de 90 mètres prévu cette journée-là, quand ses roues ont commencé à glisser.
Opportunity recula. L'équipe du rover alterna alors fréquemment avance et
recul pour garder une lubrification suffisante sur les roues. N'oublions pas
qu'un froid sibérien règne. Si le rover ne s'était pas enlisé, les roues
auraient tourné suffisamment de temps pour rester lubrifiées. Mais les
capteurs ordonnèrent de stopper, car cet enlisement fut pris pour une
anomalie de fonctionnement.
L'équipe du rover a déjà utilisé plus d'une
semaine pour simuler les conditions martiennes sur Terre, avant de choisir la meilleure manière pour que
le rover sorte de son enlisement.

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20050506a/DSC_0037_PIA07986-A476R1_br.jpg
La caméra d'Opportunity a filmé le problème.

http://www.universetoday.com/am/uploads/2005-0525wheel-full.jpg
-
Tempêtes
et atmosphères électriques
Les gigantesques tempêtes de sable qui affectent Mars ont obligé les météorologistes a cherché des explications.
Est-ce le chauffage solaire ou l'électricité, qui déclenchent ces tempêtes dans
une atmosphère proche du vide ?
Les tornades sur Mars génèrent probablement
des champs électriques très intenses associés à des champs magnétiques qu'il faudra prendre en compte lors des prochaines explorations humaines.
La conclusion est basée sur des études en Arizona et au Nevada, où
les chercheurs ont cherché à suivre, à travers le désert, des tempête de poussière et
à les étudier. Ils ont trouvé inopinément de grands champs électriques
dépassant 4 000 v/m (volt/mètre).
Les tempêtes de poussières sont de mini tornades dont la formation est
totalement différente. La plus petite variété peut être projetée en
altitude par
de doux zéphyrs. Des versions plus importantes peuvent être aussi larges
qu'une maison ou un terrain de football avec des vents dépassant les 100 km/h.
Elles sont créées par le vent qui tourbillonne autour d'une colonne
d'air chaud qui s'élève dans les airs.
Sur Mars,
les tempêtes de poussière peuvent être cinq fois plus large et atteindre plus
de 8 000 m de haut, beaucoup plus haut que les véritables tornades terrestres. Sur les deux planètes, les
tempêtes de poussière se forment quand la Terre s'échauffe pendant la journée en chauffant l'air immédiatement au-dessus de la surface.
Des poches d'air chaud s'élèvent et interfèrent l'une avec l'autre, parfois entraînant une poche ou
une autre pour commencer un mouvement tourbillonnant en laissant des traces au
sol.

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/images/031222_iod_devils_04.jpg
Les scientifiques se sont réjouis à la vue
des traces laissées par les tornades. Mais ils ont eu très peu l'occasion
de voir une image aussi spectaculaire que celle ci-dessus, prise en septembre 2001 par Mars Global
Surveyor. Les traces furent créées lors du printemps austral par des tempêtes de
poussière et ont traversé un vieux cratère d'impact météoritique de 3 km de
diamètre, localisé par 57,4°S et 234°W. Le printemps suivant a
lieu en 2005.
La sonde mariner 9 fut la première sonde
à se satelliser autour de la planète Mars. Dès son arrivée à proximité de la planète rouge en 1971,
les scientifiques de la NASA ont été surpris par l'ampleur de la tempête de
poussière la plus terrifiante qu'ils n'avaient jamais vue. La planète entière a été engloutie dans une
profonde brume, avec seulement le sommet du colossal Olympus Mons (25 000 m)
hors des nuages.
Pendant plusieurs décennies, les tempêtes de
sable martiennes ont posé des questions aux météorologistes. Comment
une atmosphère si peu dense (1% de l'atmosphère terrestre) peut elle soulever
et accélérer la poussière pour former de gigantesques nuages englobant la planète jusqu'à
une centaine de kilomètres au-dessus de la surface ?

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050324duststorm.jpg
En juin 2001, le télescope Hubble a suivi les premières
turbulences d'une tempête dans une petite région du
bassin Hellas qui mesure 2 000 km de diamètre pour une profondeur supérieure à
7 000 m. Pendant plusieurs jours la tempête s'est alternativement
développée et régressée. Puis elle a éclaté et a
rapidement jailli hors du bassin, se propageant du nord vers l'est. En quelques semaines,
elle avait recouvert toute la planète.
La tempête a duré jusqu'en octobre. C'était la
plus grande tempête de sable jamais observée sur Mars laissant les météorologistes perplexes. Comment
des poussières ont-elles pu jaillir hors de Hellas ? Comment les poussières
ont-elles pu envahir la planète ? Quel phénomène a accéléré les vents et les poussières à travers
la très faible atmosphère à des vitesses allant jusqu'à 400 km/h ?
Avec son spectromètre thermique à émission (TES), Mars Global
Surveyor a mesuré les effets thermiques liés à la tempête. Tandis que les nuages d'orage commençaient à entourer Mars, les températures se sont élevées
de 40°C, un cas de réchauffement global instantané qui continue à hanter
les météorologistes.
Phil Christensen de l'Université d' Etat d' Arizona, un des principaux
responsables du phénomène martien, reconnaît que les spécialistes ne
connaissent vraiment pas en détail, les causes
de ces tempêtes martiennes. Certains pensent que les nuages de poussière
se développent en profondeur, ils absorbent plus de chaleur solaire, faisant
monter la température de l'atmosphère créant une boucle de rétroaction positive qui peut transformer
des nuages minuscules en orages globaux. Avec ce raisonnement, nous pourrions
nous demander pourquoi les tempêtes de sable ne s'arrêtent jamais. En effet, ceux qui suivent ce raisonnement ne
savent même pas pourquoi elles s'arrêtent.
La plupart des explications commencent avec le rayonnement solaire. Les scientifiques savent que les
tempêtes sont les plus fréquentes et importantes quand Mars est proche du périhélie
(sa distance la plus courte au Soleil). Ainsi les
spécialistes pensent que les effets thermiques du rayonnement solaire fournissent l'énergie
aux tempêtes. Mais ce raisonnement exige un
effet considérablement plus énergique que la cause. L'orbite de Mars a une excentricité de
0,093, bien plus grande que celle de la Terre (0,017), ce qui joue
énormément sur l'énergie absorbée. En fait, si les effets thermiques en sont la cause,
l'orientation saisonnière de l'axe de rotation devrait
contribuer beaucoup plus aux tempêtes de sable, avec une nette différenciation hémisphérique.
Cependant, ce n'est pas le cas.
Mais dans
un univers électrique, les courants interplanétaires, qui se concentrent sur le
Soleil, jouent un rôle essentiel dans les ionosphères planétaires, une clef
pour comprendre
l'évolution des systèmes météorologiques. Le théoricien Wallace Thornhill,
spécialiste des modèles électriques, imagine l'atmosphère de la Terre se
réparant elle-même des pertes d'isolation du condensateur global.
La foudre manifeste la fuite (pertes de capacité) du condensateur, car le
courant de fuite traverse l'atmosphère isolante pour se dissiper dans la charge.
En
temps normal, le champ électrique terrestre au niveau de la mer est
de 120 V/m, dans un air sec. L'origine est pour l'instant
inexpliquée. Avec l'arrivée d'un nuage chargé électriquement, il
peut atteindre 15 000 à 20 000 V/m. C'est la puissance électrique d'un
nuage qui charge l'ionosphère. Mais les théoriciens voient en cela
une inversion de la cause et de l'effet. Il n'y aurait pas d'orage
en l'absence de champ électrique terrestre.
Le champ électrique est accentué par les aspérités du sol
(relief, arbres, habitations). Ces dernières créent un effet de
pointe qui peut accentuer localement plusieurs centaines de fois ce
champ. Ce phénomène appelé effet Couronne favorise l'apparition
du coup de foudre à cet endroit.

http://perso.wanadoo.fr/alain.borie/Foudre/Image221.gif
La génération
d’un champ électrique est envisageable comme résultat de
l’action de charges électriques ( loi de Coulomb). En fait, les
champs électriques permanents sont créés à partir de la thermochimie.
Néanmoins, il faut nuancer, la
frontière entre diélectrique ou conducteur n'est pas aussi nette.
Les théories classiques s’avèrent très vite insuffisantes.
L'électron étant le centre du phénomène, les théories
quantiques et statistiques sont indispensables pour expliquer les
comportements isolants, semi-conducteurs et conducteurs de la matière.
Puisque Mars n'a pas
d'orage pour charger son ionosphère, c'est un bon exemple pour
étudier la relation entre champs électriques solaires et la
Planète Rouge. Le modèle électrique prédit que l'ionosphère de
Mars n'est pas en fait une dynamo isolée, séparée
de la charge. Sur Mars, les effets électriques atteindront
directement la surface, à partir de l'ionosphère, sans
l'intermédiaire des nuages d'orage, comme sur Terre. A la différence de l'énergie
solaire, l'énergie électrique peut s'accumuler dans " le
condensateur planétaire " pendant un certain temps, avec un potentiel pouvant modifier les événements
quand l'atmosphère
finalement " s'écroule " en initialisant une décharge gigantesque.

http://science.nasa.gov/ssl/pad/sppb/edu/magnetosphere/images/mag_sketch.gif
Il y a également un autre aspect de connexion électrique des
circuits interplanétaires affectant Mars. Le plus grand orage sur Mars
(2001)
s'est produit quand la planète s'approchait du périhélie et que sa distance
était la plus proche de la Terre, depuis 12 ans. À
ce moment-là, la Planète Rouge était "caressée " par la
magnétosphère terrestre (enveloppe de plasma soufflée par le vent
solaire), établissant un
raccordement électrique provisoire entre la Terre et Mars avec transfert de
charges. Il semble que Mars a répondu avec un excès de décharges atmosphériques, ceux-ci prenant la forme de
gigantesques tempêtes de sable ou plus exactement de tornades
électriques, comme ci-dessous.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050322dustdevils.jpg
Credit:
www.ees-group.co.uk/
En même temps, les courants électriques entrant dans l'ionosphère martienne
menèrent les flots de turbulences, composées d'électrons à grande vitesse,
vers les couches supérieures de l'atmosphère. Dans les deux images de tempête
de sable ci-dessous, il s'avère que la poussière est éjectée vers le haut
plutôt que de s'étendre en surface.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050324marsduststorm.jpg
C'est explicable dans le modèle de
tornade électrique et explique aussi la manière dont la poussière s'accroît efficacement
sur plusieurs kilomètres dans l'atmosphère ténue et est maintenue électrostatiquement
pendant un certain temps. Le rôle des violents vortex sur le principal bord des orages
est particulièrement évident dans l'image ci-dessous. Un examen plus approfondi devrait montrer
la forme de ces tornades préférentiellement sur les points élevés et les bords
pointus des cratères ou des escarpements.
Les tourbillons sur le principal bord de la tempête suggèrent un mouvement
ascendant qui est inconcevable dans une atmosphère proche du vide et électriquement
neutre. Peut-être que l'analogie la plus proche serait un réseau de torsades
(des tornades électriques en accord avec la théorie de Thornhill sur la
recherche de l'influence de la symétrie) déjà rencontrées dans la
photosphère solaire en bordure
des taches.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2004/images/041229predictions-comets.jpg
Les scientifiques ne s'attendaient à trouver des tempêtes de sable
chargées électriquement. Les particules de poussière se chargent
en raison d'importantes turbulences qui entraînent des frictions à
l'origine des pertes ou des gains d'électrons autour des atomes.
L'atome devient ainsi un ion positif ou négatif. Les chercheurs
pensaient qu'un équilibre aurait existé au sein du nuage de
poussières, le neutralisant. Apparemment, il n'en est rien.
Au lieu de cela, il s'avère que de plus petites particules tendent à
devenir négatives et le vent les emporte vers les couches
supérieures.
Plus
lourdes, les particules positives restent proches de la surface.
Cette séparation des charges crée une batterie géante. Et comme
ces particules sont en mouvement, un champ magnétique est généré
avec le déplacement des charges électriques.
D'une
part, si les poussières
sont variées en taille et en composition, comme prévu,
les tempêtes de sable devraient être,
de la même façon, électrifiées. La NASA devrait équiper un
prochain atterrisseur d'un instrument pour détecter les champs électriques et magnétiques
des tempêtes de poussière. D'autre
part,
si les tempêtes de poussière de Mars sont fortement électrifiées,
ce que suggère les recherches, elles pourraient provoquer des décharges
électriques ou des arcs dans l'atmosphère martienne, l'adhérence accrue de la poussière
sur les scaphandres et sur l'équipement spatial ainsi que des
interférence dans les communications radio. Des précautions
s'imposent.
-
Tourbillons
électriques
Au cours de
l'été martien, les jours sont longs, tout comme sur cette bonne
vieille Terre. Le jour, la température y grimpe en flèche jusqu'à
20°C et la nuit elle descend très bas à - 90°C, l'absence
d'atmosphère ne permet de freiner cette chute vertigineuse. Mais
les températures élevées de la journée permettent la création
de tourbillons de poussières. Les
sites les plus souvent associés au déclenchement de tempête de
poussières sont, dans l'hémisphère nord, Chryse-Acidalia, Isidis
-Syrtis Major et Cerberus; dans l'hémisphère sud, Hellas,
Noachis-Hellespontus, Argyre et les régions de Solis, de Sinai et de la
Syria Plani.
Imaginez
que vous êtes sur Mars et que vous ayez vécu une expérience diaboliquement
terrifiante. Ce n'était pas un petit tourbillon de désert de seulement quelques
dizaines de mètres de haut et de quelques mètres de large, se déplaçant en
quelques secondes. Non, ce qui vous a frappé
c'était une monstrueuse colonne faisant des
milliers de mètres de haut et centaines d'une mètres de large, 10 fois plus grande que n'importe quelle tornade sur
Terre. Le sable rouge-brun et la poussière tournant à plus de 30 mètres par seconde (100
km/h) ont fait chuter la visibilité à zéro, décapant votre visière, conduisant la poussière dans chaque pli et
repli de votre combinaison spatiale. Pendant 15
minutes vous vous êtes blottis et avez supporté une succession de secousses. La partie
la plus effrayante était le crépitement et les étincelles incessantes
entre vous et les boulons (les aspérités) de votre véhicule, ainsi que la charge statique
importante sur votre radio qui vous a
empêché de réclamer l'aide.
Est-ce que ceci
pourrait vraiment se produire? Selon les scénarios de la NASA sur l'exploration
spatiale, les astronautes iront sur Mars dans les décennies à venir. Et quand ils y
arriveront, les tourbillons de poussière seront toujours présents.
"
Le sable dans la partie basse d'un tourbillon de poussière sera le plus grand risque, "
déclara Mark T. Lemmon, chercheur associé au département des sciences atmosphériques
à l'université A & M du Texas ". La pression atmosphérique sur Mars est seulement 1 pour cent
de celle de la Terre, au niveau de la mer, ainsi vous ne sentiriez pas beaucoup
de vent contre vous. Mais vous seriez cinglés par les matériaux véhiculés
à grande vitesse.
De
plus, la poussière et le sable qui se déplacent peuvent être chargés électriquement, au point de "
créer un arc électrique avec votre combinaison spatiale ou votre véhicule et créer
des interférences électromagnétiques, " ajoute William M. Farrell du centre des vols
spatiaux Goddard de la NASA.
Des tourbillons de poussière sur Mars se forment de la même manière
que dans les déserts terrestres. " Il faut un puissant chauffage extérieur, ainsi
le sol devient plus chaud que l'air au-dessus de lui " explique Lemmon. L'air
chauffé, moins dense, proche du sol, monte en rencontrant la couche d'air plus
dense plus frais qui se trouve au-dessus; les turbulences d'air chaud et celles
d'air frais commencent à circuler verticalement en cellules de convection.
Ensuite, si une rafale de vent souffle horizontalement, elle fait pivoter
les cellules de convection, ainsi elles commencent à tourner
horizontalement en formant des colonnes verticales, en démarrant par un
tourbillon de poussière.

http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF2/227.html
L'air chaud s'élevant au centre de la colonne,
met en marche le tourbillon de plus en plus rapidement et suffisamment pour
aspirer le sable. Le sable, décapant le sol, déloge alors la poussière fine
comme du talc et la colonne d'air chaud l'entraîne vers le haut. Les vents horizontaux
prédominants commencent à pousser le tourbillon de poussière à travers la
zone, contemplez le spectacle !
Pour
Lemmon " Si nous nous trouvions à côté du rover Spirit dans le cratère
Gusev en pleine journée, nous pourrions voir une demi-douzaine de
tourbillons de poussière". Chaque journée
printanière ou estivale, les tourbillons apparaissent vers 10 h du
matin lorsque le sol commence à chauffer et s'estompent vers 15 h lorsque le
sol se refroidit (le jour martien dure 39 mn de plus que sur Terre). Bien que
la fréquence exacte et la durée soient inconnues, les images orbitales de
Mars Global Surveyor révèlent d'innombrables traces et à toutes latitudes.
Ces traces s'entrecroisent sur la surface aux
endroits où les tourbillons l'ont découvert pour révéler au-dessous un
sol de couleur différente.

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/images/031222_iod_devils_04.jpg
D'ailleurs, de réels
tourbillons de poussière ont été photographiés en orbite, certains d'entre eux
avaient 1 à 2 kilomètres de diamètre à la base et s'élevaient nettement
jusqu'à 8 ou 10 kilomètres.
Pourtant ce qui intrigue Farrell,
qui a chassé des tourbillons dans le désert d'Arizona, est le fait étrange que des
tourbillons soient électriquement chargés et les tourbillons de poussière
martiens pourraient l'être, aussi.
Les tourbillons se chargent électriquement lors de la friction des grains de
sable avec la poussière. Quand certains couples de matériaux différents
sont mis en contact par frottement, l'un donne un ou plusieurs électrons
(il devient positif) tandis que l'autre les reçoit (il devient négatif).
Une telle séparation des charges s'appelle "triboélectricité"
du grec tribo pour frottement. La triboélectricité vous fait dresser les
cheveux lorsque vous frotter un ballon en plastique contre votre tête. La
poussière et le sable, tout comme le plastique et les cheveux forment des
paires triboélectriques. Le sable et la poussière ne sont pas
nécessairement faits du même matériau. Les plus petites particules de
poussières tendent à devenir des charges négatives, en prenant des
électrons aux grains de sable plus gros, grâce aux frottements engendrés
par les turbulences.
Puisque la colonne d'air chaud s'élève en générant le tourbillon, les
poussières plus légères, chargées négativement se trouvent en haut et
les grains sable plus lourds, chargés positivement, se trouvent en bas.
Cette séparation va provoquer la naissance d'un champ électrique. Sur Terre,
des champs de 20 000 V/m (volts par mètre) sont mesurés. Ce n'est rien
comparé aux champs électriques rencontrés dans les orages où la foudre
atteint des valeurs 100 fois plus élevées capables d'ioniser les
molécules d'air.
Mais à 20 kV/m ce n'est pas loin du claquage dans la faible atmosphère
martienne précise Farrell. Plus significatif, les tourbillons martiens sont
beaucoup plus grands que leur contrepartie terrestre car ils stockent des
énergies beaucoup plus intenses. Mais comment s'effectue la décharge ?
Existe-t-il des cas de foudre à l'intérieur des tourbillons ? Si la
foudre ne se produisait pas naturellement, la présence d'un véhicule, d'un
astronaute ou d'un habitat pourrait induire des décharges ou des arcs
électriques. Il faudra faire attention aux coins qui seront autant de point
d'amorçage. L'idéal sera d'avoir un véhicule ou un habitat rond.
Une
autre considération pour les astronautes qui sera un handicap, la charge
statique, à cause des antennes. De plus après, une fois que la saison des
tourbillons sera passée, il restera un phénomène collant. En effet la
charge statique, dans une ambiance très sèche, provoquera un collage de la
poussière sur tout. C'est d'ailleurs le problème qui gêna les astronautes
sur la Lune, à leur retour dans le LEM: l'impossibilité de se débarrasser
de la poussière.
Puisque les tourbillons de poussière
peuvent s'élever jusqu'à 8 000 m ou 10 000 m de haut, les météorologistes planétaires pensent
maintenant qu'ils peuvent être responsables de la quantité élevée de poussières
dans la haute atmosphère martienne. Il
est primordial pour des astronautes, que la poussière puisse
transporter les charges négatives dans la haute atmosphère.
Les charges s'accumulant au sommet d'un orage pourraient poser un risque à une
fusée décollant de Mars, comme c'est arrivé à Apollo 12 en novembre 1969 où
la fusée Saturne V a décollé de Floride pendant un orage: le déplacement de
la fusée a ionisé (décomposé) les molécules d'air, laissant une traînée
de molécules chargées derrière elle, mais proche du sol, provoquant un
éclair (une décharge électrique) qui a heurté le vaisseau spatial.
"Les marins d'autrefois, comme
Christophe Colomb, ont compris que leurs bateaux devaient être conçus pour des conditions atmosphériques
extrêmes" précise Farrell. " Pour concevoir une mission sur Mars, nous devons
connaître les conditions météorologiques extrêmes et ces extrêmes semblent être sous forme
tempêtes de poussières et de tourbillons".
-
Le
vent
Parfois des tempêtes locales donnent naissance à des vents
puissants, qui attisent des nuages de poussières denses, s'élevant
en tourbillons. Ils érodent et décapent la surface de Mars et
transportent la poussière d'un endroit à l'autre. Comme sur Terre,
les vents ont des cycles journaliers et saisonniers. Depuis des
milliards d'années, ces vents ont sculpté la physionomie de la
planète, mais comme au sol la densité de l'atmosphère ne
représente que moins de 1% de celle de la Terre, pour soulever la
poussière, la force du vent demande d'être 7 à 8 fois plus
importante. Tandis que les vents terrestres de 24 km/h peuvent
suffire, sur Mars, le mouvement d'une particule solide nécessite
des vents de plus de 180 km/h. En outre, Mars est cinglé par des jet-streams
qui atteignent des vitesses de 100 m/s.
Les dunes
de sables sont d'excellents exemples de l'action éolienne. Les
vents martiens collectent sans arrêt des particules du côté au
vent et déposent les plus grosses du côté sous le vent; ainsi,
les dunes roulent comme celles de nos déserts.
Les
particules déplacées par le vent sautent à la surface et
permettent le mouvement de celles que le vent seul ne pourrait
entraîner. Lorsque les vents s'intensifient, des particules de la
taille d'un grain de sable d'environ 0,16 mm, prennent un mouvement
de saltation. Les particules plus petites ont une plus grande
cohésion avec le sol et persistent au vent, mais lorsqu'elles sont
heurtées par un grain en saltation, elles sont projetées dans le
vent demeurer en suspension dans les nuages de poussière. Les
grains en saltation frappent aussi de plus grosses particules et les
poussent à la surface.

Mais les tempêtes globales de poussières offrent le témoignage de
plus spectaculaire de l'action éolienne. Pendant que les vents
martiens mugissent dans un monde autrement silencieux, ils excitent
souvent de petites tempêtes localisées, comme les vents terrestres
qui parfois fouettent les sols et forment des colonnes imposantes
appelées trombes. A mesure que ces tempêtes locales deviennent
plus fréquentes, elles se regroupent parfois et rejettent de
grandes quantités de poussière dans l'atmosphère, provoquant une
tempête qui englobe toute la planète. Lorsqu'une quantité
suffisante de poussière a été éjectée dans l'atmosphère, la
tempête peut s'alimenter elle-même en convertissant l'énergie
solaire en énergie éolienne. La poussière soulevée absorbe le
rayonnement solaire et chauffe l'atmosphère, donnant naissance à
des vents violents. Alors toute la planète est enveloppée d'un
voile opaque. En fin de compte, la
tempête, empêchant la chaleur du Soleil d'atteindre le sol,
s'apaise d'elle-même. A mesure, comme il n'y a pas de pluie pour
entraîner la poussière, celle-ci traîne pendant des semaines dans
l'atmosphère avant de se déposer lentement.

http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/04/30/2005.04.30.S0301128.gif
NASA/JPL/Malin Space
Science Systems
|

http://www.esa.int/images/s-015-050504-0143-4-3d-01_L.jpg
|
|
Cette image (17
km x 9 km) de la caméra stéréo de Mars Express montre des
"yardangs", structures sculptées par le vent de
sable, à proximité d'Olympus Mons par 6° N et 220°
W. Des particules de
sable ont été transportées par le vent et ont lentement
érodées la surface de la roche en place, comme une sableuse. Si les vents soufflent dans la même
direction pendant une période assez longue, des stries, comme
celles de la photo, peuvent se produire. Sur Terre, les restes de
ces structures qui n'ont pas été érodés, s'appellent des
yardangs. Résolution 20 m/pxl. |
L'image (ci-dessus) de Mars Global Surveyor montre des roches sédimentaires érodées par le vent dans Tithonium
Chasma, une des cuvettes du système de Valles Marineris. Elle fait
entre 10 et 110 km de large pour une profondeur maximale d'environ 4
000 m de profondeur. Les vents responsables de la majorité de l'érosion ont soufflé
du nord-est (coin supérieur droit), créant des yardangs (image
ci-contre - arêtes
créées par l'érosion éolienne) avec leurs extrémités coniques se dirigeant
en vent arrière. L'image fait ~1 km et est localisée par 4,6°S et
88,3° W. La résolution est de 13 m/pxl. Elle a été réalisée au
cours de l'orbite 887.
|