|
Création
des planètes 25/11/04
Les disques protoplanétaires entourant de nouvelles étoiles semblent
contenir les briques pour construire, dés le début, les planètes
telluriques, selon de nouvelles recherches d'une équipe de chercheurs
internationaux (voir à la fin de l'article). Les astronomes
se sont servis de l'interféromètre du VLT ( Very Large Telescope), le
VLTI de
l'ESO (European Southern Observatory) pour étudier les disques
entourant les jeunes étoiles, qui pourraient être semblables à celui qui
entourait notre propre Soleil, il y a 4,567 ( ±0,02%) milliards
années. Ils ont constaté que la partie intérieure de ces disques est très
riche en sable, prêt à être regroupé en masse compacte par gravitation dans des
roches de plus grandes en plus grandes jusqu'à former des
planètes.  Le thème, actuellement le plus en vue en astrophysique, la chasse aux
planètes comme la Terre autour de jeunes étoiles, a reçu un
petit coup de pouce de nouvelles études spectrales avec l'instrument
MIDI sur l'interféromètre du VLT. L'équipe internationale d'astronomes
a obtenu des spectres
infrarouges uniques des poussières au coeur des régions les plus
secrètes des disques protoplanétaires, autour de trois jeunes étoiles,
actuellement dans un état probablement très semblable à celui de notre
Système solaire, il y a 4,567 milliards d'années.
Le thème, actuellement le plus en vue en astrophysique, la chasse aux
planètes comme la Terre autour de jeunes étoiles, a reçu un
petit coup de pouce de nouvelles études spectrales avec l'instrument
MIDI sur l'interféromètre du VLT. L'équipe internationale d'astronomes
a obtenu des spectres
infrarouges uniques des poussières au coeur des régions les plus
secrètes des disques protoplanétaires, autour de trois jeunes étoiles,
actuellement dans un état probablement très semblable à celui de notre
Système solaire, il y a 4,567 milliards d'années.
Dans l'édition de cette semaine (fin nov 2004) du journal scientifique
Nature et grâce à la vue perçante et inégalée de l'interféromètre, ils montrent
que dans les trois, les bons ingrédients sont présents au bon endroit pour
former des planètes telluriques autour de ces étoiles.
Le Soleil est né il y a 4,567 milliards d'années à partir d'un nuage froid et massif
de gaz et de poussières interstellaires qui s'est effondré sous sa propre gravitation.
Après sa formation, il ne restait plus
que 0,133 % du disque de départ. Ce reliquat forma un disque de
poussières autour de la jeune étoile, d'où jaillit plus tard la Terre et
tous les autres objets qui forment le Système solaire, planètes,
astéroïdes et comètes.
Cette époque est bien loin, mais nous pouvons
être témoin du même processus en observant l'émission infrarouge des
étoiles très jeunes et des disques protoplanétaires autour d'eux.
Jusqu'ici l'instrumentation disponible n'avait pas permis une
étude de la distribution des différents composants de la poussière dans de tels disques; même les
plus connus sont trop lointains pour que les meilleurs télescopes les résolvent
simplement. Aujourd'hui, les nouvelles observations interféromètriques de trois jeunes étoiles par
l'équipe internationale, en utilisant la puissance combinée de deux télescopes de
8,2 m du VLT, distants l'un de l'autre de 100 mètres, ont permis de réaliser
une image d'environ 0,02 secondes d'arc pour mesurer l'émission infrarouge de la région
interne des disques autour de trois étoiles (correspondant approximativement à la taille de l'orbite de la
Terre autour du Soleil) et l'émission de la partie externe de ces disques.
Les spectres infrarouges correspondants ont fourni des informations cruciales
sur la composition chimique de la poussière dans les disques et également
sur la taille moyenne des grumeaux.
Ces observations pionnières montrent que
la zone interne des disques est très riche en grains cristallins
silicatés ("sable") et d'un diamètre moyen de 1 µm. Ils se sont constitués par coagulation
de grains de poussières beaucoup plus petits et amorphes (comme de la
suie) qui étaient omniprésents dans le nuage interstellaire qui a donné naissance aux étoiles et à leurs
disques. Les modèles prouvent que les grains cristallins devraient
être abondamment présents dans la partie intérieure du disque au
moment de la formation de la Terre. En fait, les météorites dans notre
propre Système solaire sont principalement composés de cette sorte de
silicates.
L'astronome hollandais Rens Waters, un membre de l'équipe de l'institut
d'astronomie de l'université d'Amsterdam est enthousiaste car avec tous
ces ingrédients en place et
la formation de grains de poussières de plus en plus gros , la
formation de blocs de pierre de plus en plus gros et finalement, la
formation de planètes comme notre Terre à partir d'un tel disque est
inévitable.
Les astronomes savent que pendant un certain temps, la plupart de la poussière dans les disques autour des
nouvelles étoiles, se composent de silicates. Dans le nuage
primordial cette poussière est amorphe, c.-à-d. les atomes et les molécules qui composent un grain de
poussière sont liés ensembles d'une manière chaotique et les grains sont
doux et très petits (grains de suie), en général d'une taille d'environ
0,1 µm. Toutefois, près des jeunes étoiles où la température et la
densité sont très élevées, les particules de poussières dans le
disque circumstellaire ont tendance à se coller ensemble de sorte que les grains deviennent plus
gros. En conséquence, la poussière, dans les régions les plus proches de l'étoile, est bientôt transformée à partir de
grains "primitifs" (petits et amorphes) en grains
"élaborés" (de plus en plus gros et cristallins).
Les observations spectrales des grains de silicate en bande infrarouge
moyenne (vers 10 µm) diront donc si les grains sont "primitifs" ou
"élaborés". Des anciennes observations des disques autour de jeunes étoiles ont
montré qu'un mélange de matériaux "primitifs" et "élaborés"
était présent, mais il était jusqu'ici impossible de dire dans quelle
partie du disque les différents grains se situés.
Grâce à
l'augmentation d'un facteur 100 de la résolution angulaire avec le VLTI et l'instrument extrêmement sensible
MIDI, des spectres détaillés infrarouges des diverses régions des disques
protoplanétaires autour de trois nouvelles étoiles, âgées seulement
de quelques millions d'années, prouvent maintenant que la poussière près de l'étoile est beaucoup plus
"élaborée" que la poussière
des régions externes du disque. Sur deux étoiles (HD 144432 et HD 163296) la poussière dans le disque
interne est assez "élaborée" tandis que la poussière dans le disque externe est presque
"primitive". Dans la troisième étoile (HD 142527) la poussière est
"élaborée" dans le disque entier. Dans la région centrale de ce disque,
elle est extrêmement "élaborée", homogène à la poussière complètement cristalline.
Une conclusion importante, issue des observations de VLTI,
est alors énoncée: des blocs en construction, devenant des planètes
telluriques, sont présents dans les disques circumstellaires dès
le début. C'est de la plus haute importance car cela indique que les planètes
telluriques (rocheuses) du type terrestre sont probablement tout
à fait banales dans les systèmes planétaires autres que le Système solaire.
Ces observations impliquent aussi l'étude des comètes. Certaines
(peut-être toutes) comètes du Système solaire semblent contenir
les deux sortes de poussières: "primitives" et
"élaborées". Les comètes furent formées en définitive
loin du Soleil, dans les régions externes du Système solaire où il
fait très froid. Toutefois, le processus qui a inclut les poussières
"élaborées" dans les comètes est inconnu.
Une théorie propose que la poussière "élaborée" est transportée à
l'extérieur du jeune Soleil par turbulence dans le disque circumsolaire
relativement dense. D'autres théories prétendent que la poussière
"élaborée" située dans les comètes a été produite localement dans les régions froides
sur une période beaucoup plus longue, peut-être par des ondes de choc ou
des coups de foudre dans le disque ou par des collisions fréquentes entre de plus grands
blocs.
Actuellement, l'équipe d'astronomes concluent que la première théorie
est l'explication la plus plausible pour expliquer la présence de la poussière
"élaborée" dans les comètes. Cela implique également que les comètes
à longue période, qui parfois nous rendent visite, proviennent des extensions externes de notre
Système solaire et sont véritablement des corps primitifs, remontant à une
période où la Terre et les autres planètes n'avaient pas été encore
formées. L'études de telles comètes, particulièrement in situ, fournira
l'accès direct à la matière originelle de laquelle le Système solaire
est issu.
L'équipe internationale était constituée de Roy van Boekel, Michiel Min, Rens
Waters, Carsten Dominik and Alex de Koter (Astronomical Institute,
University of Amsterdam, The Netherlands), Christoph Leinert,
Olivier Chesneau, Uwe Graser, Thomas Henning, Rainer Köhler and
Frank Przygodda (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg,
Germany), Andrea Richichi, Sebastien Morel, Francesco Paresce,
Markus Schöller and Markus Wittkowski (ESO), Walter Jaffe and
Jeroen de Jong (Leiden Observatory, The Netherlands), Anne Dutrey
and Fabien Malbet (Observatoire de Bordeaux, France), Bruno Lopez
(Observatoire de la Cote d'Azur, Nice, France), Guy Perrin (LESIA,
Observatoire de Paris, France) and Thomas Preibisch (Max-Planck-Institut
für Radioastronomie, Bonn, Germany).
Cet article est issu d'une collaboration avec l'Institut Astronomique de
l'Université d'Amsterdam (Hollande) (NOVA
PR) et de l'Institut Max
Planck pour l'Astronomie à Heidelberg (Allemagne) (MPG
PR). L'instrument
MIDI
est le résultat d'une collaboration entre des instituts d'Allemagne, de
Hollande et de France.
Voir ESO
PR 17/03 et ESO
PR 25/02 pour
plus d'informations voir les résultats dans ESO
Press Release à l'article "The building blocks of planets within
the "terrestrial" region of protoplanetary disks",
by Roy van Boekel et co-auteurs (Nature, 25 novembre 2004). Les observations ont été faites au cours
d'un programme de démonstration scientifique de l'ESO.
Retour Deep
Impact
M51
et Spitzer
25/11/04

http://ipac.jpl.nasa.gov/media_images/ssc2004-19a_small.jpg
| Credit:
NASA/JPL-Caltech/R. Kennicutt (Univ. of Arizona)/DSS |
Le
télescope spatial infrarouge Spitzer a photographié les galaxies
des "Chiens de chasse" révélant d'étranges
structures établissant un lien entre les bras spiraux faits de
poussières, de gaz et de populations stellaires des 2 galaxies.
L'image composite est fabriquée à partir de la lumière
invisible dans les longueurs d'onde de 3,6 µm (bleu), 4,5 µm
(vert), 5,8 µm (orange) et 8,0 µm (rouge). Ces longueurs
sont environ 10 fois plus grandes que celles visibles par l'oeil
humain.
L'image en lumière visible provient du télescope de 2,1 m du Kitt Peak National
Observatory et a la même orientation
et la même taille sur l'image infrarouge de Spitzer, mesurée
entre 9,9 et 13,7 minutes d'arc (nord en haut). En plus de l'image
composite en quatre couleurs, l'image en lumière visible montre des émissions de 0,4 à 0,7 microns, y compris
la structure nébuleuse en H-alpha (rouge dans l'image).
La lumière des images provient de sources très différentes. A des longueurs d'onde plus courtes (dans
la bande visible de 0,4 à 0,6 µn et dans l'infrarouge de 3,6 à 4,5 microns), la lumière vient
principalement des étoiles.
La lumière des étoiles s'atténue à de plus longues longueurs d'onde (5,8 à 8,0
microns), où nous voyons la lueur des nuages de poussières
interstellaires. Cette poussière consiste principalement en une variété de
molécules organiques à base de carbone connues comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Partout où ces composés sont
découvert, il y a également des grains de poussières et de gaz, qui fournissent un réservoir des
matières premières pour une future formation d'étoile.
La
grande quantité de filaments minces vus en infrarouge, entre les
bras de la grande spirale, est particulièrement inexplicable. Contrairement à la nature
petite et brillante de l'émission de poussières aperçues dans les bras eux-mêmes,
ces structures comme des spokes, sont minces et régulières et répandues
partout dans les espaces "vides" de la galaxie.
En outre,
il est à noter le contraste existant dans les distributions des poussières et des étoiles entre la spirale et son
petit compagnon. Tandis que la spirale est riche en poussières,
brillante dans les ondes plus longues de l'infrarouge et formant activement de nouvelles
étoiles, son compagnon bleu montre peu d'émission infrarouge et accueille une population stellaire plus âgée.
Les scientifiques pensent que la structure spectaculaire et la
formation d'étoiles dans M51 sont provoquées par une collision
avec son compagnon. L'observation de ce phénomène permettra de
mieux comprendre l'interaction entre les galaxies et la formation
d'étoiles.
La galaxie visée est connue
sous divers noms: M51 de sa désignation dans le catalogue de
Messier et également comme NGC 5194. M51
est une des découvertes originales de Charles Messier, trouvée en octobre 1773 tandis qu'il observait une
faible comète. C'est lui qui l'a appelé ainsi. Familièrement, M51 est également connu en tant que la " galaxie des
chiens de chasse", ou " galaxie de Rosse, " d'après lord Rosse, qui
détecta le premier sa structure spirale, alors qu'il observait
M51. Les anglo-saxons l'ont dénommée " Whirlpool Galaxy"
la galaxie du tourbillon. Son compagnon, NGC 5195 a été
découverte par Pierre Méchain en 1781.
M51 est la cible
favorite des astronomes professionnels et amateurs, tout comme
elle le fut pour le télescope infrarouge ISO (Infrared Space
Observatory). Découverte dans la constellation des "chiens
de chasse", M51 est à 37 millions d'al.
Les
observations de M51 font partie d'un projet scientifique, connu
sous le nom de "Surveillance de Galaxies dans le Proche
Infrarouge", qui comprend une étude complète des 75
galaxies les plus proches avec imageur infrarouge et spectroscope.
De ces données, les astronomes vérifieront les processus physiques
reliant la formation d'étoiles aux propriétés des galaxies. Cette information fournira une base essentielle
de données, d'outils diagnostiques et des entrées astrophysiques pour
comprendre l'univers profond, les galaxies ultra lumineuses, la
formation et l'évolution des galaxies.
Des
sauterelles sur Mars ?
25/11/04
Après
maints efforts, Spirit a juste réussi à traverser un terrain difficile
pour atteindre les collines Colombia. Une promenade d'une heure a
pris plusieurs mois. La NASA analyse une proposition de
Pioneer Astronautics qui envisage un véhicule pouvant débarquer sur Mars,
se réapprovisionner en combustible avec les matériaux locaux et puis
survoler sur des centaines de kilomètres les zones à explorer,
pouvant répéter ce processus à plusieurs reprises: l'avion
sauterelle.
Mi-atterrisseur, mi-avion, l'avion sauterelle est une conception
unique que la Nasa considère comme possible pour les
futures explorations martiennes. À la différence des
atterrisseurs, tels que Viking, Beagle 2, ou le prochain lander Phoenix, qui
peuvent seulement examiner quelques mètres carrés de terrain,
l'avion sauterelle pourrait débarquer, exécuter des analyses scientifiques et
s'élancer à nouveau pour voler sur des centaines de kilomètres
et se poser à un autre endroit.
L'avion sauterelle (ci-contre, à droite) obtiendrait son électricité d'un grand ensemble de
panneaux solaires construits sur ses ailes. Il utiliserait
l'électricité pour extraire le gaz carbonique de l'atmosphère
et le stocker sous forme liquide à l'intérieur de l'avion. Si la
quantité de gaz stockée était trop faible pour faire un vol, il
réchaufferait une couche de granules pour faire passer le CO2
à travers. Une fois chauffé, le gaz agirait comme un combustible
et permettrait à la "sauterelle" de s'élever
verticalement. Une fois en l'air, il pourrait alors allumer un
moteur arrière et commencer à voler comme avion, à l'aide de ses grandes ailes pour
monter et manoeuvrer. Quand il est prêt à atterrir, l'avion pourrait ralentir sa
vitesse et atterrit doucement comme un hélicoptère. L'idée
vient de Robert Zubrin (voir aussi homme
sur Mars), auteur
du The
Case for Mars, President de la Mars
Society et aussi President de Pioneer Astronautics. C'est un des 219 projets de recherches
sélectionnés par la Nasa dans la phase 1 du Small Business
Research And Technology Projects . Nous le voyons ci-cdontre avec
une maquette pour les tests afin de vérifier le concept.

Image credit: Pioneer Astro |
Zubrin
voit dans la "sauterelle" non seulement une
technique pour l'exploration de Mars, mais aussi une
démonstration du concept pour plusieurs défis techniques que la
Nasa aura à surmonter dans de futures missions robotisées ou
humaines. Zubrin explique que s'ils doivent concevoir une mission
de retour d'échantillons, il faudra savoir comment faire un
combustible pour le voyage de retour et la "sauterelle"
permettra également de tester plusieurs décollages et atterrissages
dans le but de vérifier toutes sortes de terrain.
Zubrin
ajoute que la "sauterelle" utilisera comme carburant le
dioxyde de carbone (CO2) indigène, ainsi il ne souillera pas le sol avec des
hydrocarbures. C'est important car la sonde en provenance de la
Terre utilisera des hydrocarbures qui contamineront le sol lors de
l'atterrissage, ce qui sera gênant pour une recherche de vie. Une fois que
la sauterelle pourra se déplacera, elle trouvera une surface
martienne vierge à explorer et non perturbée par ses
atterrissages et décollages successifs.
La
"sauterelle" récupère le CO2 de
l'atmosphère martienne et le stocke sous forme liquide à une
pression de 10 bars. Lorsqu'il y aura suffisamment de CO2
pour obtenir une trajectoire balistique intéressante, afin
d'atteindre un site digne d'intérêt, le réservoir de CO2 sera modérément chauffé pour le
porter à 70 bars. Le
carburant traverse ensuite une couche de granules chauffée, pour
élever la température du gaz qui sort sous forme de jet créant
la poussée. La "sauterelle" emploie le système de propulsion
au CO2 pour le décollage, le contrôle d'attitude et l'atterrissage.
A la différence des fusées chimiques, l'éjection du gaz ne souillera pas
le lieu d'atterrissage avec des produits organiques ou de l'eau.
Les capacités de vol s'étendront de 10 à 100 km. La
"sauterelle" pourrait voler impassible au-dessus du terrain
des rovers, photographiant tout ce qu'elle verra, fera de la
reconnaissance sur un site éloigné et revolera.
La "sauterelle" la plus simple sera réellement légère,
moins de 50 kilogrammes, comparé aux rovers actuels d'une masse
de 185 kg. Avec plus de poids, la sauterelle pourrait emporter quelques
mini-rovers, comme le minuscule Sojourner qui a visité Mars
lors de la mission Pathfinder. Ceux-ci
pourrait choisir des cibles plus intéressantes
en utilisant les "sauterelles" pour une reconnaissance
aérienne de la zone.
L'ignorance
totale du terrain est
un autre avantage de la
"sauterelle". Lorsque
la NASA choisit les emplacements d'atterrissage pour ses landers
martiens, elle a, à bon escient, choisi les endroits qui étaient relativement plats, ainsi les
rovers peuvent avancer à une vitesse optimale. La
"sauterelle" pourrait débarquer au bord d'un profond
chasma, examiner
la zone, sauter au fond et revenir. Cela donnera aux scientifiques
une flexibilité sans précédent pour rechercher la preuve du
passé aquatique de la planète rouge.
Naturellement, il y a une
complication. L'électricité est un élément limiteur de
performance de la
"sauterelle". L'électricité est nécessaire à la
pressurisation et au chauffage du propulseur à dioxyde de carbone.
Ce procédé consomme beaucoup de puissance et la
"sauterelle" aurait besoin d'un mois pour recharger ses
batteries en utilisant ses panneaux solaires.
Dans ce concept, l'énergie est
stockée dans des batteries et est alors utilisé pour chauffer le propulseur tandis qu'il traverse la
chambre. Un résistojet à
très haute puissance est utilisé pour stocker l'énergie, c'est
très simple, et a l'avantage que l'énergie requise pour
manoeuvrer les tuyères peut être stockée sur une longue
période réduisant de ce fait l'alimentation électrique pour les
autres systèmes, tels que le système pour réchauffer le lit de
granules.
Un
résistojet est la forme la plus simple de propulsion électrique.
Il suffit de chauffé le carburant, de l'eau ou du protoxyde
d'azote, à l'aide d'une résistance électrique. La pression
augmente permettant au gaz surchauffé de sortir par la tuyère.
La poussée et l'impulsion spécifique sont limitées par les
propriétés matérielles de la résistance. Des satellites furent
lancés avec ce système qui donna entière satisfaction. Par
exemple avec 2,06 g d'eau chauffée à 200°C la vapeur éjectée
a fourni une poussée de 0,003 N pendant 30 secondes. Ce
résistojet miniature a une masse de 13 g et a utilisé 3 W pour
le chauffage. C'est un système économique non polluant, qui
permet des micro impulsions.
Cependant, la puissance requise,
libérée des batteries, est très élevée. Par exemple,
une "sauterelle" avec une poussée de
668 N, un niveau 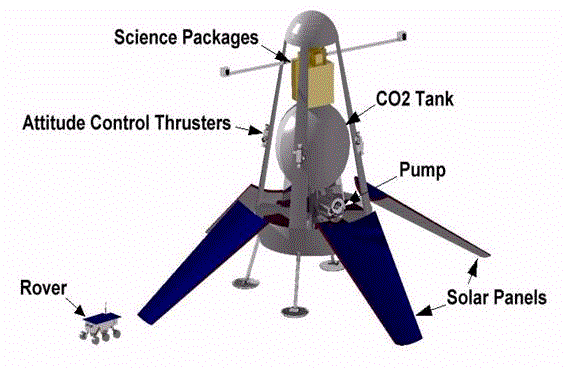 raisonnable,
donnerait un
engin d'une masse de 80 kilogrammes avec un rapport, au décollage,
masse/poussée de 2,25 sur Mars.
Une impulsion spécifique de 130 s (~700° C), donnera un
écoulement de 0,52 kg/s. Si le combustible
a été préchauffé, dans son
réservoir, à 30°C, 911 kJ/kg de chauffage seraient requis pour
chauffer le carburant dans le moteur. Avec un débit de 0,52 kg/s,
cela implique une puissance de 474 kW. Il n'est pas certain que
nous sachions un jour fabriquer des batteries supportant un tel
taux de décharges répétées. En outre, il convient noter que les batteries
courantes, telles que ion - lithium ont seulement une capacité de stockage
de ~125 Wh/kg (450 kJ/kg). Ainsi 2 kilogrammes de batteries seraient nécessaires pour chauffer
chaque kilogramme de CO2 à 700° C. Ce qui rendrait la
conception d'un véhicule avec un rapport de masse attrayant,
impossible. Si la température
du propulseur est abaissée à 600 K (327° C), alors seulement 468 kJ
seraient nécessaires pour chauffer chaque kilogramme de CO2 et les masses
batterie et propulseur seraient égales. Quand la charge utile et
la masse des autres systèmes seront prises en considération, ceci
permettra probablement à un véhicule électrique d'être construit avec un rapport de masse
d'environ 1,35 et une impulsion spécifique d'environ 90 s. Un vol
de 3,5 km sera possible. Ce n'est pas particulièrement attrayant, car
c'est presque équivalent à une "sauterelle" froide,
beaucoup plus simple. Cependant, de nouvelles technologies pour
les batteries sont actuellement à l'étude qui pourraient fournir le double
ou le triple de la puissance fournie par les batteries actuelles
ion - lithium. Ainsi le vol pourrait être porté à 7 ou 10 km, ce qui serait une
nette amélioration. raisonnable,
donnerait un
engin d'une masse de 80 kilogrammes avec un rapport, au décollage,
masse/poussée de 2,25 sur Mars.
Une impulsion spécifique de 130 s (~700° C), donnera un
écoulement de 0,52 kg/s. Si le combustible
a été préchauffé, dans son
réservoir, à 30°C, 911 kJ/kg de chauffage seraient requis pour
chauffer le carburant dans le moteur. Avec un débit de 0,52 kg/s,
cela implique une puissance de 474 kW. Il n'est pas certain que
nous sachions un jour fabriquer des batteries supportant un tel
taux de décharges répétées. En outre, il convient noter que les batteries
courantes, telles que ion - lithium ont seulement une capacité de stockage
de ~125 Wh/kg (450 kJ/kg). Ainsi 2 kilogrammes de batteries seraient nécessaires pour chauffer
chaque kilogramme de CO2 à 700° C. Ce qui rendrait la
conception d'un véhicule avec un rapport de masse attrayant,
impossible. Si la température
du propulseur est abaissée à 600 K (327° C), alors seulement 468 kJ
seraient nécessaires pour chauffer chaque kilogramme de CO2 et les masses
batterie et propulseur seraient égales. Quand la charge utile et
la masse des autres systèmes seront prises en considération, ceci
permettra probablement à un véhicule électrique d'être construit avec un rapport de masse
d'environ 1,35 et une impulsion spécifique d'environ 90 s. Un vol
de 3,5 km sera possible. Ce n'est pas particulièrement attrayant, car
c'est presque équivalent à une "sauterelle" froide,
beaucoup plus simple. Cependant, de nouvelles technologies pour
les batteries sont actuellement à l'étude qui pourraient fournir le double
ou le triple de la puissance fournie par les batteries actuelles
ion - lithium. Ainsi le vol pourrait être porté à 7 ou 10 km, ce qui serait une
nette amélioration.
Pour produire plus d'électricité, la NASA pourrait
employer un générateur thermique à radio-isotope, semblable à ceux
transporté par Cassini, les landers de Viking, ou le laboratoire
scientifique de la prochaine mission pour Mars 2009.
Avec un système électrique plus puissant,
la "sauterelle" pourrait décoller tous les jours et
serait capable de parcourir la planète entière.
Ainsi, tout en posant quelques
problèmes, la "sauterelle" électrique offre beaucoup d'espoir.
Ce projet a donc été choisi pour l'examen expérimental
lors de la phase I
Pioneer
Astronautics,
la compagnie de
Zubrin a déjà effectué une série de tests et de recherches sur
le concept et ils ont développé un prototype pour le JPL (Jet
Propulsion Laboratory) en 2000. Le moteur fonctionne correctement
en laboratoire et ils sont capables d'obtenir un contrôle à
distance du véhicule d'une masse de 50 kg pour voler dans une
gravité martienne simulée (en utilisant un ballon à l'hélium
pour assurer la stabilité).
Au lieu de rester dans un
endroit ou de progresser lentement à la surface de Mars, les futurs
robots explorateurs pourront s'élever dans les cieux pour visiter la planète rouge.
Ils offriront ainsi des capacités uniques pour explorer la
surface martienne.
De Fraser Cain
et du dossier
complet: http://www.pioneerastro.com/MGH/Gashopper_final_report.doc
Les projets de
Zubrin: http://www.pioneerastro.com/projects.html
USA
sur la Lune en 2010
25/11/04
|

Image du pôle sud et du bassin Aitken.
Credits: Clementine mission, NASA, DoD.
|
Selon
un scientifique, les USA pourrait lancé une mission en 2010
où débarqueraient deux robots fixes sur la Lune pour rassembler des échantillons de roches
et les retourner sur Terre.
Carle Pieters du département des sciences géologiques de
l'université Brown, impliqué dans le programme spatial
américain, a déclaré qu'ils avaient l'intention d'une mission
lunaire dans le plus grand bassin et le plus ancien des cratères
au pôle sud: Aitken.
Le but est d'étudier
l'âge de formation de ce bassin et de ramener sur Terre, des
matériaux issus des profondeurs pour les analyser et comprendre
la manière dont ce sont formés les bassins.
Pieters est également la
présidente du groupe de travail pour l'exploration lunaire internationale, une organisation formée pour encourager
la coopération entre les nations.
Plus de 200 délégués de 16 pays
participèrent à la conférence internationale sur
l'exploration et l'utilisation de la Lune dans la ville d'Udaipur
au nord de l'Inde qui dura cinq jours
et qui prit fin le vendredi 19
novembre 2004.
Carle Pieters a déclaré
à la fin de la conférence que les scientifiques des USA
pensaient que des d'atterrissages dans le bassin Aitken seraient
intéressants pour recueillir des échantillons issus des
profondeurs. Chaque robot recueillera 1 kg de roches et de fragments qui
donneront un aperçu de l'histoire géologique du bassin.
SpaceDaily
Beaucoup
veulent la Lune
24/11/04
La décennie suivante verra des nations
se "battre" pour construire des avant-postes sur la Lune
ayant chacune une stratégie différente s'adaptant pour l'utiliser
comme une base pour explorer l'espace, selon des scientifiques
présents à la conférence sur l'exploration lunaire.
Les Etats-Unis font bon accueil à la concurrence, tandis que les
Européens et d'autres programmes nationaux favorisent une base
lunaire comme un village robotique coopératif, avec un règlement où
chaque nation aurait son propre endroit sur la Lune.
Les Indiens, comme les Japonais,
comptent sur une mission lunaire pour galvaniser la communauté scientifique alors que les plans de la Chine
ne sont pas très clairs.
S'ils veulent
concourir, alors laissez-les concourir, cela stimule l'innovation
a déclaré Paul Spudis, scientifique planétaire à l'université
John Hopkins et conseiller à la Nasa, à la conférence internationale sur
l'exploration et l'utilisation de la Lune dans la ville d'Udaipur
au nord de l'Inde qui dura cinq jours
et qui prit fin le vendredi 19
novembre 2004.
Les Etats-Unis projettent
un orbiter lunaire en 2008 suivi, peut-être suivi l'année suivante
par un atterrissage. Un homme serait prévu pour 2015.
Spudis
continua en disant que le but de
cette nouvelle vision est de couper le cordon qui nous relie à la
Terre et de créer la capacité d'aller ailleurs dans le Système solaire
qu'importe les possibilités et pas seulement avec des hommes, mais
aussi avec des robots ou de radars.
Le
dernier homme à être allé sur la Lune fut l'astronaute Eugène
Cernan le 11 décembre 1972, 3 ans après Neil Armstrong qui
fut le premier le 21 juillet 1969.
D'autres puissances spatiales, telle l'Europe, ont des plans pour
bâtir un village robotique sur la Lune en 2014 avec une base lunaire permanente
afin d'exploiter des ressources et projeter un voyage à Mars.
A
un certain moment la Lune sera une grande place pour faire des choses ensemble. C'est un concept que nous proposons
pour l'avenir explique Foing, dont le groupe coordonne les plans parmi les agences internationales
comprenant les USA, la Russie, le Japon, la Chine et l'Inde et l'Europe.
Il est aussi responsable scientifique de l'ESA.
Le Japon sera le premier
à envoyer un Orbiter autour de la Lune en 2006. La Chine pourrait
suivre avec une mission lunaire inhabitée, suivi de l'Inde en 2007 ou 2008.
L'ESA
(Agence spatiale européenne) a planifié le lancement d'un
Orbiter autour de la Lune pour 2008 et une deuxième mission, un
Lander (atterrisseur) en 2009 ou 2010 suivi d'un vol humain en 2020.
Wu
Ji un scientifique du centre spatial chinois et de recherches
appliquées a indiqué que
le programme lunaire de son pays serait la 3e étape importante
après
avoir envoyé des satellites et, l'année dernière, effectué un
vol habité autour de la Terre. Il a déclaré que
la mission lunaire sera le point de départ
d'une exploration de l'espace lointain. Nous ne parlons pas d'une mission
habitée. Elle est hors de question actuellement.
Madhavan Nair, chef de l'ISRO (organisation indienne de recherches
spatiales), a indiqué qu'une mission lunaire automatique améliorerait les possibilités technologiques du pays et fournirait
des opportunités aux scientifiques planétaires.
En attendant, l'ancien directeur de l'institut
Tata de recherche fondamentale à Bombay, M. G. K. Menon, avertis
les scientifiques de ne pas coloniser la Lune. On ne
devra pas traiter la Lune comme un objet où nous nous
affronterons pour le prestige et pour être juste le premier à
l'occuper.
Le Traité
de 1979 sur la Lune, pour empêcher qu'elle ne devienne un secteur
de conflit international, a été seulement ratifié par neuf nations.
Il a été rejeté par les Etats-Unis et la Russie.
Related Links
SpaceDaily
Galaxie
de Seyfert M106
ou NGC 4258
24/11/04
![[m106.jpg]](http://www.seds.org/messier/JpgSm/m106.jpg) Les galaxies de Seyfert doivent
leur nom à Carl K. Seyfertqui en 1943, les décrivit comme
possédant des régions centrales ayant des spectres particuliers
avec lignes d'émission notables. Elles
ont un noyau actif dont les composants non stellaires
émettent en puissance. Des jets de particules relativistes bien
collimatées jaillissent du centre de nombreux noyaux actifs et se
prolongent sur des kiloparsecs. Les
chercheurs pensent que généralement " les moteurs centraux " de ces galaxies
sont des trous noirs supermassifs accrétés, avec les masses chiffrées
en millions de masses solaires. Ces trous noirs peuvent en fait être les restes
de quasars, qui étaient nombreux il y a bien longtemps et aujourd'hui sont observés seulement
à de grands décalages vers le rouge (redshift). http://www.seds.org/messier/JpgSm/m106.jpg
Les galaxies de Seyfert doivent
leur nom à Carl K. Seyfertqui en 1943, les décrivit comme
possédant des régions centrales ayant des spectres particuliers
avec lignes d'émission notables. Elles
ont un noyau actif dont les composants non stellaires
émettent en puissance. Des jets de particules relativistes bien
collimatées jaillissent du centre de nombreux noyaux actifs et se
prolongent sur des kiloparsecs. Les
chercheurs pensent que généralement " les moteurs centraux " de ces galaxies
sont des trous noirs supermassifs accrétés, avec les masses chiffrées
en millions de masses solaires. Ces trous noirs peuvent en fait être les restes
de quasars, qui étaient nombreux il y a bien longtemps et aujourd'hui sont observés seulement
à de grands décalages vers le rouge (redshift). http://www.seds.org/messier/JpgSm/m106.jpg
En
1995, des recherches entreprises à l'aide du Radio Télescope Very
Large Baseline Array ont apporté des informations tendant à
prouver que NGC 4258 (M106) abriterait un objet sombre et massif,
qui pourrait nous amener à une distance du centre la plus faible
possible à ce jour : apparemment 36 millions de masses solaires
se trouveraient dans un volume de rayon compris entre 1/24 et 1/12
d'année-lumière (27 000 et 54 000 UA). Ce serait alors
la concentration de matière la plus dense jamais détectée.
Une
équipe de radio-astronomes du centre d'astrophysique du Harvard-Smithsonian,
de l'Observatoire
National de Radio Astronomie et de l'Observatoire National
d'Astronomie du Japon ont fait des recherches sur une galaxie de
Seyfert proche, NGC 4258 (M16),
type SBbc, dans les Chiens de Chasse. Cette galaxie a
un disque de matière dense entourant cet objet agit
comme un "maser" (Microwave Amplifier by
Stimulated Emission of Radiation), c'est à dire un laser
à micro-ondes. Elle montre
aussi des micro-ondes émises par de la vapeur d'eau
profondément enfouie au coeur du noyau. L'émission
micro-onde n'est pas atténuée par la poussière et le gaz qui
enveloppent les noyaux galactiques et rend souvent l'étude avec les télescopes optiques très
difficile. Quant à la vitesse de galaxie, le spectre d'émission de l'eau dans
NGC 4258 (M16) trahit
la majorité du mouvement du gaz dans le noyau à des vitesses d'à
peu près 1 000 km/s. Ce résultat saisissant a incité une observation coordonnée avec
le réseau de radiotélescopes à longue base qui a permis de
cartographier l'émission de l'eau avec une résolution angulaire
sur la voûte céleste inférieure à 0,001 seconde d'arc.
Depuis les années 1950, NGC 4258 (M106) est réputée pour avoir
une extension plus importante en rayonnement radio qu'en lumière
visible.
L'image
ci-dessous est une vue d'artiste sur le noyau de NGC 4258 (M16). Le
"moteur central" du présumé trou noir est entouré par
un disque moléculaire très mince et légèrement vrillé.
Les faisceaux bleus jaillissant du trou noir le long de l'axe de
rotation du disque représentent des jets de particules relativistes.
Le dessin a été préparé pour
M. Inoue (NAO) par J. Kagaya (Hoshi No Techou).
| 




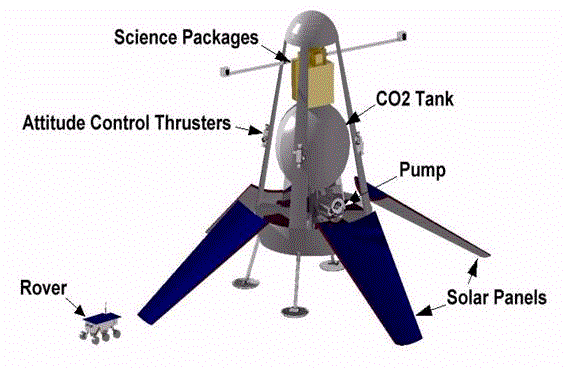

![[m106.jpg]](http://www.seds.org/messier/JpgSm/m106.jpg)



