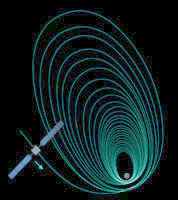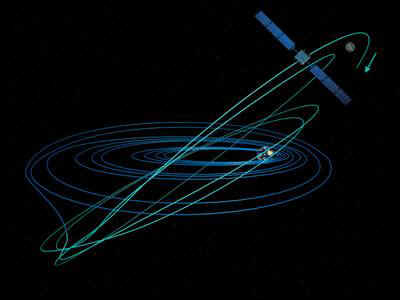|
Exoplanètes
et µ Arae d,
la 1ère super Terre
31/8/04
Une équipe d'astronomes européens
a découvert la plus légère exoplanète. Cette nouvelle exoplanète
orbite autour de l'étoile brillante µ Arae (l'Autel) localisée dans la
constellation de l'altar dans l'hémisphère sud. Elle se trouve à 50 al
de nous. De magnitude 5, µ Arae est visible à l'oeil nu. C'est la
seconde planète découverte qui tourne en 9,5 jours à 0,09 UA autour de
son étoile. Avec une masse de 14 fois la Terre, elle se trouve au seuil
des planètes rocheuses qui en fait une super Terre. Cet
objet (µ Arae d) est considéré être une planète avec un noyau rocheux entouré
par une petite (de l'ordre du 0,1 fois la masse) enveloppe gazeuse. Elle
se trouverait à la croisée des chemins entre les planètes gazeuses et
les rocheuses. Elle possède la
masse d'Uranus, la plus petite de planète gazeuse. Toutefois elles sont
différentes par la distance à leur étoile, leur formation et leur
structure. Uranus est à 19 UA du Soleil et orbite en 84 ans.
2 planètes de la taille de
Jupiter furent déjà découverte autour de µ Arae. La planète
"b" a 1,7 masses de Jupiter et orbite à 1,5 UA de l'étoile sur
une orbite fortement elliptique de 638 jours terrestres. La planète
"c" de 1 masse de Jupiter orbite à 2,3 UA de l'étoile sur une
orbite excentrique de 1 300 jours.
Cette nouvelle
découverte est l'oeuvre du nouveau spectrographe Harps (High
Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) mis en oeuvre par une
équipe du consortium européen ESO, dirigée par Michel Mayor de
l'observatoire de Genève. Harps installé sur le télescope de 3,6 m de
La Silla, permet des mesures de vitesse radiale avec une précision
inférieure à 1 m/s. Ceci est mis en application au sein d'une nouvelle
science: l'astrosismologie, technique qui étudie les petites ondes
acoustiques provoquées par les pulsions de l'astre, qui vibre en suivant
les variations des planètes sur leurs orbites.
Voici donc encore une
démonstration du leadership européen dans la course aux exoplanètes.
Depuis 1995 avec la découverte
de 51 Peg par Michel Mayor et Didier Queloz, les astronomes ont appris que
le Système solaire n'est pas unique et que plus de 120 exoplanètes ont
été découvertes, le plus souvent par la mesure de la vitesse radiale.
La grande découverte fut la migration planétaire, où des planètes
géantes ne se retrouvent pas à l'endroit de leur naissance.
Le spectrographe Harps permet de
mesurer les progrés accomplis en comparant avec Coralie, un autre grand
chasseur d'exoplanètes installé sur le télescope suisse Euler de 1,2 m
à la Silla. Le temps d'observation à été réduit d'un facteur 100
tandis que la présicion des mesures augmentait d'un facteur 10.
L'avenir est réservé aux
missions COROT, Eddington et KEPLER qui permettront de mesurer les rayons.
Un papier de l'ESO est disponible http://www.oal.ul.pt/~nuno/
ESO
COROT
Overview at ESA
SpaceDaily
Mars Express
et Valles Marineris
30/8/04
Je dédis cette splendide image à ceux qui doutent des qualités de la
technologie et des équipes européennes, qui jouent à égalité avec
celles d'outre-atlantique.

http://www.esa.int/images/0533_3d_Eos_narrow_3x_exagg,1.jpg
Credits: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)
Cette image, prise par la
caméra stéréoscopique à haute résolution (HRSC) à bord de la sonde
européenne Mars Express, montre une partie de Valles Marineris, la grande
faille de 5 000 km de longueur, de 100 km de large et de 8 000 m de
profondeur. Ici c'est Eos Chasma qui fut photographiée lors de l'orbite
533 en juin 2004. L'image est centrée sur 322° de longitude et 11° de
latitude sud. La résolution est de 80 m/pxl.
La
perspective a été exagérée d'un facteur 4, calculée à partir du
modèle numérique du terrain fourni par les images stéréoscopiques. La
résolution a été réduite pour une diffusion sur internet.
Mars
express est en orbite depuis le 25 décembre 2003. 6 jours avant
l'insertion sur orbite, elle avait largué la petite sonde Beagle 2 qui
s'est écrasé sur le sol martien. Une mauvaise gestion du programme
anglais est à l'origine de l'échec.
Smart
30/8/04
Smart 1 a été lancé de
Kourou le 27 septembre 2003. Au
25 août 2004, le demi-grand axe était passé de
24 626 km à 139 307 km. Le périgée est passé de 656
km à 31 413 km et l'apogée de 35 880 km à plus de 230 000 km. La
période orbitale est passée de 10h41mn à environ 6 jours. 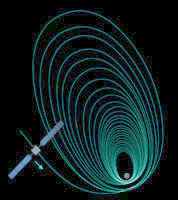 Après le lancement, Smart 1
employa son moteur ionique pour se déplacer en spiralant, grâce à la
mécanique céleste (comme l'attraction gravitationnelle), autour de la
Terre jusqu'à ce que la gravité lunaire l'attrape et qu'elle tombe vers
la Lune. L'orbite opérationnelle finale est une orbite elliptique polaire,
s'étendant de 300 à 10 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.
Elle scrutera le pôle sud pour rechercher l'eau, sous forme de glace,
dans le cratère Aiken.
Après le lancement, Smart 1
employa son moteur ionique pour se déplacer en spiralant, grâce à la
mécanique céleste (comme l'attraction gravitationnelle), autour de la
Terre jusqu'à ce que la gravité lunaire l'attrape et qu'elle tombe vers
la Lune. L'orbite opérationnelle finale est une orbite elliptique polaire,
s'étendant de 300 à 10 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.
Elle scrutera le pôle sud pour rechercher l'eau, sous forme de glace,
dans le cratère Aiken. 
Smart 1 est la première petite mission à faible coût de recherche
avancée de l'ESA. Il se dirige vers la Lune en utilisant des techniques révolutionnaires de propulsion et
embarque une batterie d' instruments miniaturisés. Tout
en testant de nouvelles technologies, Smart 1 fera le premier inventaire complet des
principaux éléments chimiques de la surface lunaire. Il étudiera également la théorie que la lune a été formée après
la violente collision de la Terre avec un planétoïde, lors de la
guerre des mondes, il y a moins de 4,5 milliards d'années.
Le
19 août à 17h56 UT, la sonde européenne Smart 1 se trouvait à 197 000
km de la Lune et 230 000 km de la Terre. Mais
elle
était toujours dans la sphère d'influence de la Terre dont la masse plus importante. Le domaine lunaire débute
au point lagrange 1 (L1) entre 50 000 km et 60 000 km de la
Lune. Jusqu'à 25 août, à la 266e impulsion du moteur, le système électrique de la propulsion
Smart 1 avait cumulé un total de presque 3 146 heures, consommé environ 49 kilogrammes de xénon et
donné au vaisseau spatial un incrément de vitesse d'environ 2 330 ms-1.
Le but principal de la mission Smart 1 est
l'essai en vol d'une nouvelle technologie de moteur ionique, une sorte de
propulseur actionné par l'énergie solaire, qui est dix fois plus efficace que les systèmes
chimiques traditionnels utilisés pour voyager dans l'espace. Si tout va
bien de tels systèmes pourraient être installés sur les futures sondes
interplanétaires de l'ESA comme Bepi Colombo (mission vers
Mercure). C'est la seconde fois que la propulsion ionique est
utilisée dans une mission principale (la première étant Deep Space 1 de
la Nasa, lancée en 1998). L'ESA a testé le moteur sur le satellite de
télécommunications Artémis. Artemis
lancé de Kourou à bord d’une Ariane-5, le jeudi 12 juillet 2001, a été
injecté sur une orbite plus basse que celle qui était prévue en raison
d’un dysfonctionnement de l’étage supérieur du lanceur. Puisque le
satellite était équipé d’un système de propulsion ionique pour ses
manœuvres de maintien à poste, les ingénieurs ont pu utiliser la
plupart des ergols chimiques qui se trouvaient à son bord pour relever
son orbite jusqu’à l’altitude voulue. Ce fut un succès pour le
moteur.
Fonctionnant dans le vide spatial, les moteurs d'ioniques éjectent à
l'extérieur un gaz propulseur beaucoup plus rapidement qu'une fusée chimique.
Ils délivrent 10 fois plus de poussée par kilo de carburant utilisé. Les ions, qui donnent aux moteurs leur nom, sont les atomes chargés
et accélérés électriquement par un canon à électrons. Si la
puissance vient des panneaux solaires, la technique s'appelle: "
propulsion hélioélectrique", couramment dénommée SEP (Solar
Electric Propulsion) ou propulsion ionique.
Les moteurs d'ioniques fonctionnent d'une manière modérée.
En comparaison, les panneaux solaires d'une taille normale assurent seulement
quelques kilowatts de puissance, un moteur ionique à panneaux solaires ne peut
donc pas concurrencer l'éjection d'une fusée chimique. Mais une fusée chimique typique ne brûle que durant quelques minutes
seulement. Un moteur d'ionique peut continuer à pousser doucement pendant des mois
voire même des années, tant que le soleil brille et le petit approvisionnement
en carburant du propulseur dure.
Le
moteur ionique de Smart 1 est basé sur un propulseur à plasma
stationnaire à effet Hall, le PPS-1350 développé par SNECMA, France. L'utilisation
intelligente du moteur d'ionique a permis d'économiser beaucoup de carburant et
la sonde attendra la Lune plus tôt que prévu.
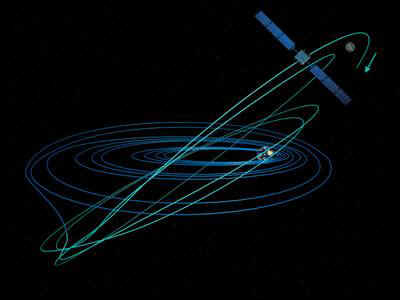 Presque 20 kilogrammes de xénon pourraient être
économisés sur les 84 kilogrammes du départ et être employés pour
s'approcher plus près de la Lune que prévu, entre 300 et 3 000 kilomètres,
afin d'obtenir la couverture de la surface lunaire en plus haute
résolution et avec une plus grande sensibilité. Cependant, l'influence de la gravité
lunaire sur l'orbite Smart 1 sera suffisamment importante pour la modifier
d'une manière significative. L'effet produit est semblable à
celui produit pendant un survol planétaire, la réaction de gravitation.
Typiquement dans un
survol, le passage de la sonde au plus proche de la planète ou de la lune a lieu
à l'intérieur de la sphère d'influence (approximativement 60 000 kilomètres pour la lune).
Dans un tel cas, la sonde acquiert un changement important de sa
trajectoire selon l'interaction gravitationnelle avec le corps plus gros.
Ceci a été mis en pratique pour la
première fois avec la sonde américaine Mariner 10 en 1973. Depuis, cette
technique est utilisée à chaque mission, permettant de gagner de la
masse et de la vitesse au détriment du temps de voyage. Les missions
Voyager en sont l'exemple le plus célèbre, qui utilisèrent les
planètes géantes comme tremplin gravitationnel pour sauter de planète
en planète.
Presque 20 kilogrammes de xénon pourraient être
économisés sur les 84 kilogrammes du départ et être employés pour
s'approcher plus près de la Lune que prévu, entre 300 et 3 000 kilomètres,
afin d'obtenir la couverture de la surface lunaire en plus haute
résolution et avec une plus grande sensibilité. Cependant, l'influence de la gravité
lunaire sur l'orbite Smart 1 sera suffisamment importante pour la modifier
d'une manière significative. L'effet produit est semblable à
celui produit pendant un survol planétaire, la réaction de gravitation.
Typiquement dans un
survol, le passage de la sonde au plus proche de la planète ou de la lune a lieu
à l'intérieur de la sphère d'influence (approximativement 60 000 kilomètres pour la lune).
Dans un tel cas, la sonde acquiert un changement important de sa
trajectoire selon l'interaction gravitationnelle avec le corps plus gros.
Ceci a été mis en pratique pour la
première fois avec la sonde américaine Mariner 10 en 1973. Depuis, cette
technique est utilisée à chaque mission, permettant de gagner de la
masse et de la vitesse au détriment du temps de voyage. Les missions
Voyager en sont l'exemple le plus célèbre, qui utilisèrent les
planètes géantes comme tremplin gravitationnel pour sauter de planète
en planète.
Smart a subi une perturbation, alors qu'il n'était pas encore dans la
sphère d'influence lunaire.
Il est beaucoup plus difficile
de naviguer dans ces régions, où plus d'un corps planétaire affectent le vol
du vaisseau spatial. Ces scénarios tombent dans le royaume de la
mécanique à plusieurs corps, qui est le sujet de prédilection des
mathématiciens. L'équipe de vol de l'ESA utilise de puissants
calculateurs pour assurer les changements voulus en altitude et argument du
périgée.
Puisque l'orbite de la Lune est fixe, la période orbitale de Smart 1 est
modifiée pour assurer à la sonde, son apogée au plus près de la Lune.
Ces rencontres se produisent tous les 27,4 jours, en phase avec l'orbite
lunaire. Smart 1 est en résonance avec la Lune. Les prochaines
résonances sont programmées pour le 15 septembre et le 12 octobre.
L'arrivée dans la sphère influence lunaire est prévue pour le 17
novembre. La propulsion électrique devrait alors reprendre le 20 novembre pour
une orbite polaire à 300 kilomètres de périlune et 3 000 kilomètres d'apolune.
La commission lunaire se réunira à la mi-janvier
2005 et les opérations scientifiques lunaires débuteront en février 2005.
Smart 1 célébrera sa première année dans l'espace le 27 septembre 2004
et l'équipe Sciences et Technologie tiendra un atelier les 26 et 27
octobre pour passer en revue les démonstrations technologiques, les résultats de
la croisière et la future planification de l'instrumentation
scientifique. spirales:
http://www.esa.int/images/img16b_M.gif Impact:
http://www.esa.int/images/img08_S.jpg voir
l'animation: http://www.esa.int/images/animation_L,0.gif orbites:
http://www.esa.int/images/img16a_L.gif ESA:
Smart
1
Bilan
d'Odyssey autour de Mars
25/8/04
Depuis
février 2002 la sonde spatiale Odyssey a examiné Mars sous toutes les
coutures. Aujourd'hui elle entame sa mission étendue jusqu'en septembre
2006, après avoir remplie sa mission principale. Elle découvrit de
vastes quantités d'eau gelée, a examiné des choix pour de futurs
astronautes, cartographié la surface et les minéraux recouvrant le sol
et d'autres quantités d'exploits.
Le but
suivant est d'étudier les changements climatiques. D'autre part elle doit
servir de support aux prochaines missions. Elle continuera à servir de
relais aux 2 rovers. Elle cherchera aussi des sites d'atterrissage pour la
mission Phoenix de Mars 2008. Elle aidera la mission de mars 2006 avec MRO
(Mars Reconnaissance Orbiter) qui doit étudier l'atmosphère pour les
futures missions.
Odyssey fut
lancée le 7 avril 2001 et utilisa l'aérobraking (freinage atmosphérique)
pour se mettre en orbite le 23 octobre 2001. Elle transporte 3 instruments
de recherche: une caméra infrarouge, une caméra en lumière visible, un
spectromètre composé d'un spectromètre à rayons gamma, d'un
spectromètre à neutron, un détecteur de neutrons à haute énergie et
un détecteur de radiation. Un
mois après les premières mesures une découverte majeure fut révélée:
l'abondance de l'hydrogène au pôle sud. Les chercheurs pensent que
l'origine se trouve dans l'eau gelée, suffisamment pour recouvrir le lac
Michigan d'une couche de un mètre.
Voici quelques événements importants:
-
Pendant que l'été arrivait dans
l'hémisphère nord et que la calotte polaire nord de dioxyde de
carbone gelé se rétrécissait, Odyssey trouva aussi de l'eau congelée
en abondance dans le nord.
-
La carte infrarouge montra que
l'olivine était répandue. Cela indique que l'environnement a été
assez sec, car l'eau change l'olivine en d'autres minéraux.
-
Les résultats ont indiqué que la quantité
d'eau congelée dans quelques régions relativement chaudes de Mars, est trop grande pour
être en équilibre avec l'atmosphère, suggérant que Mars puisse passer par une période de changement
climatique. Des détails, visibles sur quelques images d'Odyssey,
proches de petites coulées jeunes, peuvent être des zones
concentrées de neige fondant lentement, résidu d'une période
glaciaire martienne.
-
La première expérience envoyée sur
Mars en vue des missions humaines, a constaté que le niveau de rayonnement
autour de Mars, issus des éruptions solaires et des rayons cosmiques,
est deux à trois fois plus élevé qu'autour de la terre.
-
La caméra d'Odyssey a obtenu des
détails les plus fins jamais obtenus de la surface totale de Mars
avec des images infrarouges d'une résolution de 100 mètres.
Pour Robert
Mase du JPL responsable de la mission, toute la mission a été accomplie
et même plus. Bien qu'une éruption solaire exceptionnellement puissante, en
octobre 2003, ait détruit l'instrument de mesure du rayonnement
environnant, Odyssey est en bon état. Il reste assez de carburant à bord
pour continuer à fonctionner pendant cette décennie et un taux de consommation courante.
Météorites
et phosphore
24/8/04
Les scientifiques
de l'université d'Arizona ont découvert que les météorites,
particulièrement celles de fer, peuvent avoir joué une part active dans
l'évolution de la vie sur Terre. Leurs recherches montrent que leur
apport a enrichi le taux de phosphore terrestre pour produire des
biomolécules qui, éventuellement, se sont organisées pour aboutir à la
vie.
Le
phosphore est au centre de la vie. Il forme l'épine dorsale de l'ADN et de l'ARN parce qu'il relie les
bases génétiques de ces molécules dans de longues chaînes. Il est essentiel au métabolisme parce qu'il est lié avec
le
carburant fondamental de la vie, le triphosphate d'adénosine (ATP), l'énergie qui
déclenche la croissance et le
la paroi de la cellule et de l'os des vertébrés. En terme de masse le
phosphore est le 5e plus important élément biologique après le carbone,
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, mais il est beaucoup plus rare
qu'eux.
Mais un
mystère subsiste. Où la vie terrestre a-t-elle obtenu son phosphore
? Nous savons seulement qu'il s'est ajouté.
Matthew A.
Pasek, un candidat au doctorat à l'université d'Arizona au département
sciences planétaires et au laboratoire planétaire et lunaire, cite une
récente étude montrant qu'il y a un atome de phosphore pour 2,8 millions
d'atomes d'hydrogène dans le cosmos, 49 millions dans les océans et 203
atomes d'hydrogène dans une bactérie. Parallèlement pour un atome de
phosphore il y a 1 400 atomes d'oxygène dans le cosmos pour 25 millions
dans les océans et 72 dans une bactérie. Le nombre d'atomes de carbone
et d'azote, respectivement, pour un simple atome de phosphore est de 680
et 230 dans le cosmos, 974 et 633 dans les océans et 116 et 15 dans une
bactérie.
Puisque le phosphore est beaucoup plus rare dans l'environnement que
dans la vie, la compréhension du comportement du phosphore sur la Terre
primitive donne des indices sur l'origine de la vie.
La forme terrestre du phosphore
est un minéral appelé apatite. Quand il est mélangé à l'eau,
l'apatite donne de petites quantités de phosphate. Les chercheurs ont
essayé de chauffer l'apatite à très haute température en le combinant
avec divers composés étranges et très énergétiques, expérimentant
même des composés vphosphoreux inconnus sur Terre. Cette recherche n'a
pas expliqué la provenance du phosphore.
Pasek a commencé à
travailler avec Dante Lauretta, professeur auxiliaire de l'université
d'Arizona aux sciences planétaires, sur l'idée que les météorites sont la source du phosphore de la
Terre. Le travail a été inspiré par de précédentes expériences
de Lauretta qui ont prouvé que le phosphore est concentré sur les
surfaces métalliques qui ont été corrodées dans le Système solaire
auparavant.
Les météorites possèdent
des minéraux qui contiennent des phosphores. L'un des plus importants est
le phosphide fer-nickel qui est extrêmement rare sur Terre. Mais il est omniprésent dans les météorites, particulièrement les
météorites de fer.
Au cours
des recherches, Pasek révèle qu'ils ont trouvé un groupe entier de différents composés de phosphore,
dont un des plus intéressants était le P2-O7 (deux atomes de phosphore avec sept atomes d'oxygène), une des formes de
phosphate la plus biochimiquement utile, semblable à celle trouvée dans le triphosphate d'adénosine.
Les expériences précédentes ont formé le P2-07, mais à température élevée ou dans d'autres conditions extrêmes,
mais pas en dissolvant simplement un minerai dans l'eau à température
ambiante. Ceci permet d'extrapoler
légèrement où les origines de la vie ont pu se créer.
En cherchant la vie basée sur le phosphate, elle aurait
probablement dû éclore près d'une région d'eau douce où une météorite
était récemment tombée. Il est possible que ce fut une météorite de
fer, car elles ont 10 à 100 fois plus de phosphide
fer-nickel que d'autres météorites.
Il est possible que les météorites furent
critiques dans l'évolution de la vie en raison de certains minéraux, particulièrement le
composé P2-07 présent dans le triphosphate d'adénosine, lors de photosynthèse, en formant de
nouvelles liaisons de phosphate avec des produits organiques (les composés
contenant du carbone) et dans une variété d'autres processus
biochimiques.
Il faut bien se rendre
compte que pour qu'une météorite percute la Terre, il faut une ceinture
d'astéroïdes, riches en météorites de fer, perturbée par une planète
de la taille de Jupiter qui les précipite vers les planètes rocheuses à
l'intérieur du système.
Pasek a
relaté ses travaux le 24 août 2004 consacré à la "recherche
aujourd'hui" au 228e meeting national à Philadelphie de la Société
Chimique Américaine. Cette étude est placée sous le patronage de la
Nasa en astrobiologie, exobiologie et biologie évolutionnaire.
Spaceflightnow.com
Cassini
et la dernière correction de trajectoire
24/8/04
Cassini
a fait fonctionné son moteur pendant 51 minutes afin d'approcher Saturne
à 300 000 km. Cette manoeuvre était nécessaire pour que la sonde passe
à nouveau à travers les anneaux et qu'ensuite elle passe à 1 200 km de
Titan le 26 octobre 2004. Elle était éloignée de 9 millions de km de
Saturne et sa vitesse juste avant l'allumage du moteur était de 325 m/s
par rapport à Saturne. Cela signifie que Cassini est presque à l'arrêt, comparé à sa vitesse,
d'environ 30 km/s, lors de son insertion en orbite le 30 juin. Mais
elle reste tout même en orbite autour du Soleil à la même vitesse que
Saturne, soit 9,67 km/s.
C'est la 3e et
dernière correction de trajectoire avec allumage du moteur pendant une
longue durée. Le 30 juin, la durée fut de 97 mn pour l'orbite
d'insertion et 88 mn en décembre 1998 pour atteindre Jupiter.
Mars et
Clovis
18/8/04
Finalement
le rover Spirit en examinant les roches dans les " collines Colombia" a
trouvé la preuve que l'eau a complètement changé quelques roches dans
le cratère Gusev.
Spirit et son jumeau
Opportunity ont rempli leur mission après 3 mois de succès sur Mars (avril
2004). Les succès continuent à arriver lors de cette mission étendue. Ils
sont encore en bon état malgré quelques signes de fatigue. Sur Opportunity
l'appareil servant à abraser la roche à cesser de fonctionner, mais les
ingénieurs pensent trouver une solution. Il semblerait qu'un caillou soit
resté coincé entre les dents. Sur Spirit une roue se bloque, empêchant
certaines manoeuvres et créant une surchauffe sur l'arbre moteur.
 D'une part,
Opportunity avait atterri près d'une roche exposée et a trouvé rapidement
la preuve d'un ancien corps ayant séjourné dans de l'eau salée. D'autre
part, après 6 mois de promenade à travers la plaine du cratère
Gusev, il a réussi à gravir une colline de 9 m de haut, où il a trouvé un
affleurement appelé"Clovis" (ci-contre) qui suggère que l'eau fut
présente dans Gusev. Clovis est la roche la plus modifiée rencontrée par
Spirit jusqu'à maintenant. C'est une partie d'un affleurement rocheux
localisé sur "West Spur" de "Columbia Hills" , à environ
3 km et à 55 mètres au-dessus du site d'atterrissage. La preuve aurait été faite que la composition de cette
roche fut modifiée par l'interaction avec l'eau a déclaré le Dr.
Steve Squyres de l'université Cornell, responsable des instruments des 2
rovers. Sur la plaine, des roches avec des couches et des veines apparentes
dues à l'effet d'un peu d'eau, furent découvertes. Avec "Clovis"
le changement est plus complet et plus profond, suggérant beaucoup plus
d'eau. La roche est plus molle que les roches basaltiques de la plaine après que le rover ait
creusé un trou facilement avec l'outil abrasif. Les preuves viennent de
l'analyse de la surface et de l'intérieur de "Clovis" par
l'analyseur de particules alpha du spectromètre à rayons X de Spirit et de
la découverte d'un niveau élevé de brome, de soufre et de chlore à
l'intérieur.
D'une part,
Opportunity avait atterri près d'une roche exposée et a trouvé rapidement
la preuve d'un ancien corps ayant séjourné dans de l'eau salée. D'autre
part, après 6 mois de promenade à travers la plaine du cratère
Gusev, il a réussi à gravir une colline de 9 m de haut, où il a trouvé un
affleurement appelé"Clovis" (ci-contre) qui suggère que l'eau fut
présente dans Gusev. Clovis est la roche la plus modifiée rencontrée par
Spirit jusqu'à maintenant. C'est une partie d'un affleurement rocheux
localisé sur "West Spur" de "Columbia Hills" , à environ
3 km et à 55 mètres au-dessus du site d'atterrissage. La preuve aurait été faite que la composition de cette
roche fut modifiée par l'interaction avec l'eau a déclaré le Dr.
Steve Squyres de l'université Cornell, responsable des instruments des 2
rovers. Sur la plaine, des roches avec des couches et des veines apparentes
dues à l'effet d'un peu d'eau, furent découvertes. Avec "Clovis"
le changement est plus complet et plus profond, suggérant beaucoup plus
d'eau. La roche est plus molle que les roches basaltiques de la plaine après que le rover ait
creusé un trou facilement avec l'outil abrasif. Les preuves viennent de
l'analyse de la surface et de l'intérieur de "Clovis" par
l'analyseur de particules alpha du spectromètre à rayons X de Spirit et de
la découverte d'un niveau élevé de brome, de soufre et de chlore à
l'intérieur.
Opportunity
a accompli une coupe transversale à travers les couches de roches exposées
sur la pente intérieure sud du cratère "Endurance". Les roches
examinées s'étalent des affleurements au bas du rebord à travers
des couches progressivement de plus en plus anciennes vers un affleurement
inférieur accessible appelé Axel Heiberg, d'après une île de
l'Arctique canadien. Selon
le Dr Ralf Gellert du Max Planck Institut de Chimie à Mayence en
Allemagne, Les concentrations de chlore ont triplés vers les couches
moyennes. Le magnésium et le soufre décline à peu près
parallèlement avec chacune des autres couches, suggérant que les deux
éléments peuvent avoir été dissous et retirés de l'eau.
Il ne faut pas oublier le succès d'une
collaboration active entre Européens et Américains. En effet, Spirit a
pu transmettre des données (42,6 Mégabits) grâce à Mars Express. Ces
tests ont démontré la possibilité de travailler ensemble pour la
transmission d'informations et d'images.
Les mêmes tests ont été effectués entre
les sondes Mars Odyssey et Mars Global Surveyor. Mars Odyssey a transmis
85 % des informations des 2 rovers, vers la Terre. http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06772.jpg
Gros plan
sur Athènes
18/8/04
Il y a beaucoup de sites anciens,
tel l'Acropole, préservés dans la ville moderne d'Athènes. A l'époque
de la Grèce Antique, Athènes était un grand port méditerranéen dont
la domination cessa lors de la guerre du Péloponnèse en 431 - 404 BC.
Suivi une longue occupation d'armées étrangères, Athènes devint la
capitale de la république hellénique en 1834. Les
jeux olympiques de 2004 marque le retour des jeux modernes, qui
furent accueillis pour la première fois à Athènes en 1896. Les
astronautes de l'ISS9 ont photographié,
en juin 2004, les constructions pour les jeux olympiques, tels que le complexe olympique de zone côtière de Faliro et le complexe
olympique de Helliniko. L'image montre les montagnes (Mts. Aigeleos et Hymettos) sur
qui s'étendent à l'ouest et à l'est de la région urbaine d'Athènes. Cependant, les régions
plus claires au nord de l'image indiquent que le terrain a été remanié
pour causes de nombreux travaux.

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/ISS009-E-11537_lrg.jpg
Cette
image fut acquise avec un appareil Kodak K60C équipé d'un objectif de
400 mm fourni par Earth Observations Laboratory, Johnson Space Center. Le
programme spatial supporte le laboratoire Kodak pour aider les astronautes
à prendre des images de la Terre de grande valeur scientifique et pour le
public et rendre ces photos en diffusion libre sur le web. D'autres images
sont accessibles à la NASA/JSC Gateway to Astronaut
Photography of Earth.
7 Octobre 2002
Cette image
en haute résolution prise à bord de l'ISS montre les ruines historiques
d'Athènes. Nous distinguons l'Acropole (plan)
dont certains détails sont visibles (Parthénon, Odeum d'Herodes Atticus).
Les astronautes ont utilisé un appareil photographique digital équipé
d'objectif de 400 mm et doubleur de focale. Ils apprennent à compenser le
défilement sur un repère malgré la vitesse de 8 km/s de l'ISS. Ainsi,
ils obtiennent des photos de plus grande résolution. Les images obtenues,
avec 6m ou moins de résolution, sont devenues rapidement les images les
plus populaires de la NASA, à charger par le public.

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/ISS005-E-16846.jpg
Saturne et
2 nouveaux satellites
16/8/04
Cassini a découvert 2 nouveaux satellites
de Saturne. Ce sont les plus petits découverts dans le monde saturnien.
Ils ont respectivement 3 km et 4 km de large. Ils se trouvent à 194 000
km et 211 000 km du centre de Saturne et entre 2 autres satellites Mimas
et Encelade. Leur noms provisoires est de S/2004S1 et S/2004S2. L'un d'eux
S/2004S1 peut être un objet repérer sur une image de Voyager, il y a 23
ans et qui fut appelé S/1981S14.
Chandra et Abell 2125
16/8/04
Une image du télescope X Chandra révèle un complexe de plusieurs nuages
galactiques de gaz chaud en train de fusionner. La résolution
exceptionnelle de Chandra rend possible la vision des différentes
galaxies dans des nuages massifs de gaz chaud. Un des nuages, qui enveloppe des centaines de galaxies, a une
concentration extraordinairement basse en atomes de fer, indiquant qu'il est
dans les premières phases de l'évolution de l'amas. Pour les
scientifiques cette aubaine leur permet d'étudier un chaud nuage
galactique avant qu'il ne soit pollué par les galaxies.
Ce complexe, connu sous le nom d'Abell 2125, est situé à 3 milliards al
de la Terre et est regardé 11 milliards d'années après le Big bang,
période à laquelle, selon les chercheurs, plusieurs amas de galaxies se
seraient formées.
L'image d'Abell 2125
montre plusieurs énormes nuages ovales de gaz à plusieurs millions de
degrés provenant ensemble de différentes directions. Ces nuages de gaz
chaud, chacun pouvant contenir des centaines de galaxies, apparaissent
être en train de fusionner pour former un simple amas de galaxies. Les
données recueillies par Chandra et le radio télescope VLA (Very Large
Array) prouvent que plusieurs galaxies, dans le
noyau de l'amas Abell 2125, sont dépouillées de leur gaz, tandis qu'elles tombent
dans le gaz chaud à haute pression environnant. Ce dépouillement
enrichit le gaz du coeur de l'amas en éléments lourds, tel que le fer.
Le gaz du nuage primitif, qui est immobile à plusieurs millions
d'années lumières du centre de l'amas, est remarquablement pauvre en
atomes de fer. Ce nuage anémique doit être
le début d'une étape évolutive. Les atomes de fer produits par des
supernovae incluses dans les galaxies, doivent être immobiles dedans ou
autour des galaxies, peut-être sur dans des grains de poussières pas
bien amalgamés avec le gaz émis, observé en rayonnement X.
Avec le temps, comme les amas fusionnent avec
d'autres amas et que la pression des gaz chauds s'accroît, les grains de
poussières sont dirigés vers les galaxies, mélangés aux gaz chauds et
détruits en libérant les atomes de fer.
La construction d'amas galactiques
entreprise pas à pas, prend des milliards d'années. Le temps exact
dépend de plusieurs facteurs, comme la densité des sous-amas et leur
proximité, le taux d'expansion de l'univers, la quantité de matière
sombre et d'énergie noire. La formation
d'amas implique également des interactions complexes entre les galaxies et le gaz chaud
pouvant déterminer finalement l'avenir des grandes galaxies dans l'amas.
Ces interactions déterminent comment les galaxies
contiennent leur gaz, carburant nécessaire à la formation d'étoile.
Les observations d'Abell 2125 fournissent un
rare aperçu dans les étapes précoces du processus.
Frazer Owen (National Radio Astronomy Observatory)
et Michael Ledlow
(Gemini Observatory) sont les co-auteurs de cet article à paraître dans
Astrophysical Journal. Chandra
a observé Abell 2125 avec le spectromètre à images CCD, le 24 août
2001 pendant environ 22 heures.
Cosmos 1, satellite à voile
15/8/04
Avec
la réception de ses systèmes électroniques, Cosmos 1, le premier
satellite à voile du monde, a achevé une étape critique vers un
lancement prévu depuis Mourmansk pour la fin de cette année (fin
novembre) ou le début de l'année prochaine. Le lancement sera
effectué à partir d'un missile balistique reconverti, Volna, tiré à
partir d'un sous-marin, dans la mer de Barentz.
Le but de
ce vol d'un type nouveau, est de contrôler une voile solaire dans
l'espace. La navigation solaire est la seule technologie connue qui
pourra, un jour, permettre le vol interstellaire.
Une voile
solaire n'est pas faite pour être gonflée par le vent, mais elle se
déplace sous la pression permanente des particules éjectées du Soleil,
à des vitesses de plusieurs millions de km/h, qui constituent le
vent solaire. Une fois mise en orbite terrestre, la voile sera déployée par
des tubes gonflables, qui étirent la voile et rendent la structure rigide.
Cosmos 1 est constitué de 8 pales configurées comme un moulent à vent
géant. Ces pales tournent comme celles d'un hélicoptère et reflètent
la lumière dans toutes les directions. Ceci permet à la voile de changer
de direction, suivre le Soleil et contrôler l'attitude de la sonde
spatiale. Chaque aile mesure 15 m de long et est fabriquée en feuille
mince d'aluminium (5 µm) renforcées de mylar (le 1/4 d'un sac
poubelle).
Si Cosmos 1
est un succès, il sera visible à l'oeil nu sur toute la planète et
constituera un espoir pour les voyages à grandes distances. Mais
n'oublions pas que l'énergie solaire varie comme l'inverse du carré de
la distance. Ainsi sur l'orbite de Pluton, l'énergie reçue est 900 plus
faible qu'au niveau de la Terre. Cosmos 1 est un projet de la Planetary
Society, sponsorisé par les studios Cosmos.
Amas
globulaires
15/8/04
Il y aurait
environ 200 amas globulaires en périphérie de la Voie Lactée. Mais les
chercheurs pensent qu'elle en contenait beaucoup plus autrefois. Selon la théorie
de la formation des galaxies, elles se sont agrandies en absorbant des
galaxies naines et des amas d'étoiles. Parfois, il semble que la proie malheureuse n'est pas entièrement
engloutie, mais dépouillée de ses couches externes pour laisser la place
à un noyau. Les nouvelles recherches de Paul Martini (Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics) et de Luis Ho (Observatories of the Carnegie
Institution of Washington) montrent que quelques amas globulaires peuvent
être les restes de galaxies naines qui furent dépouillées de leurs
étoiles extérieures laissant à la place le noyau galactique. Martini et
Ho dévoilent leurs résultats dans l'édition du 20 juillet 2004 de
"The Astrophysical Journal". Leurs résultats
suggèrent un lien important, bien qu'étonnant, entre les plus grands
amas globulaires et les plus petites galaxies naines. Pour Martini,
les amas d'étoiles et les galaxies sont
structurellement différents, les amas d'étoiles sont, par exemple, beaucoup plus
concentrés au centre et ainsi les mécanismes qui les forment, devraient être tout à fait différents.
L'identification des amas d'étoiles dans la même gamme de masse que les galaxies est une étape très importante
pour comprendre comment les deux types d'objets se formèrent.
Pour leurs
investigations, l'équipe a étudié 14 amas globulaires dans la grande
galaxie elliptique du Centaure A (NGC 5128) avec le grand télescope
Magellan du Carnegie's Las
Campanas Observatory au Chili,
de 6,5 m de diamètre. Et Martini de
continuer en déclarant que l'essence de leurs résultats réside dans le
fait que ces 14 amas globulaires sont 10 fois plus massifs que les plus
petits amas orbitant autour de notre Galaxie et quel que soit le processus
qui les a fabriqués, pouvant donner des objets vraiment énormes, cela
commence par les plus petites galaxies.
Martini précise également
que la découverte récente d'un trou noir, suspecté être de masse
intermédiaire dans l'amas globulaire connu sous le nom de G1, situé dans
la galaxie d'Andromède, offre davantage de preuves reliant les amas globulaires aux galaxies naines.
La présence d'un trou noir, classé de modéré, est plus compréhensible
s'il occupait par le passé le centre d'une galaxie naine (une galaxie qui a perdu ses étoiles externes
en raison de la gravitation d'Andromède), ne laissant seulement qu'une ombre de
lui-même.
Ho, un co-découvreur du trou noir
dans G1, ajoute qu' un des résultats étonnant est que le trou noir obéit
à la même corrélation entre la masse du trou noir et la masse de la
galaxie hôte qui a été bien établi pour les trous noirs super massifs
au centre des grandes galaxies. Ce résultat étonnant est plus compréhensible si G1 était par le
passé le noyau d'une plus grande galaxie. D'où la question de savoir si
dans Centaurus A certains amas contiennent également un trou noir.
Bien que la
plupart des amas de notre Galaxie soient beaucoup plus petits que ceux de
Centaurus A, les plus grands amas globulaires (tel l'amas d'étoiles
d'oméga Centauri) rivalisent avec ceux des galaxies elliptiques. Les
similitudes entre les amas globulaires massifs dans les deux galaxies
peuvent diriger vers des mécanismes de formations similaires. Les futures études de ces
amas les plus massifs exploreront les liens entre les processus de formation
d'amas d'étoiles et des galaxies.
Centaurus A
se situe à 12,5 millions d'al de nous. Elle mesure 65 000 al de large et
est beaucoup plus massive que la Voie Lactée et Andromède réunies.
Centaurus A possède environ 2 000 amas globulaires, plus que dans le
Groupe Local. De récentes observations du télescope Spitzer ont
découvert la preuve qu'elle a fusionné avec une galaxie spirale, il y a
environ 200 millions d'années.
Exoplanètes et AU Mic
15/08/04
Le Dr. Michael Liu, un astronome à l'institut d'astronomie de
l'université d'Hawaï a acquis des images de haute résolution d'une
étoile voisine, AU Mic (Microscope) en utilisant le grand télescope IR
du monde: Keck II. A une distance de 33 al, AU Mic est l'étoile la plus
proche possédant un disque de poussières dont les chercheurs le
soupçonnent abriter des planètes naissantes. Le
disque de AU Mic est à 25 à 40 UA de l'étoile centrale,
soit 3 à 7 milliards de km. Ce sont des distances correspondantes, dans
notre Système solaire, aux orbites de Neptune et Pluton.
AU Mic est
une pâle étoile rouge, avec seulement la moitié de la masse du Soleil
et ne rayonnant que le dixième de son énergie. Des études précédentes
montrèrent que AU Mic serait âgée de 12 millions d'années, une époque
que les chercheurs pensaient être propice à la formation d'étoiles. En
comparaison, notre Soleil est âgé de 4,6 milliards d'années, soit 400
fois plus vieux et la formation des planètes est terminée depuis
longtemps.
Les
résultats sont depuis le 12 août en ligne sur Science Express et
paraîtront dans l'édition de septembre de Science.
Navette
spatiale et les modifications
15/8/04
La NASA
annonce dans le Houston Chronicle que le premier des réservoirs de carburant modifiés
du Shuttle sera prêt en novembre à Michoud, Los Angelès. Une fois
que le réservoir sera déclaré bon pour le vol, il n'y aura aucun
morceau d'isolant supérieur à la taille d'un hamburger susceptible de
percuter la Navette. Les modifications ont été longuement étudiées
afin qu'aucun morceau ne vienne à nouveau provoquer les dégâts qui ont
entraîné la perte de Columbia le 1 février 2003.
La NASA transportera le premier des réservoirs modifiés en chaland
au centre spatial Kennedy en Floride où il sera accouplé à la navette
Discovery. Le premier décollage est prévu pour Mai 2005.
|