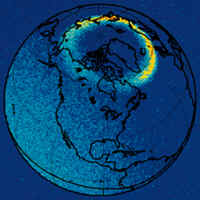|
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/spotlight/images/Nav_clouds_040804191821.jpg
En utilisant une de ses
caméras, Opportunity a capturé quelques nuages matinaux, des cirrus,
au-dessus du
cratère Endurance dans Meridiani Planum, peu avant Noël 2004.
Les nuages ont été un
événement banal aux cours des après-midi des semaines précédentes, à
l'arrivée de l'hiver martien. Sur Terre, les cirrus se créent dans une région
de turbulence verticale importante. Les particules dans les nuages, de la glace dans
le cas de Mars, tombent et sont transportées loin de l'endroit où elles se s ont condensées
à l'origine, en formant les cheveux d'anges caractéristiques. Mars possède trois
sortes de nuages:
-
nuages de poussière dans
la basse atmosphère;
-
les nuages de vapeur d'eau s'approchent de la surface
et s'élèvent jusqu'à 20 000 m;
-
nuages de gaz carbonique
à très hautes altitudes.
Tout comme sur Terre, les nuages, particulièrement
les nuages de glace d'eau, sont de bons traceurs du temps. Ils permettent
d'étudier les changements au jour le jour pour déduire des évolutions
saisonnières. Les conditions
climatiques sont telles qu'un jour il y a des nuages et le lendemain le ciel est
clair. Une partie de la vapeur d'eau de Mars se déplace du pôle du nord vers
le pôle du sud pendant la période actuelle avec l'été au nord et l'hiver au
sud. Selon des données orbitales,
il y a plus de nuages pendant l'hiver martien. L'augmentation
passagère de l'eau dans l'atmosphère sur Meridiani, juste au sud de l'équateur,
plus des basses températures près de la surface, contribuent à l'aspect des
nuages et du gel.
Lorsque ce changement se
produisit, les caméras du rover et le spectromètre thermique dépistèrent d'autres
changements qui se produisirent lorsque les nuages s'accumulèrent. Les
rovers fournissent une occasion unique d'examiner la partie inférieure de l'atmosphère de Mars.
La basse atmosphère est très difficile à modéliser en orbite, pourtant c'est
crucial car c'est la zone où elle interagit avec la surface. Les chercheurs ont
utilisé le spectromètre pour étudier le temps à partir du sol. Les nuages
apparaissent le plus souvent aux alentours de l'équateur, où se trouvent les
rovers Spirit et Opportunity, lorsque Mars se trouve à l'aphélie,
c'est-à-dire au point le plus éloigné du Soleil, sur son orbite elliptique. A
l'aphélie, la planète Mars ne reçoit plus que 60% d'énergie solaire, ce qui
apporte des changements climatiques importants. Les nuages sont poussés par un
vent dont la vitesse a été estimée à 10m/s.
Les changements saisonniers sur une échelle globale et
locale sont une caractéristique fascinante pour
les météorologistes martiens. Tandis que
les rovers ont, lors des missions primaires, recherché l'eau, les images en
orbite ont fourni une vision sur la façon dont Mars change lors du passage de
l'été à l'hiver, dans les hémisphères Nord et Sud. Il faut noter que parmi ces
changements, il reste l'aspect spectaculaire du gel martien.
Image credit: NASA/JPL
L'eau
a coulé
Mars, c'est la
découverte d'un monde, où le gigantisme est roi.
Nous y observons tout à la fois des indices
de bombardements météoriques ancien et des preuves d'une importante activité
tectonique, de phénomènes volcaniques, d'érosion par l'eau et le vent,
d'usure et de sédimentation à grande échelle.
A l'échelle globale, nous remarquons une dissymétrie marquée entre les
hémisphères nord et sud. L'hémisphère nord est occupé en majeure
partie par des plaines volcaniques très semblables aux "mers
lunaires". L'hémisphère sud offre un relief beaucoup plus
tourmenté, avec une prédominance de grands cratères, de dimensions
supérieures à une dizaine de kilomètres. Cette dissymétrie provient
vraisemblablement de ce que, dans l'hémisphère nord, les coulées de
laves se sont infiltrées à travers la croûte pour recouvrir les ont
fait disparaître les cratères qui s'étaient formés à une époque
antérieure.
|

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/downhill2.JPG
|
|
Voici
une coupe transversale le long du méridien 0° de la topographie
martienne réalisé par l'instrument MOLA pour Mars Orbiter Laser
Altimeter. La coupe part du pôle Sud, à gauche, pour aller au
pôle Nord, à droite. Le pôle Sud fait partie des zones
élevées en rouge et le pôle nord en vert. Les plus basses (Mare
Acidalum et Ismenium lacus) sont en bleu et se situent aux
latitudes moyennes boréales. Le pôle nord se trouve à 6 000 m au-dessus du pôle Nord.
Cette pente, en
moyenne 0,036°, a
probablement existé dès la naissance de Mars et fut à l'origine
de la direction des vallées et des cours d'eau. La région la
plus élevée (en orange) aux latitudes moyennes australes
correspond au bord occidental de
l'anneau qui encercle le bassin Argyre.
Le fonctionnement du MOLA est basé sur un sondage à l'aide
d'impulsions du laser infrarouge (1 064 nm) au taux de 10 par
seconde (10 Hz). Après avoir percuté le sol martien, la lumière
infrarouge est détectée par la caméra de Mars Global Surveyor
permettant de mesurer le temps aller-retour (lumière
émise/lumière reçue) servant à définir la distance à partir
de l'orbite de MGS. Cette dernière est parfaitement connue et de
ce fait l'altitude est déterminée avec précision.
(Image credit: MOLA Science Team).http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/mola.html
|
La plupart des terrains où apparaissent les innombrables cratères de
l'hémisphère sud sont des terrains anciens, qui s'élèvent de 3 000 à
4 000 m au-dessus du niveau moyen. Au contraire, les grandes plaines de
lave de l'hémisphère nord, se trouvent en général des milliers de
mètres au-dessous du niveau moyen. Cette situation n'est pas sans rapport
avec le fait que les flots de laves ont affecté l'hémisphère nord. Sans
doute qu'à l'origine la croûte, uniformément répartie, s'est
restructurée sous l'effet d'un mouvement convectif au sein du manteau
qu'elle recouvre.
L'état des cratères est très variable. ceux de l'hémisphère nord sont
en général bien conservés, ce qui montre que le relief martien n'a pas
subi d'érosion significative depuis la formation des plaines volcaniques.
Par contre l'érosion fut plus importante à une époque antérieure, la
rapidité de son évolution semblant avoir été maximale à une période
qui coïncida approximativement avec la fin des bombardements
météoritiques importants de la surface.
|

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/o1s.jpg
Ce
globe en fausse couleur a été réalisé à partir des données du
radar altimétrique MOLA. Le rouge indique les altitudes les plus
élevées, le vert les altitudes moyennes voisines de la référence
et bleu foncé représente l'altitude la plus basse du gigantesque
basin d'impact Hellas avec c'est 10 000 m de profondeur.
Au nord, le bleu dessine-t-il les contours d'une mer ?
|
Les grands bassins d'impact sont analogues à ceux de la Lune ou de
Mercure. Au sud, le plus grand est Hellas (ci-contre) avec ses 2 000 km de
diamètre pour une profondeur de 3 000 à 4 000 m. C'est une véritable
cuvette dans laquelle d'importants tourbillons de poussières, qui
masquent le fond, furent localisés. Presque à la même latitude
(45°) et à 45° de longitude Est, se trouve Argyre un bassin de 1 000 km
de diamètre avec une profondeur de 8 000 m. Il est très bien conservé
avec des remparts formant un anneau complet.
Les grands volcans (> 20 000 m) se concentrent dans la région
équatoriale, sur le plateau Tharsis, qui est en fait un dôme de plus de
5 000 km de diamètre et qui s'élève à plus 8 000 m au-dessus du niveau
moyen. Son centre est approximativement 115° de longitude Ouest. Le plus
grand volcan du Système solaire, Olympus Mons, se trouve en bordure NE.
Une autre région volcanique moins caractéristique, baptisée Elysium, se
trouve à 90°. Le faible taux d'impacts sur les flancs de ces volcans
indiquerait qu'ils sont récents, à l'échelle géologique.
Une immense fracture fut baptisée Valles Marineris, en souvenir de sa
découverte par la sonde Mariner 9. D'une longueur voisine de 5 000 km
avec, parfois, une largeur dépassant la centaine de kilomètres pour une
profondeur atteignant par endroits les 8 000 m, c'est un rift dans lequel
s'engouffre des vents soulevant des km3 de poussières.
Une autre grande surprise révélée par Mariner 9 consiste en des
vallées fluviales, sinueuses qui suivent le relief et qui possèdent des
ramifications faisant penser à des affluents avec des lits de fleuves
asséchés. Notamment des dépôts alluvionnaires, ainsi que des îlots,
dans le sens de la pente, furent découverts. L'une des plus remarquable
s'appelle Mare Erythraeum et s'allonge sur 400 km, avec par endroits une
largeur de 5 000 m. D'autres zones révèlent parfois des formations
nettement plus larges (60 km), laissant entrevoir un déferlement d'eaux
torrentielles.

Ces vallées laisseraient supposer que l'eau a coulé sur la planète
Mars. Mais cela implique que le climat était propice à l'eau liquide,
avec une pression atmosphérique plus importante. Un effet de serre a-t-il
eu lieu ? Or, l'eau ne peut exister sous la faible pression actuelle. Elle
passe de l'état solide (glace) à l'état gazeux, par la sublimation. Par
contre aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus de sa présence en
profondeur. D'ailleurs la mise en route en mai 2005 du radar Marsis, de la
sonde européenne Mars Express, devrait nous en apprendre plus. Ce radar
est capable de détecter l'eau à plusieurs dizaines de mètres de
profondeur. Elle serait stockée dans le pergélisol.
|

|

http://ceres.cals.ncsu.edu/cfdocs/course/bo277/111202_MarsGeologyBiology.pdf
L'eau fut abondante, si
l'on en croit les images des sondes spatiales ( Mariner 9 en 1971). Pour la première
fois, on découvre des paysages où l'eau semble avoir coulé en abondance.
Pendant 1,5 milliards
d'années, les chercheurs pensent que la Terre et Mars eurent un sort commun. Le débit de
certains cours d'eau aurait atteint des centaines de fois celui de l'amazone. Dans
l'hémisphère nord, un océan de 100 à 1000 m de profondeur aurait laissé des rivages
typiques. L'époque des pluies et ruissellement aurait commencé très tôt, il y a 3,8
milliards d'années. Puis un emballement se serait produit, faisant disparaître le
précieux liquide en 500 millions
d'années et le CO² est resté en faible quantité. On a calculé que Mars en aurait perdu 1 400 T/m², contre 130 T/m² de
CO² dans le même temps. Sur Terre, le gaz carbonique se dissout dans l'eau. Il
disparaît pour laisser la place à l'oxygène. Sur Mars, le CO² s'évade vers l'espace.
D'autre part ,
plus la pression atmosphérique diminue, plus la température d'ébullition de l'eau
s'abaisse. Il n'est donc pas étonnant que l'eau se soit rapidement dispersée dans
l'espace.
Mais tout n'est pas parti, on
pense que dans le pergélisol, l'eau serait encore présente à raison de 10T/m² et ce,
jusqu'à 2 000 m.
|
|
http://www.msss.com/mars_images/moc/
top102_Dec98_rel/nanedi/n_nanedi_8704_50perc.gif |
Photo ci-contre: Nanedi Valles dans Xanthe Terra. Largeur 2,5 km.
La scène couvre 10 X 28 km. |
Pour les
scientifiques américains, les 2 photos
ci-dessous, seraient une preuve de la présence de l'eau. Mais tout le monde
n'est pas d'accord.
scientifiques américains, les 2 photos
ci-dessous, seraient une preuve de la présence de l'eau. Mais tout le monde
n'est pas d'accord.
|












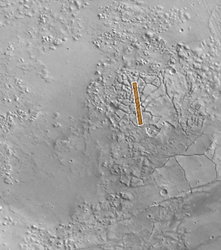



 D'après le bulletin du CNRS (avril 2004) nous apprenons qu'une équipe internationale d'astronomes, conduite par des
chercheurs de l'Observatoire de Paris, vient enfin de découvrir l'eau oxygénée
sur Mars, avec le télescope de 3m IRTF (InfraRed Telescope Facility) de la
NASA à Hawaii.
D'après le bulletin du CNRS (avril 2004) nous apprenons qu'une équipe internationale d'astronomes, conduite par des
chercheurs de l'Observatoire de Paris, vient enfin de découvrir l'eau oxygénée
sur Mars, avec le télescope de 3m IRTF (InfraRed Telescope Facility) de la
NASA à Hawaii.