|
Génésis
13/09/04
Les
scientifiques sont encouragés par ce qu'ils ont trouvé à l'ouverture des boîtiers. Ils pensent pouvoir réaliser la plupart des objectifs
scientifiques.
Rover martien
Zoé
12/09/04
 Tandis que les rovers Spirit et Opportunity de
la Nasa continuent à avancer lentement à travers le désert martien, sur
Terre, un groupe de scientifiques se préparent à envoyer Zoé, un prototype
du nouveau rover, faire une randonnée dans le désert chilien. Spirit
et Opportunity cherchent de l'eau et Zoé cherchera les signes de la
vie.
Tandis que les rovers Spirit et Opportunity de
la Nasa continuent à avancer lentement à travers le désert martien, sur
Terre, un groupe de scientifiques se préparent à envoyer Zoé, un prototype
du nouveau rover, faire une randonnée dans le désert chilien. Spirit
et Opportunity cherchent de l'eau et Zoé cherchera les signes de la
vie.
Le
désert chilien de l'Atacama est le plus sec du monde. Dans des zones
proches des côtes du Pacifique, une poignée de bactéries et de lichen
essaient difficilement de survivre dans une brume salée et humide, parfois
mise en mouvement par l'océan.
Mais aucune vie ne pas subsister dans l'intérieur, qui ne reçoit que
quelques millimètres de pluie par décennie.
Saturne, un nouvel anneau
9/9/04

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/small-moons/images/PIA06113.jpg
Sur cette image
un nouvel anneau, S/2004 1 R,
a été repéré sur l'orbite d'Atlas, un des satellites de Saturne,
entre les bords des anneaux A et F. Il serait situé à 138 000 km du
centre de Saturne et ferait 300 km de large.
De plus un examen
plus poussé laisse entrevoir un ou 2 satellites supplémentaires provoquant
des torsions de l'anneau F. Un objet a déjà était remarqué par le Dr Carl
Murray proche du bord extérieur de l'anneau F, à l'intérieur de l'orbite de
Pandora. Les scientifiques ne savent pas encore si c'est un petit satellite ou
un bloc provisoire en vadrouille. Son diamètre est estimé à 4 ou 5 km. Il
est situé à 1 000 km de l'anneau F, l'anneau le plus extérieur de Saturne.
Sa distance approximative par rapport au centre de Saturne est de 141 000 km
et à moins de 300 km de l'orbite de Pandora. Il a été provisoirement
appelé S/2004 S3 (ci-dessous). Son comportement orbital (traversée de l'anneau F 5 h plus
tard) pourrait suggérer la présence d'un ou plusieurs autres objets. Cet
objet a déjà était baptisé S/2004 S4 et serait de taille similaire à
2004S3.

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/small-moons/images/PIA06115.jpg
Cassini a photographié les
anneaux avec sa caméra munie de l'objectif grand angle, le 1 juillet 2004,
lors de la traversée des anneaux. La résolution maximale est de 7 km/pxl. La
région qui sépare l'anneau A du B s'étend sur plus de 3 500 km. Le
traitement de cette image permet de bien voir cet anneau très fin juste
au-delà du bord de l'anneau A et sur l'orbite d'Atlas (indiquée en rouge sur
l'image de droite). Prométhée (102 km de diamètre) est visible proche de
l'anneau F est bas et à gauche de l'image.
Mars et l'eau
8/9/04
 Les observations des 2 rovers qui ont atterri
sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura
recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des
chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du
laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars
Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant
le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau
superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande
que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.
Les observations des 2 rovers qui ont atterri
sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura
recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des
chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du
laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars
Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant
le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau
superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande
que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.
En mars, les instruments d'Opportunity ont
balayé la zone d'atterrissage de Meridiani Planum, confirmant que les roches
d'affleurement sont riches en hématite,
un minéral d'oxyde de fer, ainsi qu'en sulfates, tous les deux ne se
formant qu'en interaction avec de l'eau.
La sonde européenne avait déjà quelques semaines auparavant trouvée de
l'eau dans les régions polaires sud.  En utilisant Thémis pour étudier
les émissions thermiques et les images des sondes orbitant autour de Mars,
Hynek montra que ces affleurements rocheux s'étendent sur plusieurs km au
nord, à l'est et à l'ouest. Une
grande inertie thermique indique une prédominance de gros blocs rocheux, qui
se réchauffent plus lentement le jour et se refroidissent plus lentement la
nuit. De plus faible inertie thermique sont provoquées par des fines particules
qui se réchauffent et se refroidissent plus rapidement. Hynek
pense que les affleurements du site d'atterrissage sont le résultat de
dépôts marins, la quantité d'eau a dû être assez profonde et persister
assez longtemps pour obtenir une couche de sédiments de plus de 500 m
d'épaisseur . Pour que cela puisse se produire, il a fallu que le climat fut
différent et se soit prolongé pendant très longtemps.
En utilisant Thémis pour étudier
les émissions thermiques et les images des sondes orbitant autour de Mars,
Hynek montra que ces affleurements rocheux s'étendent sur plusieurs km au
nord, à l'est et à l'ouest. Une
grande inertie thermique indique une prédominance de gros blocs rocheux, qui
se réchauffent plus lentement le jour et se refroidissent plus lentement la
nuit. De plus faible inertie thermique sont provoquées par des fines particules
qui se réchauffent et se refroidissent plus rapidement. Hynek
pense que les affleurements du site d'atterrissage sont le résultat de
dépôts marins, la quantité d'eau a dû être assez profonde et persister
assez longtemps pour obtenir une couche de sédiments de plus de 500 m
d'épaisseur . Pour que cela puisse se produire, il a fallu que le climat fut
différent et se soit prolongé pendant très longtemps.
Spirit a atterri dans le cratère Gusev le 4 janvier 2004 et Opportunity, son
jumeau, sur Meridiani Planum, à l'opposé de Gusev, le 25 janvier 2004.
Les Antennes
8/0/04
Après le
satellite européen ISO, en 1996, qui découvrit que les étoiles se
formaient majoritairement en dehors des noyaux, le satellite a
redécouvert les résultats des européens il y a près de 10 ans.

Credit: NASA/JPL-Caltech/Z. Wang (Harvard-Smithsonian
CfA); Visible: M. Rushing/NOAO
http://ipac.jpl.nasa.gov/media_images/ssc2004-14a_small.jpg
Cette image en
fausse couleur du télescope spatial Spitzer révèle les populations cachées
d'étoiles naissantes cachées au coeur de la collision de 2 galaxies, connue
sous le nom des : Antennes. Ces 2 galaxies de leur vrai nom NGC 4038 et NGC 4039 sont localisées à 68 millions d'années-lumière de nous. Elles se sont
percutées au cours de ces 800 millions dernières années. La rencontre ne
représente pas la mort, mais la vie. Les dernières observations de Spitzer
nous offrent un instantané de la formation d'étoiles déclenchée en cours de cette collision, en particulier à
l'emplacement où les deux galaxies se rencontrent. Lorsqu'elle fusionnent,
elles produisent des flots d'étoiles massives et des nuages de poussières
très sombres. Les yeux de Spitzer, guidés par la chaleur, ont débusqués
des populations d'étoiles nouvellement créées.
L'image composite est
un mélange d'images IR de Spitzer et visibles, du télescope du Parc National
de Kitt Peak à Tucson, Arizona. Nous voyons les étoiles des 2 galaxies en la
lumière visible (vert et bleu) et en rouge, les images IR des nuages de
poussières interstellaires, chauffées par les étoiles naissantes.
Les 2 noyaux, ou
coeurs des galaxies fusionnantes, apparaissent comme des zones de couleur
blanc-jaune, l'une au-dessus de l'autre. Les nuages les plus brillants,
sièges de formation d'étoiles, se situent à gauche des noyaux, dans la
région du chevauchement.
L'image, en
haut et à droite, montre l'image de Spitzer. Cette photo a été prise par la
caméra infrarouge et est une combinaison de lumière infrarouge s'étendant de 3,6
microns (bleu) à 8,0 microns (rouge). L'émission de poussière (rouge) est la
caractéristique le plus importante de cette image. La lumière des étoiles a été systématiquement
soustraite des données de longueur d'onde les plus longues (rouges) pour
accroître le rôle de la poussière.
L'image en lumière
visible, en bas et à droite, montre les vraies couleurs, prise par Spitzer.
Ici, nous contemplons une vue très différente, avec des sites de formation
d'étoiles noyés dans des nuages de poussières, très sombres.
A travers le ciel,
les astronomes ont découvert plusieurs collisions de galaxie ou interactions
galactiques, montrant les disques spiraux étirés, vrillés par leur gravité
mutuelle au passage de l'une à proximité de l'autre. Les distances
impliquées sont immenses et les échanges s'effectuent à l'échelle des
changements géologiques terrestres. Les observations de tels événements,
combinés avec des modèles calculés par de puissants ordinateurs, prouvent
que souvent les galaxies fusionnent pour former une simple galaxie, plus
grande et de forme sphérique.
Sur les images de
Spitzer, le bleu représente la longueur d'onde de 3,6 µm, le vert celle de
4,5 µm et enfin le rouge celle de 5,8 à 8 µm. Sur l'image composite le bleu
représente la longueur d'onde de 440 nm, le vert celle de 700 nm et enfin le
rouge celle de 8 µm. Les images furent prises le 24 décembre 2003.
L'abondance
d'articles écrits sur Spitzer au cours de sa première année, dont nous
fêtons l'anniversaire aujourd'hui, montrent combien ce télescope était
attendu et qu'il répond à un besoin du monde scientifique. Il ouvre une
nouvelle fenêtre sur un univers qui nous était interdit jusqu'à maintenant:
le monde infrarouge. La naissance d'étoiles fut le sujet de nombreuses
théories. Grâce à Spitzer, elles seront confirmées ou infirmées. La
collision de galaxies jouent un rôle majeur dans l'histoire de l'univers.
Dans quelques millions d'années, notre Galaxie, la Voie Lactée, fusionnera
avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'observation des Antennes nous
montrent comment le sort de notre galaxie va évoluer à l'avenir.
Information sur Spitzer : http://www.spitzer.caltech.edu.
Genésis, la mission et
l'échec
8/09/04
 ECHEC au retour. Le parachute ne s'est
pas ouvert, selon l'agence Reuters. ECHEC au retour. Le parachute ne s'est
pas ouvert, selon l'agence Reuters.
La sonde Génésis (210 kg) s'est écrasée
dans le désert de l'Utah. Le déploiement du parachute ne s'est pas
effectué. On ne sait pas encore dans quel état se trouve la capsule.
Les équipes de recherches sont sur place.
Les scientifiques devraient
attendre 10 ans pour finalement étudier des particules solaires si le
feu vert, pour fabriquer une nouvelle sonde, était donné aujourd'hui.
Mais l'espoir subsiste pour la récupération les précieuses particules (400 µg de
protons, électrons et atomes solaires, ce qui représentent des milliards
d'atomes).
http://www.nasa.gov/images/content/64708main5_genesis_ground_300.jpg
Cette expérience
qui avait comme toutes les missions sa part de risques, ne sera pas perdue,
selon les spécialistes. En effet, le site d'atterrissage avait été
choisi pour sa friabilité. La sonde en s'enfonçant de la moitié de
son diamètre, a pénétré dans ce sol à la vitesse de 311 km/h (~100
m/s), ce qui représente une décélération d'un peu plus de 75 g (75 fois la
gravité terrestre). Il s'avère qu'elle était prévue pour résister
à 75 g. Après analyses, il semblerait que les particules solaires,
enfermées dans une gélatine, ne seraient pas polluées par
l'environnement terrestre. Tout espoir est permis, ce n'est pas un
échec scientifique, si c'est un échec aéronautique. Il faut se
souvenir que la technique utilisée est vieille de presque 50 ans (voir
ci-dessous). Donc l'origine du problème est peut-être à chercher dans
un excès de confiance. Pourquoi aucun des 2 parachutes ne s'est ouvert
?
http://science.nasa.gov/headlines/y2004/images/genesisreentry/fireball_med2.jpg

 Des
centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui
pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le
retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9
est attendue au-dessus du Nevada.
Des
centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui
pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le
retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9
est attendue au-dessus du Nevada.
Une
vingtaine de scientifiques auront pris place dans un NKC 135 de l'US Air FORCE
équipé pour l'occasion d'une batterie de télescopes et de spectromètres
pointés sur la vingtaine de hublots disponibles. Dans les années passées,
cet avion a servi pour l'observation des Léonides. Cette fois, les chercheurs
espèrent visualiser l'onde de choc à l'avant de la capsule. En effet, le
frottement des couches denses de l'atmosphère, à 40 000 km/h (11 km/s)
provoque la naissance d'un plasma. Ce phénomène est mal connu.
Les astrobiologistes sont aussi intéressés car les météorites d'une taille
de 1 m (identique à Génésis) percutent plusieurs fois par an, la haute
atmosphère de la Terre, apportant sur Terre de la matière organique. Ces
molécules survivent-elles à cette entrée ? Peuvent-elles réagir avec notre
atmosphère ? Ont-elles pu réagir avec les gaz atmosphériques
dans le chaudron de leur propre onde choc, pour créer de nouveaux matériaux d'importance
biologique ? Autant de questions, dont les scientifiques
voudraient que Génésis apporte une réponse. Une équipe française
participe au projet. Il s'agit de celle de Bernard Marty du centre de
recherches pétrographiques et géochimiques du CNRS de Nancy. Elle est l'une
des meilleures équipes du monde pour effectuer des analyses nécessitant une
très grande sensibilité dans des conditions d'extrême
propreté.
La rentrée
de Génésis peut être le prélude d'un événement d'importance capitale.
La sonde reviendra suspendue à un parafoil pour que la descente soit
suffisamment lente afin de permettre aux pilotes de l'hélicoptère de
l'attraper. Un retour sur Terre serait catastrophique, l'impact l'endommagerait
et contaminerait les précieuses poussières.
La capsule déploiera son parachute
vers 32 000 m au-dessus des vastes plaines de la zone d'essai de l' US Air
Force dans l'Utah. En attente, 30 000 m plus bas, 2 hélicoptères et leurs
équipages. Il s'écoulera 18 mn pour que la capsule atteigne la zone
d'attente. Pour les pilotes ce sera la fin d'une campagne d'essai qui aura
débuté en 1999.
La récupération
en plein vol d'une capsule provenant de l'espace n'est pas une nouveauté.
Dans les années 60, des avions de l'US Air Force ont récupéré plus
de 300 capsules contenant les films des premiers satellites
espions. A la fin des années 50, les Américains avaient essayé de mettre au
point un système de transmissions à large bande pour conserver la haute
définition permettant de voir les détails imperceptibles, nécessaires aux
militaires. C'est surtout après l'affaire de l'U2 de Powels que le besoin se
fit sentir. Avec cette histoire, les russes avaient prouvé aux américains
qu'ils ne pouvaient plus survoler leur territoire en toute impunité comme
auparavant. Mais les technologies électroniques, qui commençaient à
utiliser les transistors et quelques circuits intégrés simples, ne pouvaient
pas permettre de rapatrier vers la Terre des images prises en orbite basse. Pour
palier à ce manque, ils utilisèrent le système Corona. Après avoir filmé
le paysage d'une manière traditionnelle, le film était ensuite mis dans une
capsule, puis expédié sur Terre. Le retour s'effectuait en parachute. Un
avion était chargé de la récupération.

http://genesismission.jpl.nasa.gov/images/lagrange_full.jpg
Tandis que
Génésis est en orbite autour du point L1 (à 1,5 millions de km
de la Terre), un des 5 points Lagrange entre la terre et le soleil où la pesanteur des
deux corps est équilibrée, elle rassemble des particules du vent solaire
sur des plaquettes particulièrement conçues de grande pureté. Après
3 ans, les collecteurs témoins retourneront sur Terre à 11 km/s, le 8 septembre
2004 à 17h52mn46 heure française.

http://genesismission.jpl.nasa.gov/mission/images/lagrangemap.gif
 A 1 mois du retour historique de Génésis, rapportant des échantillons
en provenance de l'espace, la 20e correction de trajectoire a parfaitement
réussi. Ce sera la première récupération en vol depuis les missions
Apollo. Le 9 août 2004, à 12 h TU, Génésis a mis en route son
moteur de 90 grammes de poussée pendant 50 minutes, afin de modifier sa
vitesse de 1,4 m/s. La manoeuvre a requis 500 g de monopropellan
d'hydrazine.
A 1 mois du retour historique de Génésis, rapportant des échantillons
en provenance de l'espace, la 20e correction de trajectoire a parfaitement
réussi. Ce sera la première récupération en vol depuis les missions
Apollo. Le 9 août 2004, à 12 h TU, Génésis a mis en route son
moteur de 90 grammes de poussée pendant 50 minutes, afin de modifier sa
vitesse de 1,4 m/s. La manoeuvre a requis 500 g de monopropellan
d'hydrazine.
Génésis a été lancée en août
2001 pour capturer des échantillons provenant à 99 % du Système solaire,
donc du Soleil. Les échantillons de particules composant le vent
solaire, collectés sur des plaquettes ultra-pures d'or, de saphir, de silicium et
de diamant, seront retournés pour être analysés par des scientifiques.
Ils en attendent des informations capitales sur la composition du Soleil
et pour être sur les origines du Système solaire.
Les équipages
d'hélicoptères et les ingénieurs de la mission préparent activement le
retour programmé pour le 8 septembre 2004. A cette date, Génésis (250
kg et 1,5 m) larguera la capsule contenant les échantillons (400 µg de
protons, électrons et atomes solaires, ce qui représentent des milliards
d'atomes). Elle rentrera dans
l'atmosphère terrestre et sera freinée par un parachute (déploiement du
parachute à 30 000 m et un autre à quelques milliers de mètres du sol).
Un
hélicoptère récupérera l'ensemble en plein vol à l'aide d'un grappin
au bout d'un filin de 120 m. Ce système de
récupération évite d'autres solutions plus onéreuses. Les pilotes de 2
hélicoptères chargés de la récupération dans le désert de l'Utah, sont des anciens militaires
et spécialistes d'acrobaties à Hollywood .
Les échantillons seront stockés et catalogués dans
des salles blanches ayant moins de 10 particules par cm3 et seront mis à la disponibilité de la communauté scientifique.
Génésis a collecté
des poussières des couches supérieures du Soleil, qui auraient la
composition de la nébuleuse primitive, pendant suffisamment longtemps et le samedi 7 août, une
des dernières collectes s'est effectuée juste au-delà de l'orbite lunaire. Le 6
septembre 2004, Génésis sera à nouveau proche de l'orbite lunaire pour
cette fois revenir vers la Terre et ramener ses échantillons. Le dernier
retour d'échantillons fut lors d'Apollo 17 en décembre 1972.
Un survol de la Terre s'est produit le samedi 1er mai à environ
10:00 heure française, à une altitude de 386 000 kilomètres, juste au delà de l'orbite
lunaire. A ce moment-là, le vaisseau spatial voyageait à une vitesse
relative, par rapport à la Terre, de 1,26 kilomètres par seconde.
http://www.jpl.nasa.gov/genesis/mission/return_image.html
http://genesismission.jpl.nasa.gov/educate/kitchen/resource/factsheets/missionoverview.pdf
Objets
de Kuiper (KBO), 2004DW, Sedna et Quaoar
5/9/04
Pourquoi a-t-on beaucoup parlé de Sedna, pas de DW 2004 et peu de
Quaoar? Pourtant l'intérêt est le même pour ces 3 mondes nouvellement
découverts. Les 2 premiers furent découverts aux mêmes dates et tous
les 3 se situent dans la ceinture de Kuiper, appelée aussi ceinture de
Edgeworth-Kuiper et aussi ceinture transneptunienne.
La
ceinture de Kuiper est la région habitée par des petits mondes de
roches et de glace appelés "Objets de la Ceinture de Kuiper
ou Kuiper Belt Objects (KBO)
en anglais, qui s'étend au-delà de Neptune à plus de 7
milliards de km, dont Pluton
en serait la limite inférieure et peut-être un membre. Autrefois les
astronomes pensaient y découvrir la 10e planète. L'idée de cette 10e
planète viendrait du fait que la loi de Titius-Bode
appliquée pour découvrir Pluton, semblait indiquer une planète
au-delà. C'est l'astronome Kuiper qui émit le premier l'idée
que la 10e planète pourrait être plutôt des multiples objets formant
une ceinture. Elle serait
similaire à la ceinture des astéroïdes, une région de débris
rocheux entre Mars et Jupiter. Cependant, elle contiendrait 100
fois plus de matériaux que tous les astéroïdes réunis. Cet endroit
contient des milliards d'objets allant de quelques kilomètres jusqu'à
plus de 1 000 km de diamètre. Depuis 1992, plus de 1 000 objets furent
répertoriés, dont 5 de plus de 1 000 km de diamètre.
Les
astronomes ayant étudié sa structure, un mystère a été dévoilé.
Comme la plupart des planètes du Système solaire, la ceinture de
Kuiper a été formée à partir de petits objets que se sont accrétés
lors de collisions. Pour que ce processus se soit produit
dans les régions éloignées, au delà de Neptune, la ceinture de
Kuiper devrait contenir plus de 10 fois la quantité de matière contenu
par la Terre. Cependant, les observations de cette région prouvent qu'elle contient actuellement
environ un dixième de la masse de la Terre, ou moins.
Une question
que beaucoup de personnes se posent: pourquoi de telles découvertes de
planétoïdes aujourd'hui ? La réponse est simple: grâce aux progrès
technologiques. Autrefois, le télescope était limité par ses
performances optiques et photographiques. Clyde Tombaugh a découvert
Pluton en regardant des plaques photographiques et il pensa que la 10e
planète serait sa prochaine découverte, en vain. Aujourd'hui les
caméras CCD possèdent une sensibilité beaucoup plus grandes et elles
sont accompagnées du traitement informatique qui utilise les puissants
et les plus récents ordinateurs pour l'analyse des clichés obtenus par
des télescopes plus performants que ceux des années d'avant guerre.
Ces améliorations ont permis de détecter des objets plus petits, plus
sombres et plus lointain, qu'il y a 5 ans. Les capteurs CCD utilisés
actuellement possèdent 172 millions de pixels et ils sont montés sur
des télescope robotisés qui sont capables de détecter le moindre
objet nouveau, par rapport à une carte pré-établie.
Contrairement aux mesures directes effectuées par les télescopes, la
plupart des diamètres furent évalués en mesurant la température des
objets et en déduisant une taille à partir de leur albédo, la réflectivité
lumineuse des KBO. De telles estimations sont moins fiables que les
mesures directes des télescope et surtout d'Hubble en attendant James
Webb dans 10 ans.
2004 DW
Découvert le 17 février
2004, lors d'une surveillance automatisé à l'institut de technologie
de Californie à Pasadena (Caltech)
avec la caméra
Palomar QUEST et le Télescope
Samuel Oschin de 1,2 m sur le Mont
Palomar en Californie du sud, les observations préliminaires suggérèrent
que DW 2004 ait un diamètre supérieur à 1 800 km, le faisant ,à
cette période, l'objet de Kuiper le plus gros jamais découvert. C'est
l'équipe, composée des astronomes Mike
Brown (Caltech), Chad
Trujillo (Gemini
Observatory) et David Rabinowitz (université
de Yale), qui découvrit Quaoar en
2002, qui est à l'origine de cette nouvelle découverte.
 Avec une taille estimée entre
840 km et 1 800 km (peut-être > 1 600 km), il peut être plus grand que Quaoar dont elle est
évaluée de 1 000 km et 1 400 km de diamètre (peut-être 1 250 km).
S'il est à l'extrémité supérieure de la zone d'incertitude, alors 2004 DW
serait le plus grand de n'importe quel autre objet avéré autour du Soleil
au-delà de Pluton (2 300 km de diamètre), qui fut découvert en 1930.
Il pourrait être plus grand que Charon (1 300 km de diamètre), le
satellite de Pluton. Son orbite est supérieure en moyenne de 2, 4
milliards de km à celle de Pluton. Il serait de couleur très sombre et
très froid (<< - 200°). Pour mémoire la Lune mesure 3 476 km de
diamètre.
Avec une taille estimée entre
840 km et 1 800 km (peut-être > 1 600 km), il peut être plus grand que Quaoar dont elle est
évaluée de 1 000 km et 1 400 km de diamètre (peut-être 1 250 km).
S'il est à l'extrémité supérieure de la zone d'incertitude, alors 2004 DW
serait le plus grand de n'importe quel autre objet avéré autour du Soleil
au-delà de Pluton (2 300 km de diamètre), qui fut découvert en 1930.
Il pourrait être plus grand que Charon (1 300 km de diamètre), le
satellite de Pluton. Son orbite est supérieure en moyenne de 2, 4
milliards de km à celle de Pluton. Il serait de couleur très sombre et
très froid (<< - 200°). Pour mémoire la Lune mesure 3 476 km de
diamètre.
DW 2004
n'est pas une planète, bien qu'elle soit probablement légèrement plus grande que la moitié de la taille de
Pluton, il y a d'autres objets d'une taille semblable qui selon la définition courante,
ne sont pas qualifiés de planète (Cérès avec 986 km de
diamètre, Quaoar 1250
km de diamètre, Varuna 900 km de diamètre et 2002 AW197 aussi 900 km
de diamètre. Ces< 3 derniers sont aussi 3 objets de Kuiper.
Les objets, dont l'orbite est voisine de Pluton, seraient appelés des
"Plutinos" et sont aussi une variété de planétoïdes.
En
regardant en arrière dans leurs archives, les astronomes avaient déjà
photographié le nouvel objet sur des images prises dans 2002. Ces
images antérieures serviront à préciser les paramètres orbitaux. Sur
l'image ci-dessus, en rouge l'orbite de DW 2004. L'orbite en noir, la
plus excentrée est celle de Pluton. Il se trouve à 45 UA soit 7
milliards de km de nous (6 heures- lumière), contre 30 UA pour Pluton
soit 4,5 milliards de km.
Sa
magnitude estimée à 18,5, est similaire à celle Quaoar.
Puisqu'il est loin, les chercheurs en déduisent qu'il est plus grand
que ce dernier.
Les
chercheurs supposent que la plupart des objets de la Ceinture de Kuiper
sont faits à parts égales de roche et glace. Il y a de nombreux produits chimiques qui sont normalement
liquides ou gazeux sur Terre et qui seraient différents types de glace sur 2004
DW, y compris
l'eau, la glace de méthane (glace de gaz naturel), la glace de méthanol (glace d'alcool), la glace d'anhydride carbonique
(neige carbonique), la glace d'oxyde de carbone, etc...
Quaoar: http://www.gps.caltech.edu/~chad/quaoar
Ceinture de Kuiper: http://www.ifa.hawaii.edu/~jewitt/kb.html
Sedna
 L'existence du planétoïde Sedna (déesse des océans en Inuit) a été annoncé le
15 mars 2004, soit un mois après 2004 DW, par Mike
Brown (Caltech) qui faisait partie de l'équipe de 2004 DW. Il fut
tellement persuadé d'avoir affaire à un satellite, qu'une vue
d'artiste fut lâchée aux médias qui s'en emparèrent très heureux
d'écrire, comme toujours, des lignes sur une nouvelle Lune.
L'existence du planétoïde Sedna (déesse des océans en Inuit) a été annoncé le
15 mars 2004, soit un mois après 2004 DW, par Mike
Brown (Caltech) qui faisait partie de l'équipe de 2004 DW. Il fut
tellement persuadé d'avoir affaire à un satellite, qu'une vue
d'artiste fut lâchée aux médias qui s'en emparèrent très heureux
d'écrire, comme toujours, des lignes sur une nouvelle Lune. 
Ci-contre, tel que Sedna apparaît au
télescope de 48 cm de l'Observatoire de Palomar. Le faible objet attira
l'attention des astronomes grâce à son faible mouvement.
Brown a crû en un satellite à cause de la rotation lente de
Sedna qui semble tourner sur son axe en 40 jours. En comparaison, le
plupart des corps solitaires du Système solaire comme les comètes ou
astéroïdes tournent sur eux-mêmes en quelques heures. Brown et ses
collègues pensent qu'un compagnon obscur est à l'origine de cette
rotation. Pour l'instant rien de tel n'a été découvert. Même avec
les yeux perçants de Hubble, il est impossible de résoudre le disque.
C'est équivalent à essayer de distinguer un ballon de hand ball à 1
500 km. Son diamètre est estimé aux 3/4 de celui de Pluton, soit ~1
600 km. Si cette lenteur se confirme, Sedna serait le 3e corps en
rotation lente après Mercure et Vénus qui soit liées
gravitationnellement au Soleil. Pluton doit sa lente rotation de 6 jours
en raison de son lien gravitationnel avec Charon. le futur télescope
spatial James Webb résoudra peut-être cette énigme.  Ce planétoïde mystérieux est 3 fois plus éloigné de nous que
Pluton. Le Soleil y apparaît comme un petit point distant de 13
milliards de km au plus près, entouré des planètes du Système
solaire. Son orbite très elliptique l'éloigne à 130 milliards de km
(900 fois la distance Terre Soleil). La température ne doit jamais
s'élever au-dessus de - 240°C. Il orbite autour du Soleil en 10 500
ans. Sedna s'approchera au plus près de la Terre dans 72 ans. La
dernière fois où il s'est approché du Soleil, c'était pendant l'ère
glaciaire. La prochaine fois qu'il reviendra, le monde pourrait encore être complètement différent.
Ce planétoïde mystérieux est 3 fois plus éloigné de nous que
Pluton. Le Soleil y apparaît comme un petit point distant de 13
milliards de km au plus près, entouré des planètes du Système
solaire. Son orbite très elliptique l'éloigne à 130 milliards de km
(900 fois la distance Terre Soleil). La température ne doit jamais
s'élever au-dessus de - 240°C. Il orbite autour du Soleil en 10 500
ans. Sedna s'approchera au plus près de la Terre dans 72 ans. La
dernière fois où il s'est approché du Soleil, c'était pendant l'ère
glaciaire. La prochaine fois qu'il reviendra, le monde pourrait encore être complètement différent.
Grâce au télescope
infrarouge Spitzer, son diamètre a été estimée à moins de 1 700 km,
plus petit que Pluton et voisine de 2004 DW. En combinant des données
sures, Brown a évalué la taille entre Pluton et Quaoar.
http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2004/14/images/f/formats/web_print.jpg http://science.nasa.gov/headlines/y2004/images/sedna/discovery.gif
Quaoar
La
première découverte de Quaoar remonte au 4 juin 2002 par le Télescope
Samuel Oschin de 1,2 m sur le Mont
Palomar en Californie du sud. Les
amérindiens de Tongva
ont habité la région de Los Angeles avant l'arrivée des Blancs. Quaoar
vient de la mythologie de leur création.
Mike
Brown (Caltech), Chad
Trujillo (Gemini
Observatory) ont fait état
de cette découverte le 7 octobre 2002 lors du 34eme congrès annuel du département
des sciences planétaires de la Société Astronomique Américaine, qui se
tenait à Birmingham, Alabama. Baptisé 2002 LM 60,
avant d'être nommé
Quaoar pour le commun des mortels, Hubble a mesuré ce monde de glace
qui est à environ 42 AU (6 milliards de km ou 5 heures lumière) et à plus d'un milliard de km de
Pluton. Comme Pluton, Quaoar navigue dans la Ceinture de Kuiper. D'un
diamètre de 1 300 km, soit 40 millisecondes d’arc, Quaoar est la moitié de Pluton.
Sa magnitude est de 18,6. Il
est sur une orbite presque circulaire, dont l'excentricité est
inférieure à 0,04, ce qui signifie que la distance Quaoar-Soleil varie
de 8% sur la totalité de son orbite qui dure 285 années terrestres. Son
inclinaison sur l'écliptique est de 8 degrés, alors que celle de Pluton
est de 20°.
Quaoar
serait constitué, comme la plupart des objets de Kuiper (KBO), d'un
mélange de roches et de glaces diverses (neige carbonique, glace de
méthane, glace de méthanol, etc...). Selon les mesures du télescope
Keck de la glace d'eau serait présente.
Possibilités d'autres découvertes
Les précédents détenteurs du
record étaient le KBO Varuna et un objet appelé 2002 AW197, chacun
mesurant près de 900 kilomètres. Il est très probable qu'il y ait d'autres
planétoïdes plus grands dans la Ceinture de Kuiper. Seulement 15% du
ciel furent observés avant de trouver 2004 DW. Quaoar a aussi été
découvert car il était très gros. Il devrait y avoir 5 fois plus de
planétoïdes de la taille de Pluton ou Charon.
Appellation
L'appellation
est décidée par le Centre des Petites Planètes (MPC) et l'Union
Astronomique Internationale (IAU). Les noms comme Sedna et Quaoar ne
sont pas encore officialisés. Le numéro correspond à l'année de la
découverte (2002 = année 2002). La première lettre est celle de la
quinzaine de l'année de la découverte(A = 1 au 15 janvier). La lettre
suivante est assignée séquentiellement. Ainsi 2004 DW est le 23e
objet découvert lors de la 4e quinzaine de 2004.
Lorsque
les paramètres orbitaux sont mieux connus, un nombre inférieur à 100
000 est attribué. Cérès (astéroïde) qui fut le premier découvert
porte le numéro 1 et Quaoar le numéro 50 000. Après cette
numérotation, le découvreur peut proposer un nom à l'IAU. Il y a bien plus de règles au sujet du nom de l'objet. 2004
DW, par exemple, devra être baptisé du nom d'un dieu des enfers parce
qu'il est sur une orbite proche de Pluton.
caltech
http://today.caltech.edu/
Hubble:
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/14/image/a
Supernova
SN 2004dj
4/09/04
Des astronomes de
l'université de Californie à Berkeley ont braqué le télescope spatiale
Hubble vers la plus brillante et la plus proche supernova de la décennie.
L'explosion a fourni une lumière équivalente à 200 millions de Soleil.
La supernova, appelée SN 2004dj, est si lumineuse
sur l'image de Hubble qu'elle pourrait être facilement confondue avec
une étoile de premier plan dans notre Voie Lactée. Pourtant elle se trouve
à 11 millions d'années-lumière de la Terre en périphérie de la galaxie
NGC 2403, nichée dans un amas d'étoiles massives bleues âgées
seulement de 14 millions d'années? Pour le professeur d'astronomie Alex
Filippenko c'est
une étoile massive jeune d'une masse estimée à 15 masses solaires qui a
explosée. Les étoiles massives vivent beaucoup moins de temps que
notre Soleil. Elles ont plus de carburant à brûler par fusion nucléaire, mais
elles le consomment à une vitesse disproportionnée. Notre Soleil, qui
est une petite étoile, à 10 milliards d'années pour tout consommer. Il
n'est qu'à la moitié de sa vie.
Des observations additionnelles ont déjà montré que nous avons
affaire à une supernova
de type II, résultant de la mort d'une jeune étoile massive riche en
hydrogène. Est-ce une nouvelle SN 1987A ?
Une équipe
d'astronomes conduite par Jesus Maiz du STScI (Space
Telescope Science Institute) a découvert que la supernova faisait partie
d'un amas compact connu sous le nom de Sandage
96, lequel a une masse d'environ 24 000 soleil. L'image de cette région
montre plusieurs amas (les zones bleues) aussi bien que des associations
moins concentrées d'étoiles massives. Le nombre élevé d'étoiles
massives dans NGC 2403 indique un taux élevé de supernovae. Deux autres
supernovae ont observées dans cette galaxie, il y a 50 ans.
Le cataclysme s'est probablement produit quand le noyau central de
l'étoile, se composant de fer, s'est soudainement effondré pour former un objet extrêmement dense appelé une étoile
à neutron. Les couches de gaz environnantes ont rebondi sur le
coeur métallique hyper dense acquérant de l'énergie de la pléthore de
neutrinos (minuscules particules qui n'interagissent pas avec la
matière) qui a pu avoir été libéré, expulsant de ce fait violemment
les couches dans l'espace.
 Cette explosion a éjecté dans
l'espace, des éléments chimiques lourds, produits par les réactions nucléaires à l'intérieur de l'étoile. Comme d'autres
supernovae de type II, l'explosion de l'étoile a fourni la matière première
pour de futures générations d'étoiles et de planètes. Les éléments sur
Terre tels que l'oxygène, le calcium, le fer et l'or sont venus, il y a bien longtemps,
de supernovae telle que celle-là.
Cette explosion a éjecté dans
l'espace, des éléments chimiques lourds, produits par les réactions nucléaires à l'intérieur de l'étoile. Comme d'autres
supernovae de type II, l'explosion de l'étoile a fourni la matière première
pour de futures générations d'étoiles et de planètes. Les éléments sur
Terre tels que l'oxygène, le calcium, le fer et l'or sont venus, il y a bien longtemps,
de supernovae telle que celle-là.
Les astronomes continueront à étudier
SN 2004dj au cours des années à venir, avant qu'elle ne disparaisse
lentement de notre regard, afin de mieux comprendre la façon dont certains types
d'étoiles explosent et quels genres d'éléments chimiques sont expulsés dans
l'espace.
L' image composite
(droite) de NGC 2403 et SN 2004dj a été
obtenue par combinaison d'images à travers divers filtres à l'aide de la
caméra de surveillance à champ large de Hubble. Les couleurs ont une
très haute importance en astronomie. Très chaude, les jeunes étoiles
sont bleues. Des étoiles plus anciennes et les zones de poussières très
denses près du centre de la galaxie sont rouges. Les régions de
formations d'étoiles, riches en hydrogène sont roses. La région
centrale d'une galaxie, le bulbe, de fortes concentrations d'étoiles
vieilles est jaune
L'image de gauche représente une petite région de NGC 2403, 2 mois avant
que la supernova se produise. L'image localise l'amas Sandage 96 vu le 8
mai 2004 par le télescope de l'observatoire national de Kitt Peak en
Arizona et la WIYN 0.9 meter mosaic camera. Celle de droite est une
image de la même région vue par le télescope spatial Hubble, prise le
17 août 2004. La lumière de l'explosion surpasse celle de toutes les
étoiles de l'amas.
Credit for ground-based image: WIYN/NOAO/AURA/NSF, T. Rector (University
of Alaska, Anchorage), Z. Levay and L. Frattare (STScI) Credit for Hubble
image: NASA, ESA, A.V. Filippenko (University of California, Berkeley), P.
Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), et al.
http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2004/23/images/b/formats/web_print.jpg
Mystérieux
signal à 1 000 al
3/09/04
Voici un bel exemple d'une mauvaise interprétation des infos
astronomiques par la Presse.
New
Scientist a révélé qu'un
mystérieux signal, pourrait être d'origine extraterrestre.
Or, il n'en est
rien. Le responsable scientifique du SETI@home,
Dan
Werthimer
de l'université de Californie à Berkeley, a
déclaré que les propos de New Scientist sont très exagérés.
Avec le projet SETI@home,
le
radiotélescope d'Arécibo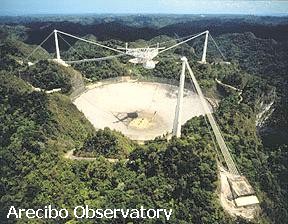 a
détecté un signal en provenance d'une région du
ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y
aucune étoile apparente dans cette zone.
La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.
Elle a été localisé
sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est
l'élément le plus abondant de l'univers.
a
détecté un signal en provenance d'une région du
ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y
aucune étoile apparente dans cette zone.
La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.
Elle a été localisé
sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est
l'élément le plus abondant de l'univers.
Comme tous les 5 milliards de signaux potentiels, la candidate baptisée SHGb02+14a,
avait un score représentant une probabilité statistique qu'à
l'intérieur il y ait un signal intelligent. Ces résultants l'ont
placé parmi les 200 probables, choisies pour des réobservations qui
eurent lieu en mars 2003, avec le radiotélescope d'Arécibo. De tous ces
candidats SHGb02+14a fut l'un de ceux à suivre les résultats des
courbes. Mais les chances sont très minces. Seul une chance totalement
aléatoire pourrait permettre de voir un signal, parmi les milliards
observés, à 3 occasions différentes, comme ce fut le cas pour SHGb02+14a.
En outre, comme cela fut relaté dans le bulletin du SETI@home
le 17 mai 2004, la dérive rapide de la fréquence (entre 8 et 37 hertz
par seconde) constatée, rend ce candidat improbable. A cause de cette
dérive, explique Werthimer, "si nous avions regardé le ciel même quelques secondes plus tard nous
n'aurions pas trouvé une allumette ". Un signal qui
dérive si rapidement et qui ne peut être entendu que quelques secondes
et à cette fréquence donnée, peut être détecté que par
une chance inimaginable. Inutile de dire, qu'une telle transmission à des
chances pratiquement nulles d'être issue d'une civilisation avancée.
Pour le directeur
du projet SETI@home
David Anderson de l'université de Berkeley, SHGb02+14a
serait un candidat de type inconnu pour un type connu de "mouvement
du barycentre corrigé selon une courbe gaussienne". Une
vraie transmission de ce genre resterait au moins dans une bande de
fréquence étroite et ne dériverait pas comme le fait ce signal.
SETI@home
utilise ses programmes fonctionnant comme économiseur d'écran (screensavers)
sur des millions de PC individuels dans le monde entier, pour filtrer les
signaux captés par le radio télescope d'Arécibo.
Pour
conclure, si cela avait été vrai, ce signal aurait été émis alors qu'en Angleterre se
déroulait la bataille d' Hastings avec Guillaume le conquérant. Si nous
répondions à ce signal, il
arriverait dans 1 000 ans. Pour eux il se sera écoulé 2 000 ans entre
l'émission du signal et la réception de notre réponse. Les discussions
à bâtons rompus avec des extraterrestres est une utopie.
Naturellement pas de démentie dans la Presse, comme d'habitude.
Méfiez-vous des informations à sensation. Avant de les croire, cherchez
la confirmation scientifique et non pas celle de pseudo scientifiques qui
apparaissent trop souvent à la télé.
Voir EXOPLANETES
http://planetary.org/news/2004/seti_signal_0902.html
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
Saturne
et les anneaux en fausse couleur
2/9/04
 La sonde spatial Cassini-Huygens a mesuré la température des anneaux de
Saturne avec une précision jamais atteinte. Les anneaux n'ont pas tous la
même température. Cette image en fausses
couleurs montre les différentes températures. Le côté non éclairé
des anneaux passe de 110°K (rouge) à 73°K (bleu). Le vert indique une
température de 90°K. Pour mémoire l'eau gèle à 273°K.
La sonde spatial Cassini-Huygens a mesuré la température des anneaux de
Saturne avec une précision jamais atteinte. Les anneaux n'ont pas tous la
même température. Cette image en fausses
couleurs montre les différentes températures. Le côté non éclairé
des anneaux passe de 110°K (rouge) à 73°K (bleu). Le vert indique une
température de 90°K. Pour mémoire l'eau gèle à 273°K.
Les données prouvent que la région
obscure des anneaux, comme l'anneau externe A (le plus éloigné, à
droite) et l'anneau du milieu B sont plus froids, alors que des sections plus transparentes, comme la
Division Cassini (en rouge juste à l'intérieur de l'anneau de A) ou l'anneau intérieur C (montré
en jaune et rouge), sont plus chaudes. Les scientifiques sont satisfaits
car cela confirme leurs calculs, les parties opaques des anneaux laissent
passer moins de lumière et celles transparentes, plus. Ces résultats montrent également, pour la première fois, que les
différents annelets dans l'anneau de C et la Division de Cassini sont plus
froids que leur entourage, des régions plus transparentes. L'anneau C est
à 110°K et l'anneau B à 73°K.
Ces résultats
longtemps soupçonnés et enfin vérifiés, fournissent de nouvelles
indications sur la composition, la structure et l'épaisseur des anneaux.
Ainsi la teneur en glace (eau) semble plus importante dans les régions
froides, qui en outre sont les moins denses et les moins opaques. par
ailleurs, les astronomes de l'université de Londres ont détecté la
présence, près de l'anneau F, d'un objet de 3 à 4 km de diamètre.
D'autre part un anneau très tenu associé à l'orbite d'Atlas a été
observé.
Ces mesures
furent prises le 1 juillet 2004 juste après l'insertion sur orbite autour
de Saturne. Cassini était si
proche de la planète qu'aucune photo du côté non éclairé des anneaux
ne fut exploitable, par conséquent les données de température furent
tracées sur une image du côté éclairé des anneaux. Saturne est
surexposée donc blanche sur cette image. Encelade est visible en bas de
la photo.
Le spectromètre infrarouge, un de 12 instruments
de Cassini, mesure les émissions infrarouges des atmosphères, des anneaux et des surfaces. Ce spectromètre créera des profils
verticaux de la température et de la composition des gaz pour les atmosphères de Titan et de Saturne. Pendant
la mission de quatre ans, l'instrument recueillera également des
informations sur les propriétés et la composition thermiques des anneaux de
Saturne et de ses satellites.
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia06425.html
|




 Les observations des 2 rovers qui ont atterri
sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura
recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des
chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du
laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars
Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant
le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau
superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande
que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.
Les observations des 2 rovers qui ont atterri
sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura
recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des
chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du
laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars
Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant
le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau
superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande
que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.



 Des
centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui
pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le
retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9
est attendue au-dessus du Nevada.
Des
centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui
pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le
retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9
est attendue au-dessus du Nevada.







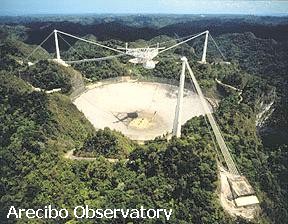 a
détecté un signal en provenance d'une région du
ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y
aucune étoile apparente dans cette zone.
La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.
Elle a été localisé
sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est
l'élément le plus abondant de l'univers.
a
détecté un signal en provenance d'une région du
ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y
aucune étoile apparente dans cette zone.
La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.
Elle a été localisé
sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est
l'élément le plus abondant de l'univers.



